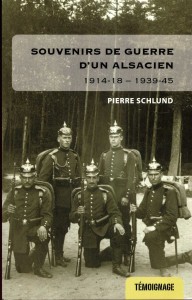1. Le témoin
Enfance et jeunesse :
Ernst Jünger est né le 29 mars 1895 à Heidelberg. Son père, chimiste dans un laboratoire d’analyse est aussi expert auprès du tribunal de Hanovre avant de devenir pharmacien. À l’école, le jeune Ernst se montre inattentif, rétif à la discipline mais se révèle aussi grand amateur de lectures, féru des œuvres de Conan Doyle, de Hackländer, des romans d’aventures de Karl May ; il lit les grands classiques comme Robinson Crusoë de Defoe, Don Quichotte, Don Juan de Byron, Roland furieux de l’Arioste, Le Comte de Monte Cristo de Dumas.
À l’occasion d’un échange scolaire, durant l’été 1909, un séjour en France près de Saint-Quentin lui permet de perfectionner son français. Jünger tient déjà un journal. En 1911, il s’inscrit au Wandervogel, mouvement de jeunesse proche du scoutisme mais mixte et non confessionnel. En 1913, Ernst Jünger, fortement impressionné par la lecture des récits de l’explorateur Henri Morton Stanley commence à rêver d’aventures en Afrique au point de s’enrôler dans la Légion étrangère française au bureau de recrutement de Verdun avec l’intention de déserter pour pouvoir pénétrer au cœur de l’Afrique. Incorporé le 3 novembre, il subit une courte période d’instruction à Sidi-Bel-Abbès, puis déserte. Il est repris. Pendant cet épisode, son père effectue des démarches pour le récupérer, arguant de son jeune âge. L’armée libère alors Ernst qui intègre la classe de première au lycée de Hanovre. Suite au décret de mobilisation du 1er août 1914, il s’engage à Hanovre au 73e Régiment de fusiliers (régiment de Gibraltar). Le 21 août, il passe en urgence une session exceptionnelle du baccalauréat et croyant en une guerre courte, s’inscrit à l’Université de Heidelberg. Le 6 octobre, il rejoint son régiment et subit trois mois de formation. Lorsqu’il rejoint le front de Champagne, on est déjà le 27 décembre. Il n’a donc pas connu la guerre de mouvement du début de la guerre. Il est blessé une première fois aux Éparges, le 25 avril 1915, presque en même temps que Maurice Genevoix, son vis-à-vis.
Pendant l’été 1915, il suit une formation d’élève-officier à Döberitz dans le Brandebourg. En septembre, il retrouve la guerre de position à Monchy (tranchées) et Douchy (repos) en tant qu’aspirant. Il est lieutenant le 27 novembre 1915. En avril 1916, E. Jünger suit un nouveau stage de formation à Croisilles ; après des heurts avec un colonel, il demande sa mutation dans l’aviation qui lui est refusée. Blessé une deuxième fois en août, il est soigné puis rejoint son régiment dans le secteur de Saint-Vaast. Le 12 novembre, troisième blessure. Le 16 décembre, il reçoit la Croix de fer de 1ère classe. Le 18 décembre, il commande la 2e compagnie de son régiment.
À partir du 17 janvier 1917, E. Jünger subit quatre nouvelles semaines d’instruction au camp de Sissonne, près de Laon. Il s’oppose alors à son père qui se montre soucieux de le voir trouver un poste moins exposé. On retrouve ici l’expression des stratégies de protection familiale. En mars 1917 : il prend part à la retraite de la Somme. Avril, combats dans le secteur de Fresnoy ; juin : combats d’escarmouches contre des troupes hindoues ; juillet, combats autour de Languemarck ; à cette occasion, il sauve la vie de son frère grièvement blessé. Une nouvelle demande d’être versé dans l’aviation lui est refusée, ce que ne mentionne pas son journal publié. Août, secteur de Regniéville ; 17 octobre, Flandres ; 15 novembre, double bataille de Cambrai contre les troupes britanniques. Le 9 décembre, il est blessé à la tête ; il obtient une permission pour Noël et il est fait chevalier de l’Ordre de la Maison de Hohenzollern.
Les trois premiers mois de 1918 sont consacrés à la préparation de la grande offensive. Le 19 mars, sa compagnie est presque entièrement anéantie par un obus. Ernst Jünger sort profondément traumatisé par cette expérience, ce dont il témoignera particulièrement dans Orages d’acier et Feu et sang. Le 21 mars commence la grande offensive pendant laquelle Ernst reçoit deux nouvelles blessures qui lui valent un séjour dans les hôpitaux militaires d’Allemagne. De retour sur le front le 4 juin dans le secteur de Vraucourt, il participe aux ultimes tentatives menées pour contenir les poussées anglaises. Des combats acharnés se déroulent notamment autour du Boqueteau 125 (qui donnera le titre d’un de ses livres de guerre), près de Bapaume. Le 25 août, une blessure sérieuse au poumon reçue près de Cambrai met un terme à la guerre d’Ernst Jünger.
L’après-guerre :
Le 22 septembre 1918, il reçoit la plus haute distinction militaire de l’armée allemande : « l’Ordre pour le mérite ». Au terme de sa convalescence, il intègre au printemps 1919 la nouvelle Reichswehr au 16e RI, sous les ordres du capitaine Oskar Hindenburg. En mars 1920, il se trouve engagé dans la répression du putsch de Kapp. Compte tenu de son expérience en tant que chef de groupe de choc, il est alors chargé au ministère de la guerre à Berlin de rédiger le nouveau règlement de l’infanterie ; ce dernier est publié en 1922.
En septembre 1923, bien que n’appartenant pas au N.S.D.A.P., il publie un article dans la revue du parti nazi Révolution et idée. En septembre, E. Jünger accepte d’être responsable pour la Saxe des Corps francs de Gerhard Rossbach mais trouvant ses camarades bien peu révolutionnaires, il en démissionne dès le mois suivant.
En 1924, il entame des études de zoologie à Leipzig. En 1925, il se marie, et, adhère au Stalhelm, association paramilitaire d’anciens combattants refusant l’humiliation du traité de Versailles. Jünger est alors considéré comme un journaliste politique actif de la droite allemande radicale qui se proclame révolutionnaire. Il rejoint un groupe de jeunes extrémistes hostiles à la République de Weimar dans lequel figurent entre autres, son frère Friedrich Georg, et l’écrivain Werner Beumellung. Son ouvrage Feu et sang est publié aux éditions du Stalhelm.
À partir de 1927, tout en éprouvant une certaine sympathie à l’égard du mouvement d’Hitler, il tient néanmoins à s’en démarquer et repousse les avances de Goebbels. En avril il collabore à la revue d’Ernst Niekisch, Widerstand. Zeitschrift für sozialistisches und national-revolutionäre Politik (Résistance. Revue pour une politique socialiste et nationale-révolutionnaire). Cette revue s’oppose alors à la République de Weimar comme elle s’opposera ensuite à la politique d’Hitler, même après son accession au pouvoir. Le 1er juillet 1927, il repousse une offre de devenir député national-socialiste.
Erich Maria Remarque fait l’éloge d’Orages d’acier et du Boqueteau 125 dans l’hebdomadaire Sport im Bild du 18 juin 1928. Jünger publie l’année suivante sa première œuvre prenant une distance avec l’expérience de la Première Guerre mondiale : Cœur aventureux. Notes prises de jour et de nuit.
Bien qu’invité, il ne se rend pas au Congrès du parti nazi qui se tient à Nüremberg en août 1929. Le 1er septembre, il soutient l’action terroriste du mouvement paysan du Schleswig-Holstein condamnée par les Nazis ; Jünger critique alors le légalisme de ces derniers et « leur nature foncièrement bourgeoise ». Le 27 octobre, Jünger est violemment attaqué par Goebbels dans le journal du parti nazi, Der Angriff (l’Attaque). Fin 1929-début 1930, il fait la rencontre de Carl Schmidt ; puis publie deux ouvrages assortis de près de 300 photographies, Le Visage de la guerre mondiale. 1. Expériences vécues sur le front par les soldats allemands. 2. La parole est à l’ennemi. Expériences vécues à la guerre par nos adversaires (voir l’étude de Nicolàs Sanchez Durà, Ernst Jünger, técnica y fotografia, Univ. De Valence, 2000.)
En 1933, son domicile est perquisitionné par la police ; il refuse de siéger au Reichstag en tant que député national-socialiste, et le 16 novembre, d’entrer à l’Académie de poésie.
2. Le témoignage
Composée après-guerre, à partir des notes consignées dans un carnet tenu pendant la guerre, Orages d’acier est un témoignage et une œuvre littéraire peu ordinaire en ce qu’elle vit, évolue, se façonne et se refaçonne pendant 60 années, au gré des rééditions successives, au prix d’un travail de réécriture permanent. Bien qu’écrit après la guerre, le récit proprement dit intègre des notes consignées dans le carnet de guerre (ex. p. 45-46), ainsi que d’autres documents (lettres, témoignages de camarades, ex. p. 96 ; de son frère Fritz p. 157).
La première édition d’Orages d’acier sort en octobre 1920 à compte d’auteur. Puis, en 1922 paraît une édition légèrement revue, chez l’éditeur Mittler & Sohn à Berlin, en même temps que Le Combat comme expérience intérieure composé l’année précédente. En 1924 paraît une troisième version d’Orages d’acier dotée d’une coloration plus nationaliste (extrait de la préface de 1924 : « […] Nous ne sommes pas d’humeur à rayer cette guerre de notre mémoire, nous en sommes fiers. Nous sommes indissolublement liés par le sang et le souvenir. Et une nouvelle jeunesse plus hardie vient déjà combler nos vides. Nous avons besoin, pour les temps à venir, d’une génération de fer, dépourvue de scrupules. Nous échangerons de nouveau la plume pour l’épée, l’encre pour le sang, la parole pour l’action, la sensiblerie pour le sacrifice – nous devons absolument le faire, sinon d’autres nous piétineront dans la boue. […] Puisse nous guider au-dessus de toutes les bassesses notre grande idée claire et communautaire ; la patrie, conçue au sens le plus large. Pour elle, nous sommes tous prêts à mourir… », p. 274). La même année paraît le Boqueteau 125 (octobre). En 1934 paraît une quatrième version d’Orages d’acier expurgée des passages ultranationalistes susceptibles d’être exploités par les nazis. L’année suivante paraît une cinquième version accentuant l’orientation de 1934. Au total, ce sont sept versions d’Orages d’acier que Jünger aura publiées (4 du Boqueteau 125 et 5 de Feu et sang).
La première traduction française d’Orages d’acier paraît en 1930, réalisée et présentée par le lieutenant-colonel Grenier ; cette traduction est conforme à la troisième version du texte, celle de 1924, non expurgée.
Une remarquable dernière édition française d’Orages d’acier vient d’être publiée sous l’égide de Julien Hervier dans la collection de la Pléiade (Gallimard), dans la traduction d’Henri Plard publiée en 1970 (chez Christian Bourgeois Éditeur, à partir de l’édition allemande de 1961 publiée chez Ernst Klett Verlag de Stuttgart), traduction revue par Julien Hervier pour Gallimard, en 2008. Toutes les informations d’ordre biographique ci-dessus sont empruntées à la présentation fort bien renseignée de Julien Hervier : Jünger, Journaux de guerre, 1914-1918. Une introduction situe historiquement l’action pour chacun des chapitres. Ce dispositif est complété par les différentes préfaces ayant accompagné les éditions de 1920, 1922, 1924, 1934 ; préfaces aux traductions anglaise de 1929 et française de 1960. Notons encore que dans ce volume, Orages d’acier est suivi des trois autres journaux de guerre : Le Boqueteau 125, Feu et sang, La Déclaration de guerre de 1914 ainsi que d’autres récits sur la Première Guerre mondiale : Le combat comme expérience intérieure, Sturm.
3. Analyse.
L’œuvre de Jünger constitue une véritable mine de renseignements à plus d’un égard : concernant le fonctionnement des petits groupes de soldats ; les mécanismes de cohésion, le conformisme aux normes et aux valeurs du groupe, le rôle et les postures des chefs d’unités, le combat rapproché ; les relations avec les civils en zone occupée ; le rapport aux corps et aux cadavres…
Motivations du départ : D’après Jünger, son propre départ, et le départ de nombreux jeunes allemands, furent avant tout motivés par une soif d’aventures, de prise de risque, l’idée de ne pas rater un événement exceptionnel : la guerre… : « […] Ah, surtout, ne pas rester chez soi, être admis à cette communion ! » (p. 3 : N.B. toutes les pages indiquées dans cette notice sont celles de l’édition en Pléiade). En même temps, la guerre est perçue comme une épreuve de virilité. Mais à peine arrivées sur le front, les jeunes recrues enthousiastes sont vite dégrisées : premiers obus, premiers blessés… (p. 4-5) ; les anciens assaillent les nouveaux de questions et essaient d’obtenir des informations du pays : « On nous demanda ce qui se passait à Hanovre, et si la guerre n’allait pas bientôt finir » (p. 6) ; Jünger note également que les nouveaux, qui sont en outre des engagés volontaires, ne sont pas très bien accueillis par leurs camarades plus anciens et simples mobilisés : « Les anciens ne laissaient passer aucune occasion de nous ?mettre en boîte? de la belle manière, et tous les empoisonnements, toutes les corvées imprévues tombaient tout naturellement sur les ?enragés volontaires?. Cet usage […] disparut d’ailleurs après qu’une première bataille subie en commun nous eut donné le droit de nous considérer comme des anciens » ; l’expérience partagée du danger, l’épreuve du feu soudent les groupes primaires.
La guerre réelle ne correspond pas aux attentes formées depuis l’arrière par les recrues : « Un court séjour au régiment avait suffi à nous guérir de nos illusions premières. Au lieu des dangers espérés, nous avions trouvé la crasse, le travail, les nuits sans sommeil, tous maux dont l’endurance exigeait un héroïsme peu conforme à notre naturel. Mais le pire, c’était l’ennui, plus énervant pour le soldat que la proximité de la mort. Nous espérions une attaque… » (p. 10)
Les Éparges : 23 avril 1915, premier combat (p. 19).
Notations sur le commandement, la conduite de la guerre et des hommes : En première ligne, il ne peut être question de repos ; ni le jour, ni la nuit, du fait des gardes et des travaux divers et incessants ; Jünger évoque la « torpeur » dans laquelle tombent de nombreux soldats. Les périodes dites de « repos » ne sont d’ailleurs pas plus reposantes ; là encore, les travaux se succèdent (p. 8). Le surmenage est également mis sur le compte d’un commandement qui n’a pas encore pris l’exacte mesure des exigences de la guerre de position. Jünger critique également l’aménagement d’abris profonds et confortables qui « crée la manie de s’accrocher au dispositif de défense, un besoin de sécurité auquel on a ensuite du mal à renoncer » (p. 11) ; « Ces brefs coups de main, durant lesquels il fallait serrer les dents, était un moyen de s’endurcir le courage et de rompre la monotonie de l’existence dans les tranchées. Il faut avant tout que le soldat ne s’ennuie pas » (p. 79) ;
Discipline : Un soldat puni est envoyé monter la garde en poste avancé muni seulement d’une pioche (p. 12). Le vandalisme, le pillage sont nuisibles à la cohésion et à la discipline : Cf. destructions lors de la retraite sur la ligne Siegfried (Hindenburg) au printemps 1917 ; son commentaire vis-à-vis de ces destructions a varié : « Ce fut la première fois où je vis à l’œuvre la destruction préméditée, systématique, que, plus tard dans ma vie, j’allais rencontrer jusqu’à l’écœurement ; elle est sinistrement liée aux doctrines économiques de notre temps, rapporte au destructeur lui-même plus de tort que de profit et ne fait aucunement honneur au soldat » (p. 114-115) [Une note précise : « ce paragraphe est un ajout assez tardif ; les destructions sont décrites sans commentaire dans les versions de 1934 et 1935. De 1920 à 1924, le commentaire était le suivant : ?la légitimité morale de ces destructions est très contestée, mais sur ce point, les réactions de colère et de tristesse chauvines me semblent plus compréhensibles que les applaudissements satisfaits des guerriers en chambre et des scribouillards des journaux. Quand des milliers de personnes pacifiques sont dépouillées de leur patrie, le sentiment complaisant de notre puissance doit se taire./ Naturellement, en tant qu’officier prussien, je ne doute pas un instant de la nécessité de ces actes. Faire la guerre, cela veut dire essayer d’anéantir l’adversaire en déployant sa force sans restriction aucune. La guerre est le plus rude des métiers, ses maîtres d’œuvre ne doivent ouvrir leur cœur aux sentiments d’humanité que dans la mesure où celle-ci ne risque pas de leur nuire./ Quant au fait que ces destructions qui répondaient aux exigences de l’heure n’étaient pas belles, il ne changeait rien à l’affaire? » (note 5, p. 730)] ; « […] à la découverte des réserves de vin rouge, le village, déjà pris sous le feu de l’ennemi, était devenu le théâtre d’un débridement bachique qu’il avait eu le plus grand mal à réfréner. […] nous prîmes l’habitude, les fois suivantes, de fracasser à coups de pistolet les dames-jeannes et autres récipients de même calibre » (p. 118).
La force de l’exemple : Postures de chefs et de meneur d’hommes : (p. 20) ; « À 3 heures de l’après-midi, mes guetteurs de gauche arrivèrent et me rapportèrent qu’ils ne pouvaient plus tenir, leurs trous étant démolis par les obus. Je dus déployer toute mon autorité pour les renvoyer à leur poste. Il est vrai que je me trouvais à l’emplacement le plus dangereux, et c’est là qu’on dispose de la plus haute puissance de commandement » (p. 89.) ; « La méthode d’approche [patrouille] que je viens de mentionner consistait à faire alternativement ramper en avant chaque homme de la patrouille, sur un terrain où nous pouvions à chaque instant nous heurter à l’ennemi. […] Je prenais naturellement mon tour dans cette fonction, bien que ma présence dans la patrouille eût été mieux indiquée ; mais à la guerre, les considérations tactiques ne sont pas toujours les seules décisives » (p. 130) ; « Je fus le dernier à quitter le petit fortin… » (p. 152) ; (p. 171).
Obtenir l’obéissance : « […] les jeunes de ma section s’étaient déjà enquis une bonne de douzaine de fois de savoir si je n’étais pas encore revenu. Cette nouvelle me toucha profondément et m’emplit de force ; elle m’apprit que dans les jours brûlants qui nous attendaient, je pouvais compter sur plus encore que la seule obéissance due à mon grade, et que je disposais aussi d’un crédit personnel » (p. 80) (21 août 1916) ; « En avant ! En avant ! Des hommes s’abattaient soudain dans leur course et nous les cinglions de menaces pour les forcer à tirer de leurs corps épuisés leurs dernières énergies » (p. 86) ; (p. 92) ; (p. 123) ; « Comme notre petit groupe était très réduit, je tentai de le renforcer à l’aide des nombreux hommes qui battaient le terrain sans chef. La plupart déférèrent de bonne grâce à nos sommations, […], tandis que d’autres poursuivaient leur course après s’être arrêtés un moment, surpris, quand ils avaient vu qu’il n’y avait rien à gagner chez nous. Dans ce genre de situation, il n’y a pas de ménagement qui tienne. Je les fis mettre en joue » (p. 151) ; idem p. 152 ; « [patrouille] ne connaissant pas le chemin […]. Tout en me hâtant de passer, je le demandai à un sous-officier inconnu qui se tenait à une entrée de cave. Pour toute réponse, il se fourra les mains dans les poches et haussa les épaules. Comme je n’avais pas de temps à perdre au milieu des projectiles, je bondis sur lui et lui arrachai les renseignements nécessaires en lui mettant mon pistolet sous le nez.
Ce fut la première fois où je rencontrai au combat un homme qui me fit des difficultés, non par frousse, mais, de toute évidence, par pur dégoût de la guerre. Bien que ce dégoût se fût naturellement accru et généralisé dans ces dernières années, une telle manifestation, en pleine action, n’en restait pas moins très insolite, car la bataille lie, tandis que l’inaction disperse. Au combat, on est sous le coup de nécessités objectives. C’est au contraire lors des marches, au milieu des colonnes revenant de la bataille de matériel, qu’on pouvait le plus ouvertement observer la manière dont la discipline s’effritait » (p. 175-176) ; (p. 185)
Altercation avec des soldats de l’arrière : (p. 125)
Alcool : « on nous versait en abondance une gnôle d’un rouge pâle […] qui avait un franc goût d’alcool à brûler, mais qui par ce temps humide n’était nullement à dédaigner » (p. 10) ; « duels bachiques, selon la bonne vieille tradition allemande » à Douchy (p. 31) ; conduites déviantes, inconscientes du danger sous l’effet de l’alcool (p. 58) ; « Le 17 [mars 1917] au matin, nous remarquâmes qu’une attaque devait être imminente. Dans la tranchée anglaise de première ligne, fortement embourbée et vide à l’ordinaire, on entendait le clapotis de multiples bottes. Les rires et les cris d’une troupe nombreuse révélaient que nos gaillards avaient aussi dû s’humecter sérieusement le gosier » (p. 116)
Corps : on ne trouve pas de trace d’aseptisation chez le témoin Jünger : [après un bombardement] « Nous attrapâmes les membres qui sortaient des décombres et tirâmes les cadavres. L’un avait eu la tête arrachée : le cou était planté sur le tronc comme une grosse éponge sanguinolente… […] Je dressai la liste des objets de valeur que nous trouvâmes sur les corps. C’était un travail lugubre. […] mes hommes me tendaient les portefeuilles et les objets d’argent comme s’ils observaient un rite sombre et mystérieux. La fine poussière jaune des briques s’était déposée sur le visage des morts, lui donnant la rigidité de masques en cire. Nous jetâmes des couvertures sur leurs restes et nous hâtâmes de quitter la cave, après avoir emmailloté notre blessé dans une toile de tente » (p. 122). « L’odeur de décomposition, dans cet air lourd, avait crû jusqu’à devenir presque intolérable. Nous arrosâmes les morts de chlorure de chaux que nous avions emporté dans des sacs. Les taches blanches luisaient dans l’obscurité comme des suaires » (p. 139). D’autres soldats se montrent moins respectueux des morts ; certains pillent les cadavres (p. 22) et (p. 204) ; (p. 145) ; (p. 172)
Tranchées constituées dans des charniers : (p. 46), (p. 88) ; (p. 154) ; Inhumation (p. 76) ; pendant la bat de la Somme : « Des blessés tombaient, appelaient à l’aide, sans que personne y prît garde, de droite et de gauche, dans les trous d’obus, les yeux rivés à l’homme de devant, le long d’un fossé qui ne nous venait qu’au genou, fait d’une chaîne de gigantesques entonnoirs où les morts se suivaient à la file. Le pied écrasait avec dégoût les corps flasques qui cédaient sous lui ; l’obscurité dérobait leurs formes aux yeux. Le blessé qui tombait en travers du chemin n’était pas moins destiné à être piétiné par les bottes de ceux qui poursuivaient en hâte leur route. » (p. 86-87)
Tirs amis : (p. 148-149) ; p. 152 ; p. 171 ; p. 219 ; p. 243-244
Peur : Jünger est surpris de voir que les artilleurs se montrent plus impressionnés par le sifflement des balles que par celui des obus (p. 12) ; « Le feu d’artillerie, en terrain aussi découvert où l’on peut se mouvoir librement, n’a ni la même puissance matérielle ni le même effet moral que dans les agglomérations ou les tranchées » (p. 71) ; « Nous nous égaillâmes d’un bond et nous plaquâmes dans les entonnoirs. Je tombai le genou dans le produit de la frousse d’un prédécesseur et, en hâte, je me fis nettoyer au couteau, vaille que vaille, par mon ordonnance » (p. 253).
La force des normes sociales dominantes : « Un froussard se plaqua au sol sous les rires un peu contraints de ses camarades » (p. 19). Orgueil du groupe : « Le colonel a souvent voulu nous affecter à un secteur plus calme […] mais chaque fois, la compagnie demandait comme un seul homme de pouvoir garder son secteur C » (p. 45) ; « Le 8 novembre [1916]. […] Ce capitaine de cavalerie logeait avec quatre officiers chefs de patrouille, deux officiers-observateurs et son adjoint dans le vaste presbytère, dont nous nous partageâmes les pièces. Dans la bibliothèque, l’un des premiers soirs, une longue discussion s’engagea au sujet des offres de paix allemandes, qui venaient d’être publiées. Böckelmann y mit fin d’une phrase : chaque soldat devait s’interdire de prononcer seulement le mot de paix, tant que durait la guerre. » (p. 101)
« Nous devions nous infiltrer en deux points dans la tranchée ennemie et tâcher d’y faire des prisonniers. […] Quand je demandais des volontaires, j’eus la surprise de voir – car nous étions tout de même à la fin de 1917 – se présenter dans presque toutes les compagnies du bataillon près des trois quarts de l’effectif. […] Quelques volontaires en surnombre pleurèrent presque lorsqu’ils furent refusés. […] Les casse-cous les plus cinglés du 2e bataillon avaient fait équipe.
Dix jours durant, nous nous exerçâmes au lancer de grenades et répétâmes notre coup de main contre des défenses qui reproduisaient notre objectif. […] A part cela, nous étions dispensés de service… » (p. 166-167).
Gestes de solidarité : Encouragements mutuels (p. 23) ; « En franchissant la route, nous rencontrâmes la 2e compagnie. Kius avait été mis au courant de notre situation par des blessés et, tant de son propre mouvement que sur les instances de ses hommes, il s’était mis en route pour nous sortir de ce mauvais pas. Il l’avait fait sans ordre. Cela nous émut et nous emplit d’une exubérance joyeuse, un de ces états d’âme où l’on voudrait arracher des arbres » (p. 152). « De temps à autre, l’un de nous disparaissait dans la boue jusqu’aux hanches, et si ses camarades ne lui étaient pas venus en aide en lui tendant la crosse de leurs fusils, ils s’y seraient immanquablement noyé » (p. 180) ; à l’occasion de sa dernière blessure, ses hommes se sacrifient pour le ramener au poste de secours « […] Cet exemple peu encourageant n’empêcha pas un second sauveteur de risquer une nouvelle tentative pour me tirer d’affaire… » (p. 259-260)
Hindous : p. 134-135
Jünger témoigne de ce qu’un soldat peut tuer sans haine ; on note chez lui un profond respect pour l’ennemi ; même s’il n’hésite pas à tuer en cas de danger : « Les Français avaient dû tenir des mois auprès de leurs camarades abattus, sans pouvoir les ensevelir […] « Dans ce désordre gisaient les corps des braves défenseurs, dont les fusils étaient encore appuyés aux créneaux… » (p. 21-22); « Alerté par un guetteur, Eisen accourut avec quelques hommes et lança des grenades, contraignant l’adversaire à se retirer en laissant deux hommes sur le terrain. L’un d’eux, un jeune lieutenant, mourut aussitôt après, l’autre, un sergent, était grièvement blessé au bras et à la jambe. Nous apprîmes par les papiers de l’officier qu’il s’appelait Sokes et appartenait au 2e fusiliers, le Royal Munster. Il était très bien habillé, et son visage convulsé par l’agonie avait des traits intelligents et énergiques. Son calepin contenait une foule d’adresses de jeunes filles, à Londres ; ce détail m’émut. Nous l’ensevelîmes derrière notre tranchée et lui plantâmes une croix sans ornement, où je fis marquer son nom avec des clous de soulier. Cet incident me fit voir que toutes les patrouilles ne se terminaient pas aussi heureusement que les miennes, jusqu’à présent du moins. » (p. 111-112) ; « Cette chasse à courre dans le marais était totalement exténuante » (p. 181) ; « […] nous vîmes les premiers Anglais venir vers nous, les bras en l’air. L’un après l’autre, ils contournèrent la traverse et débouclèrent leurs armes ; menaçants, nos fusils et nos pistolets étaient braqués sur eux. […] La plupart montraient par leur sourire confiant qu’ils ne s’attendaient pas à des atrocités de notre part. D’autres essayaient de se concilier nos bonnes grâces en nous tendant des paquets de cigarettes et des tablettes de chocolat. Je vis avec la joie croissante du vrai chasseur que nous avions fait une prise considérable ; […] J’arrêtai un officier et l’interrogeai sur la suite du tracé de la position et sur les effectifs qui la tenaient. Il me répondit très poliment ; qu’il se mit par surcroît au garde-à-vous, c’était totalement superflu. […] il me conduisit au commandant de compagnie, un captain blessé, qui se trouvait dans un abri voisin. J’y fis la connaissance d’un jeune homme d’environ vingt-six ans […] qui s’appuyait au châssis de galerie, le mollet traversé d’une balle. Quand je me présentai, il porta à sa casquette sa main où brillait une gourmette d’or, me donna son nom et me tendit son pistolet. Ses premières paroles me montrèrent que j’avais affaire à un homme : ?We were surrounded about?. Il se sentait obligé d’expliquer à son adversaire pourquoi sa compagnie s’était si vite rendue. Nous nous entretînmes en français de choses et d’autres. Il me raconta qu’une série de blessés allemands, que ses hommes avaient pansés et ravitaillés, étaient étendus dans un abri voisin. […] Lorsque j’eus promis de le faire ramener à l’arrière, ainsi que les autres blessés, nous nous serrâmes la main et nous séparâmes » (p. 189-190) ; « Nous passions à la hâte devant des corps encore chauds, robustes, sous les kilts courts desquels luisaient des genoux vigoureux, ou nous rampions par-dessus eux. C’étaient des Highlanders, et l’allure de leur résistance montrait bien que nous avions affaire à de vrais hommes » (p. 223) ; « J’eus une vive empoignade avec le chef du train des équipages, qui voulait faire jeter en bas de la voiture deux Anglais blessés, alors qu’ils m’avaient soutenu durant la dernière partie de notre trajet » (p. 230)
Réduction de la violence, trêves tacites : « En maints endroits de la position […] les sentinelles sont à trente mètres à peine l’une de l’autre. Il s’y noue parfois des relations personnelles […]. De brèves apostrophes, qui ne manquent pas d’un certain humour primitif, volent d’une ligne à l’autre. ?Hé, tommy, t’es toujours là ? – Ouais ! – Alors, planque ta tête, je vais tirer !? » (p. 39-40) ; « L’infanterie des deux côtés s’en tenait, par convention tacite, au fusil, et l’emploi d’explosifs provoquait un tir de représailles deux fois plus intense » (p. 58) ; ces trêves ne sont pas réservées aux premiers mois de guerre : « Ce jour–là, je vis de petits groupes de brancardiers, drapeaux de la Croix-Rouge déployés, se mouvoir à découvert dans la zone des feux d’infanterie, sans qu’un seul coup fût tiré contre eux. De telles images ne se montraient au combattant, dans cette guerre souterraine, que dans les cas où la détresse avait atteint un paroxysme insoutenable » (p. 183, octobre 1917, Flandres)
Scène de fraternisation en décembre 1915, secteur de Quéant provoqué par l’inondation des tranchées : « Les occupants des tranchées des deux partis avaient été chassés par la boue sur leurs parapets, et il s’était déjà amorcé, entre les réseaux de barbelés, des échanges animés, tout un troc d’eau-de-vie, de cigarettes, de boutons d’uniforme et d’autres objets… » (p. 49-51) ; « […] un ton où s’exprimait une estime quasi sportive… » (p. 50) ; l’artillerie accompagne et signale la fin de l’entretien (p. 51) ; le soir de Noël 1915 : les Allemands entonnent des chants que les Anglais « étouffèrent sous les salves de leurs mitrailleuses. Le jour de Noël, nous perdîmes un homme de la troisième section, atteint par ricochet d’une balle dans la tête. Juste après, les Anglais firent une tentative de rapprochement amical en hissant sur leur parapet un arbre de Noël, que nos hommes furibonds, balayèrent en quelques coups de feu, auxquels les tommies répondirent à leur tour…. » (p. 51)
Un blessé se lamente de devoir quitter définitivement le front ; cela surprend Jünger ; nous sommes au début de la guerre (p. 28) ; cas inversé en mai 1917 : « […] l’un de mes hommes attrapa une balle de shrapnel qui lui resta dans la fesse droite. Quand, alerté, j’accourus au lieu de l’accident, je le trouvai déjà tout réjoui, attendant les brancardiers, assis sur sa fesse gauche, en train de boire le café accompagné d’une gigantesque tartine de confiture » (p. 127).
L’amour du pays : Jünger est évacué en Allemagne après sa première blessure reçue aux Éparges : « Le train nous déposa à Heidelberg. Quand je vis les collines du Neckar couvertes de cerisiers en fleur […]. Comme ce pays était beau, et bien digne qu’on versât son sang et qu’on mourût pour lui ! » (p. 28)
Les rapports avec la population civile occupée sont nombreux et apparemment cordiaux : septembre 1915 (p. 30) ; Douchy est la base de repos du 73e : « La population française était cantonnée à la sortie du village, du côté de Monchy. Des enfants jouaient sur le seuil. […] Nous n’allions voir les habitants que pour leur apporter notre linge à laver ou pour leur acheter du beurre et des œufs » (p. 31-32) « […] adoption de deux petits orphelins français par la troupe… » (p. 32) ; le village ruiné de Monchy-au-Bois (p. 32) ; relation avec une jeune fille de 17 ans du village de Croisilles (p. 60) ; civils de Douchy inquiets des gaz demandent au colonel allemand des masques ; ils sont évacués vers l’arrière (p. 74) ; cantonnement à Brancourt : flirts et amourettes entre soldats et femmes françaises (p. 99-100) ; cantonnements successifs à Cambrai chez la famille Plancot : « mes hôtes, un couple d’orfèvres très aimable, les Plancot-Bourlon, laissaient rarement passer un déjeuner sans m’envoyer dans ma chambre quelque bon morceau. Nous occupions nos soirées ensemble devant une tasse de thé, à jouer au trictrac et à bavarder. Bien entendu, une question épineuse revenait souvent sur le tapis : pourquoi faut-il que les hommes se fassent la guerre ?… » (p. 141) ; « Je retrouvai M. et Mme Plancot, qui m’avaient si bien hébergé l’année précédente, et à qui ma visite fit le plus grand plaisir…» (p. 250) ; « [Jünger blessé, août 1918] […] M. et Mme Plancot m’envoyèrent une lettre aimable, une boîte de lait condensé dont ils s’étaient privés à mon intention, et le seul melon qu’eût produit leur potager » (p. 261) ; octobre 1917, cantonnement à Roulers/Roeselaere en Flandre : bombardements de l’aviation anglaise (p. 173-175) ;
Description d’une tranchée de première ligne (p. 34-36) ; une journée de tranchée-type (p. 37-39)
TUER. Chef d’un groupe de choc, Jünger est très explicite sur la pratique de la violence interpersonnelle, les différentes façons d’éliminer son ennemi, les coups de main et les combats rapprochés: (p. 42) ; (p. 46) ; « Ils contemplent avec une volupté de connaisseurs les effets de l’artillerie sur la tranchée ennemie… » ; « Ils aiment tirer des grenades à fusil et des mines légères contre les lignes adverses, au grand mécontentement des timorés […]. Mais cela ne les empêche pas de réfléchir constamment à la meilleure manière de projeter des grenades avec une espèce de catapulte de leur invention… » (p. 42) ; « Devant le secteur de la première section, deux ravitailleurs anglais apparurent à la tombée du jour : ils s’étaient égarés. Ils s’approchèrent le plus paisiblement du monde : l’un tenait à la main une grande gamelle ronde, l’autre un long bidon plein de thé. Tous deux furent abattus presque à bout portant. […] Il n’était guère possible de faire des prisonniers dans cet enfer : comment aurait-on pu les ramener à travers la zone d tirs de barrage ? » (p. 91) ; « Schmidt, le premier survivant peut-être des défenseurs du chemin creux, entendit des pas qui annonçaient l’approche des assaillants. Aussitôt après, des coups de feu retentirent à ras du sol, et des éclatements de charges explosives et de grenades à gaz : on nettoyait l’abri. » (p. 98-99) ; [combat dans une tranchée] (p. 112) ; « j’arrachai le fusil des mains du guetteur le plus proche, mis la hausse à six cents mètres, visai soigneusement, un peu en avant de la tête, et pressai la détente. Il fit encore trois pas, tomba sur le dos… » (p. 112-113) ; « Un tirailleur isolé se montra à l’orée du bois et marcha vers nous. Un homme commit l’erreur de lui crier : ?Le mot de passe !?, sur quoi il s’arrêta, indécis, puis fit demi-tour. Un éclaireur, bien entendu.
?Descendez-le !?. Une douzaine de coups de feu ; la forme s’écroula et glissa dans l’herbe haute » (p. 133) ; « C’était le moment voulu pour foncer dans le tas. Baïonnette au canon, en poussant des hourras furieux, nous montâmes à l’assaut du petit bois. Des grenades volèrent à travers les broussailles denses, et en un rien de temps nous eûmes reconquis notre avant-poste sans avoir réussi, à vrai dire, à saisir notre souple adversaire » (p. 134) ; Suit le ramassage de trois blessés hindous. « Nous bloquâmes sans tarder leur avance, bien qu’ils arrivassent avec une supériorité numérique considérable. Nous tirions rapidement, mais en visant. Je vis un gros soldat de première classe de la 8e compagnie appuyer avec le plus grand flegme le canon de son fusil sur une souche déchiquetée ; à chaque coup, c’était un assaillant qui tombait » (p. 153) ; « J’avais fait le choix d’un vêtement de travail conforme à la tâche que nous nous proposions d’accomplir » ; Jünger emporte deux pistolets et différents types de grenades… « Nous avions décousu les pattes d’épaule et le ruban de Gibraltar, pour ne pas donner à l’ennemi d’indications sur notre corps. Comme signe de reconnaissance, nous portions à chaque bras un brassard blanc » (p. 167-168) ; « Kienitz me raconta en hâte qu’il avait chassé à coups de grenades, dans la première tranchée, des Français occupés au terrassement, et qu’en poursuivant son avance, dès le début il avait eu des morts et des blessés, dus au tir de notre propre artillerie » (p. 171) ; « Le lendemain matin, le colonel von Oppen vint voir une seconde fois les hommes de la patrouille, distribua des Croix de fer et donna à chacun des participants quinze jours de permission. » (p. 172) ; corps à corps : « Domeyer se heurta à un territorial français à la barbe de fleuve qui à sa sommation : ?Rendez-vous !?, répliqua avec fureur : ?Ah non !? et se jeta sur lui. Au cours d’un duel acharné, Domeyer lui tira un coup de pistolet à travers la gorge et dut, comme moi, revenir sans prisonniers » (p. 173) ; une forme de bouclier humain… « Juste après l’attaque, le chef de ce petit fortin, un adjudant, avait repéré un Anglais qui ramenait trois Allemands prisonniers. Il abattit l’Anglais et renforça de trois hommes son effectif. Lorsqu’ils furent à bout de munitions, ils placèrent devant la porte un Anglais soigneusement pansé afin d’empêcher d’autres tirs, et une fois la nuit tombée, ils réussirent à battre en retraite sans se faire repérer.
Un autre fortin bétonné, où commandait un lieutenant, fut sommé de se rendre par un officier anglais ; pour toute réponse, l’Allemand bondit au-dehors, saisit l’Anglais au collet et le traîna à l’intérieur sous les yeux de ses hommes médusés » (p. 182-183) ; « Un avion allemand descendit en flammes une saucisse anglaise dont les observateurs sautèrent en parachute. Il exécuta encore quelques évolutions autour de ces Anglais suspendus en l’air et les arrosa de balles traçantes – signe que la violence impitoyable de la guerre s’aggravait » (p. 186) ; Combats à la grenade (p. 193-195) ; « Entre tous les moments excitants de la guerre, aucun n’est aussi fort que la rencontre de deux chefs de troupes de choc, entre les étroites parois d’argile des positions de combat. Plus question alors de retraite ni de pitié ! » (p. 195) ; Un face à face : « Nous nous aperçûmes au moment où je débouchai d’un tournant. […]. Ce fut une délivrance de voir enfin concrètement l’adversaire. Je posai le canon de mon arme contre la tempe de l’homme paralysé par la peur, l’empoignant de l’autre main par sa vareuse d’uniforme qui portait des décorations et les insignes de son grade. Un officier ; […] Avec un gémissement, il porta sa main à sa poche, pour en tirer, non pas une arme, mais une photo qu’il me tint sous les yeux. Elle le montrait sur une terrasse, entouré d’une nombreuse famille. Ce fut un appel magique […]. J’ai par la suite considéré comme un grand bonheur de l’avoir épargné en poursuivant ma course en avant » (p. 211) ; « Le défenseur n’était donc plus qu’à une longueur de bras de nous. Cette immédiate proximité de l’ennemi constituait notre sauvegarde. Elle constitua aussi sa perte. Une buée brûlante montait de l’arme. Elle devait avoir fait déjà beaucoup de victimes et continuait à faucher. […]
Je fixai, fasciné, ce bout de fer brûlant et vibrant qui semait la mort et me frôlait presque le pied. Puis je tirai à travers la toile. Un homme se dressa près de moi, l’arracha et balança une grenade dans l’ouverture. Une secousse et la fumée blanche qui jaillit nous en apprirent l’effet. Le procédé était brutal, mais sûr. Le canon ne bougeait plus, l’arme se tut » (p. 212-213) ; « Ce fut la première fois à la guerre où je vis se heurter des masses humaines. […] Je sautai dans la première tranchée ; […] je me heurtai à un officier anglais à la vareuse déboutonnée, dont pendait la cravate par laquelle je l’empoignai pour le plaquer contre un parapet de sacs. Derrière moi apparût la tête chenue d’un commandant qui me hurla : ?Abats ce chien !?
C’était inutile. Je passai à la tranchée inférieure, qui grouillait d’Anglais. On se serait cru au milieu d’un naufrage. Quelques-uns lançaient des ?œufs de cane?, d’autres tiraient avec des colts, la plupart s’enfuyaient. Nous avions désormais l’avantage. Je pressais comme en rêve la détente de mon pistolet, alors que depuis longtemps, je n’avais plus de balles dans le canon. Un homme à côté de moi, jetait des grenades parmi les fuyards. […] Le sort du combat fut réglé en une minute. Les Anglais sautèrent hors de leur tranchée et s’enfuirent à travers champs. De la crête du remblai, un feu de poursuite furieux éclata. […] en quelques secondes, le sol fut couvert de corps étendus. C’était le mauvais côté de ce remblai.
Des Allemands, eux aussi, étaient déjà sur le glacis. Debout près de moi, un sous-officier, bouche bée, contemplait la mêlée. Je lui pris son fusil et tirai sur un Anglais engagé dans un corps-à-corps avec deux Allemands. Ceux-ci restèrent un instant stupéfaits de ce secours invisible, pour poursuivre leur avance aussitôt après. […] Chacun courait droit devant lui. […] Nous formions une meute… » (p. 214-215) ; « Une entrée d’abri m’attira. J’y jetai un coup d’œil et aperçus un homme assis en bas […]. De toute évidence, il n’avait encore aucune idée des changements de la situation. Je le pris tranquillement au bout du guidon de mon pistolet, mais au lieu de l’abattre aussitôt, comme la prudence l’ordonnait, je lui criai : ?Come here, hands up !? Il se leva d’un bond, me fixa d’un air ahuri et disparut dans l’ombre de l’abri. Je balançai une grenade derrière lui. » (p. 215) ; « Les bras en l’air, les Anglais se hâtèrent de fuir vers nos arrières, pour échapper à la fureur de la première vague d’assaut […]. J’assistai, pétrifié par l’attention, au premier choc, qui eut lieu tout près du bord de notre petit retranchement. Je vis ici qu’un défenseur qui, jusqu’à cinq pas, tire ses balles presque à bout portant sur son assaillant ne peut espérer que ce dernier lui fera grâce de la vie. Le combattant qui, pendant l’attaque, a eu un voile de sang devant les yeux, ne veut pas faire de prisonniers ; il veut tuer » (p. 216) [note 10 p. 745: « de 1920 à 1924, avec quelques variantes mineures, ce début de l’assaut donne lieu à un développement différent : ?De tous les trous d’obus surgissaient maintenant des formes brandissant des fusils, qui, les yeux révulsés et la bouche écumante, montaient en hurlant de terribles hourras à l’assaut de la position ennemie d’où les défenseurs sortaient par centaines en levant les bras. / On ne faisait pas de quartier […] Une ordonnance de Gipkens en abattit une bonne douzaine […]. / Je ne peux pas en vouloir à nos hommes de ce comportement sanguinaire. Assassiner un homme désarmé est une bassesse. À la guerre, personne ne m’était aussi odieux que les héros de café du commerce […]. / Par ailleurs, qui tire ses balles sur l’assaillant jusqu’à six pas de lui doit en supporter les conséquences. Durant l’assaut, un voile de sang flotte devant les yeux du combattant, ensuite il ne peut changer d’humeur. Il ne veut pas faire de prisonniers, il veut tuer. Il n’a plus d’objectif devant les yeux, il est entièrement sous l’emprise de violents instincts originels. C’est seulement lorsque le sang a coulé que se dissipent les brouillards de son cerveau ; il regarde autour de lui, comme s’éveillant d’un rêve profond. Alors, seulement, il redevient un soldat moderne, capable d’assumer une nouvelle mission tactique?. Modifié et abrégé en 1934 et 1935, ce passage trouve sa forme définitive en 1961 ».] « Comme il persistait, en dépit de mes sommations, […] nous mîmes fin à ses hésitations de quelques grenades et poursuivîmes notre route. […] J’en abattis un au moment où il bondissait hors du premier abri » (p. 218) ; « Le nettoyage à la grenade se déroula lentement, comme devant Cambrai » (p. 223) ; « Quand nous eûmes ainsi gagné cent mètres environ, la pluie toujours plus dense de grenades à main et à fusil nous contraignit de nous arrêter. La situation menaçait de s’inverser, elle commençait à ?sentir mauvais? ; j’entendis des apostrophes nerveuses : ?V’là les Tommies qui contre-attaquent !? […] ?Gare, mon lieutenant !? C’est justement dans les corps-à-corps de tranchées que de tels retournements sont redoutables. Une petite troupe de choc s’élance en tête, tirant et lançant ses grenades. Quand les grenadiers bondissent en avant, puis en arrière, pour échapper aux effets destructeurs de leurs propres projectiles, ils se heurtent aux suivants, qui suivent en masses trop compactes. Il n’est pas rare alors que le désordre se mette chez l’assaillant. Quelques-uns tentent peut-être de se replier à découvert et s’écroulent sous le feu des tireurs d’élite, ce qui aussitôt encourage considérablement l’adversaire » (p. 224) ; Combats à la grenade p. 246 ; « La scène s’animait de plus en plus. Un cercle d’Anglais et d’Allemands nous entourait, nous invitant à jeter nos armes. […] J’exhortai d’une voix faible mes voisins à poursuivre leur résistance. Ils fusillaient amis comme ennemis. […] À gauche, deux colosses anglais fourrageaient à coups de baïonnettes dans un bout de tranchée d’où s’élevaient des mains implorantes.
Parmi nous, on entendait aussi des voix stridentes : ?Cela n’a plus de sens ! Jetez vos fusils ! Ne tirez pas, camarades !? Je lançai un coup d’œil aux deux officiers, debout à côté de moi dans la tranchée. Ils me répondirent d’un sourire, d’un haussement d’épaules, et laissèrent glisser à terre leurs ceinturons » (p. 258) ; « Il ne me restait plus que le choix entre la captivité ou une balle. Je rampai hors de la tranchée et marchai d’un pas vacillant vers Favreuil. […] La seule circonstance favorable était peut-être la confusion, telle que d’un côté on échangeait déjà des cigarettes, tandis que de l’autre on continuait à s’entr’égorger. Deux Anglais, qui ramenaient un groupe de prisonniers du 99e vers leurs lignes, me barrèrent la route. Je plaquai mon pistolet sur le corps de l’un d’eux et appuyai sur la détente. L’autre déchargea son fusil sur moi sans m’atteindre » (p. 258-259).
Corps à corps : ? « L’un de ces intrus devait être un risque-tout. Il avait bondi sans se faire voir dans la tranchée et avait couru derrière la ligne des postes de guetteurs, d’où les hommes surveillaient les approches. L’un après l’autre, les défenseurs, que leurs masques à gaz empêchaient de bien voir, furent assaillis par derrière : après en avoir abattu un bon nombre à coups de matraque ou de crosse, il retourna, toujours inaperçu, jusqu’aux lignes anglaises. Quand on déblaya la tranchée, on retrouva huit sentinelles à la nuque fracassée » (p. 75).
Esprit de vengeance : après qu’un territorial terrassier, père de 4 enfants, ait été abattu : « Ses camarades sont restés longtemps encore aux aguets derrière les créneaux pour venger le sang versé. Ils pleuraient de rage. Ils semblaient considérer l’Anglais qui avait tiré la balle mortelle comme leur ennemi personnel » (p. 48).
Patrouilles dans le no man’s land : pistolet, grenades et poignards serrés entre les dents (p. 63) ; non utilisés dans ce cas. Une seconde sortie pour rien le lendemain (p. 64)
« En un rien de temps, nous nous glissâmes en tapinois jusqu’aux obstacles de l’ennemi […] ; quelques Anglais se montrèrent et se mirent à y travailler, sans repérer nos corps plaqués dans les herbes.
Me souvenant des mésaventures de la dernière patrouille, je soufflai aussi bas que possible : « Wohlgemut, balancez-leur une grenade. – Mon lieutenant, je trouve qu’on devrait les laisser d’abord un peu travailler. – C’est un ordre, aspirant ! »
[…] Mal à mon aise, comme qui s’est embarqué dans une aventure scabreuse, j’entendis auprès de moi le craquement sec du cordon qu’on tire et vis Wohlgemut, pour se découvrir le moins possible, lancer sa grenade comme une bille à ras du sol. Elle s’arrêta dans les broussailles, presque au milieu des Anglais, qui semblaient ne s’être aperçus de rien. Quelques secondes d’extrême tension passèrent. « Crrrac ! » Un éclair illumina des formes vacillantes. Braillant ce cri de guerre : « You are prisoners !« , nous bondîmes comme des tigres au sein de la nuée blanche. En quelques fractions de seconde, il se déroula toute une scène sauvage. Je braquai mon pistolet sur un visage qui luisait devant moi […]. Une ombre tomba à la renverse avec un hurlement nasillard, dans les barbelés. C’était un cri hideux […]. À ma gauche, Wohlgemut déchargeait son pistolet, tandis que Bartels, dans son énervement, lançait au petit bonheur une grenade au milieu de nous » (p. 79) ; au total donc, peu de baïonnettes ou de poignards en action…
La guerre comme travail : « Quand le fil téléphonique était coupé, j’étais chargé de le faire réparer par mon détachement d’intervention. Je découvris en ces hommes, dont j’avais à peine remarqué jusque-là l’activité sur le champ de bataille, une espèce particulière de « Travailleurs inconnus » dans la zone mortelle. […] rattacher deux bouts de ligne téléphonique : tâche aussi périlleuse que sans éclat » (p. 105-106).
Le plaisir du travail bien fait : « Notre grand orgueil était notre activité de bâtisseurs, où intervenaient peu les ordres de l’arrière… » (p. 56).
Crises de nerfs de Jünger : (p. 79) ; (p. 92) ; « […] l’obus s’était abattu juste au milieu de nous. A demi assommé, je me relevai. Dans le grand entonnoir, des bandes de cartouches de mitrailleuses, allumées par l’explosion, lançaient une lumière d’un rose cru. Elle éclairait la fumée pesante où se tordait une masse de corps noircis, et les ombres des survivants qui s’enfuyaient dans toutes les directions. […] Moi qui, une demi-heure auparavant, était encore à la tête d’une compagnie sur le pied de guerre, j’errais maintenant avec quelques hommes complètement abattus à travers le lacis des tranchées […]. Je me jetai à terre et éclatait en sanglots convulsifs, tandis que les hommes m’entouraient, l’air sombre » (p. 202-203).
Gaz : effets : p. 72-74 ; (p. 102).
Faim : (p. 107-108) ; (p. 162).
Boue : « Ce fut une matinée pitoyable. J’y pus constater une fois de plus qu’aucun tir d’artillerie n’est capable de briser la volonté de résistance aussi radicalement que le froid et l’humidité » (p. 155)
Notes psychologiques : (23 août 16) « […] un chauffeur s’écrasa le pouce en mettant son auto en marche. La vue de cette blessure me causa, à moi qui ai toujours été sensible à ce genre de spectacles, une espèce de haut-le-cœur. Si j’en fais mention, c’est qu’il est d’autant plus curieux que j’aie été capable de supporter dans les jours suivants la vue de graves mutilations. Cet exemple montre que dans la vie, le sens de l’ensemble décide des impressions particulières » (p. 81) ; « Il flottait au-dessus des ruines, comme de toutes les zones dangereuses du secteur, une lourde odeur de cadavres, car le tir était si violent que personne ne se souciait des morts. On y avait littéralement la mort à ses trousses – et lorsque je perçus, tout en courant, cette exhalaison, j’en fus à peine surpris – elle était accordée au lieu. Du reste, ce fumet lourd et douceâtre n’était pas seulement nauséeux : il suscitait, mêlé aux âcres buées des explosifs, une exaltation presque visionnaire, telle que seule la présence de la mort toute proche peut la produire » (p. 83) ; « C’est là, et au fond, de toute la guerre, c’est là seulement que j’observai l’existence d’une sorte d’horreur, étrangère comme une contrée vierge. Ainsi, en ces instants, je ne ressentais pas de crainte, mais une aisance supérieure et presque démoniaque ; et aussi de surprenants accès de fou rire, que je n’arrivai pas à contenir » (p. 83) ; « À partir de 7 heures, la place et les maisons voisines reçurent à des intervalles d’une demi-minute des obus de 150. Beaucoup d’entre eux n’éclatèrent pas : leur choc bref, énervant, secouait la maison jusqu’à ses fondations. Et pendant tout ce temps, nous restâmes dans notre cave, assis dans des fauteuils recouverts de soie, autour de la table, la tête entre les mains, à compter les intervalles des explosions. Les blagues devinrent plus rares, et pour finir, les plus intrépide eux-mêmes se turent » (p. 85) ; « Sous l’effet de violentes douleurs dans la tête et les oreilles, nous ne pouvions nous entendre qu’en braillant des mots sans suite. La faculté de penser logiquement et le sens de la pesanteur semblait paralysés. On était en proie au sentiment de l’inéluctable, de la nécessité absolue, comme devant la fureur des éléments. Un sous-officier de la troisième section devint fou furieux. » (p. 85).
Bat de la Somme, Combles (août 1916) (p. 83) civils ensevelis sous les décombres : « Une petite fille gisait devant un seuil au milieu d’une flaque rouge » (p. 84) « Un endroit violemment bombardé était le parvis de l’église détruite, en face de l’entrée des catacombes, de très anciennes galeries souterraines parsemées de niches où logeaient entassés presque tous les états-majors des unités combattantes. On racontait que les habitants avaient dégagé à coups de pioche, dès le début des bombardements, l’accès muré qu’ils avaient caché aux Allemands pendant tout le temps de l’occupation » (p. 84).
Grippe espagnole : (p. 238-239).
Volontaires de 1918 : « […] le volontaire de 1918, fort peu modelé, de toute évidence, par la discipline, mais brave d’instinct. Ces jeunes casse-cou aux tignasses farouches, en bandes molletières, se prirent violemment de querelle à vingt mètres de l’ennemi par ce que l’un d’eux en avait traité un autre de dégonflé… » (p. 242).
Frédéric Rousseau, mai 2010.