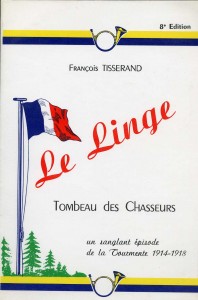Son grand-père était instituteur ; son père, cadre dans l’administration des finances ; sa mère, catholique, baptisa ses sept enfants en cachette du père. Né le 15 décembre 1884 à Largentière (Ardèche), Henri est l’aîné. Il fait de solides études, entre à l’ENS en 1905, est agrégé de lettres en 1910. Professeur au lycée, il est élu maire SFIO de Quimper en 1912, mais abandonne ses fonctions en 1914 avant de s’engager alors qu’il avait été réformé pour myopie (il écrit, le 10 mai 1914 qu’il a « conscience d’avoir fait pendant deux ans du service public en compensation du service militaire que j’ai manqué, d’avoir pendant deux ans servi mes idées, d’avoir construit quelques bâtisses qui ne périront pas et qui seront de quelque utilité à des gens misérables, et d’emporter pour la moudre dans ma retraite une ample moisson d’idées tristes et de mépris »). Il est alors marié depuis 1909 à une enseignante à l’école normale de jeunes filles, et ils ont un enfant. Sa guerre est interrompue par une longue convalescence à Quimper du 27 septembre 1914 au 19 mars 1916, pour fièvre typhoïde et graves complications. Il meurt avec le grade de sous-lieutenant, le 26 septembre 1918 à Auve (Marne).
Au front, il constate qu’il a des maladresses d’intellectuel et qu’il n’arrive pas à faire respecter son autorité aux hommes. Il faut dire que ces Bretons sont souvent ivres, ainsi au repos, début août 1916 : « Depuis cinq jours, tous mes héros sont saouls ; ils courent les villages voisins, raflent le pinard, tombent dans les fossés […] Ils sont là, gisants, recroquevillés, les bras en croix, le nez dans les feuilles sèches, poussiéreux, inertes et trois fois morts. C’est la rosée du matin qui les réveille vers 3 heures, ils rentrent se coucher en marchant sur les dormeurs. Se réveillent à la soupe, retournent au pinard, s’endorment, se réveillent, boivent encore, vomissent, retombent et recommencent et continuent. » L’intellectuel est heureux lorsqu’il peut retrouver sa « pauvre chère solitude » et ses lectures sérieuses pendant que les hommes font inlassablement la manille. Il remarque que la guerre n’est glorieuse que dans la tête de certains intellectuels : « Grande douleur, ardent patriotisme, haute vertu, il y faut du génie. On gravit une des plus hautes pentes de l’histoire, mais l’homme reste toujours près de sa bête : amour, vin, argent, sommeil et manille. C’est la pauvre vie qui continue, sous le grand ciel » (19 mars 1916). Et, le même jour : « Dans la France d’aujourd’hui, au bout de deux ans, la guerre ne rayonne plus. Elle est devenue une tranquille habitude pour ceux qui la lisent et pour ceux qui la font. »
« La guerre est devenue pour tous ces hommes un métier qu’ils se piquent de faire proprement. On a sa conscience de mitrailleur, on a sa conscience de canonnier. Ce n’est pas le sentiment de la patrie qui soutient ces simples âmes, ni à plus forte raison celui du droit ou de la justice, ni même la haine des Allemands, « de pauvres bonshommes qui ont la même misère que nous », mais c’est le souci du travail bien fait. […] Le bon soldat, c’est un bon ouvrier et le bon chef ne brandit pas une épée : c’est un bon économe, un bon comptable, un bon entrepreneur de voirie. S’il y joint quelque mépris du danger, et de la bonté, il peut aspirer à tout » (25 mars 1916). La réflexion sur le rôle du chef se poursuit : « Causer avec les hommes, c’est le devoir essentiel. Je ne cherche pas à leur donner du courage : le courage est une improvisation de la bataille. Ni à leur remonter le moral : ils n’en ont point. Je cherche à les tenir en gaîté. Je leur parle de leur permission, du Noël prochain. Je leur promets de la paille pour leur literie, du papier goudronné pour empêcher la pluie de tomber sur leur gourbi à travers les rondins de la toiture » (25/12/1916). Il ne faut pas « s’éterniser au bridge pendant qu’ils piochent dans la boue et sous la pluie », remarque le chef de section. Mais il n’hésite pas, revolver au poing, à faire le serre-file lors d’une attaque (13 décembre 1916) : « Les obus rugissaient, assenaient leur choc formidable, éclataient à droite, à gauche, devant, derrière, partout. On était suffoqués par la fumée et le phosphore, assourdis par ce déchaînement de tumulte, criblés par les paquets de terre, éblouis par les flammes, bousculés par des poussées d’air chaud, soulevés, jetés en bas, cent fois tués, toujours vivants. J’allais à travers cette fin du monde, ayant fait mon deuil et poussant toujours, mon pistolet à la main, les moins valeureux de mes moutons. »
En contraste, voici l’évocation d’une permission (24 janvier 1917) : « J’ai retrouvé ma maison de Quimper dans l’immobilité des choses heureuses. J’ai fait avec douceur le tour de chez moi et il me semblait reprendre une vieille vie juste à la minute où la guerre m’en a arraché. La paix verte de mon cabinet, la chambre claire qui sent l’eau de Cologne, mes livres que je reconnais, que je salue et qui me tentent, moi qui à la tranchée n’arrive plus à terminer une revue. Sur ma table, les lettres intimes de Renan, les cahiers de Wagner sur mon pupitre, et dans mon tiroir les brins de balai pour déboucher ma pipe. La chanterelle même de mon violon ne s’était pas rompue, mes pantoufles avaient l’air de se moquer de mes bottes, mon feu flambait et je me laissais aller jusqu’au fond de mon grand fauteuil, assoupli et mis au point par mes vieilles lectures. »
RC (d’après les notes de Nicolas Mariot)
*Claire Jacquelin, De la rue d’Ulm au Chemin des Dames. Histoire d’un fils, trajectoire d’un homme, 1902-1918, Paris, L’Harmattan, 2000