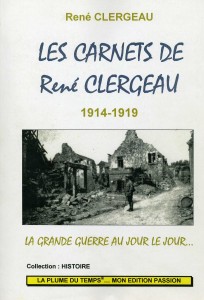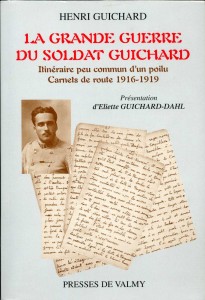Le témoin
Il est né le 23 décembre 1876 à La Bouillie, dans les Côtes-du-Nord. Il s’engage dans l’armée le 30 octobre 1896. Caporal le 2 avril 1898, il est nommé sous-officier le 18 novembre 1898. Le 30 octobre 1909, alors qu’il est au 70e RI de Vitré, il quitte l’armée. Il est mobilisé le 2 août 1914 au 76e régiment d’infanterie territoriale de Vitré. Nommé sergent-major le 4 août 1914, puis adjudant-chef le 25 septembre 1914, il gagne son galon de sous-lieutenant à titre temporaire le 10 novembre 1914. Nommé lieutenant à titre temporaire le 16 juillet 1915, il est confirmé à titre définitif dans ce grade le 12 juillet 1917. À la dissolution du 76e RIT en janvier 1918, il est affecté au 80e RIT de St-Lô. Après la guerre, il sera rattaché au 136e RI de St-Lô, puis passera comme capitaine au 71e RI de St-Brieuc. Directeur de banque à St-Brieuc, Joseph-Marie Clément y décèdera en 1968.
Le témoignage
Il nous a laissé trois petits carnets dans lesquels il a noté, au jour le jour, les événements, grands ou petits, auxquels il a participé de près ou de loin. Ils couvrent la période du 5 octobre 1914 au 20 novembre 1918. Ce sont de tous petits calepins (à peine 8×5) rédigés en une écriture serrée, parfois difficilement lisible. Auprès des annotations rapportées ici, apparaissent toutes les préoccupations matérielles quotidiennes qui sollicitent tout officier d’infanterie. On y trouve des listes de noms de soldats, des instructions pour les vaccinations, des quantités de matériel à prendre au parc, des adresses de parents, d’amis, etc.
Son journal débute par des notes brèves, parfois sèches, témoignages d’une période de mouvements peu propice à des travaux d’écritures. Ensuite, les comptes rendus prennent plus de consistance et introduisent toutes les préoccupations du moment, y compris les récriminations contre les injustices de promotions dans les grades et décorations dirigées vers les non-combattants des États-majors, si petits soient-ils.
L’ouvrage
La reprise des carnets de Joseph-Marie Clément aurait pu se suffire à elle-même. Cependant, p. 8 à 10, il se montre exceptionnellement très disert et relate l’attaque aux gaz du 22 avril 1915, événement que son régiment vécut d’abord en spectateur alors que le 76e RIT s’apprêtait à relever l’autre brigade de la 87e DIT bretonne, celle formée par les 73e RIT (Guingamp) et 74e RIT (St-Brieuc). Ces deux unités vont se trouver plongées dans la nappe de gaz et être décimées, ce qui obligera le régiment territorial vitréen à monter en ligne pour combler la brèche qui se formait, ce que narre le lieutenant Clément. Sur cette journée du 22 avril, les témoignages sont multiples, fort variés, voire contradictoires. Nous avons voulu ajouter au texte du lieutenant Clément (37 pages) un dossier sur cette fameuse journée du 22 avril (60 pages). En consultant les archives militaires de plusieurs pays ou des témoignages de combattants ayant subi cette attaque ou y ayant assisté, nous constatons que, selon la nationalité des témoins, elle fut « la journée » des Belges, celle des Bretons, celle des Anglais ou celle des Canadiens, de façon exclusive. Selon le lieu de la ligne de front, au nord et à l’est d’Ypres, les relations divergent et, surtout, ignorent que ce fut tout un ensemble de régiments de plusieurs nations qui fut touché et non seulement des régiments belges, bretons, anglais ou canadiens. Parmi ces unités, se trouvèrent des troupes qu’on n’évoque presque jamais, alors qu’elles furent sans doute les plus éprouvées : le 1er bataillon de marche d’Infanterie Légère d’Afrique, des « Joyeux » presque tous asphyxiés, et le 1er régiment de marche de tirailleurs algériens. Nous avons voulu présenter un dossier aussi complet que possible sur cette terrible journée et sur « cet incident fâcheux, sans résultat grave » (général Joffre), sans parti pris national ou régional. Nous savons ce que des régiments territoriaux bretons subirent ce 22 avril. Nous savons aussi qu’ils n’étaient pas seuls en ligne et qu’ils ne furent pas les seuls décimés.
René Richard
Carnets de guerre d’un officier d’infanterie territoriale. Lieutenant CLEMENT Joseph 76e RIT de Vitré et La première attaque aux gaz du 22 avril 1915, Plessala, Bretagne 14-18, 2006, 99 p.
Bellet, Pierre (1885-1971)
Le fils Bellet, né à Saint-Pargoire (Hérault) le 3 mars 1885, fut prénommé Albin Walter, mais on lui attribua le prénom usuel de Pierre. Devenu instituteur, il épousa une institutrice, et le couple exerça à l’école publique de Montagnac. Deux enfants étaient nés avant 1914. Pierre Bellet commença la guerre au 322e RI de Rodez avec le grade de sergent obtenu au service militaire. Adjudant dès le 29 août, il passa immédiatement au 96e ; il devint adjudant-chef en mai 1916. Il connut successivement les combats de Lorraine, puis de la Woëvre à la fin de septembre et de Belgique en hiver 1914-15. Cette année 1915 fut surtout celle de la Champagne : Beauséjour en mars ; Perthes-les-Hurlus en septembre. Il se trouva à Verdun et aux environs en 1916 et 1917, puis en Alsace. Intoxiqué par les gaz, il fut évacué à l’extrême fin de la guerre, le 27 octobre 1918. Survivant, il a tenu à garder trace écrite de ce qu’il avait vécu, mais il nous dit lui-même qu’il ne s’est appuyé que sur quelques notes et sur sa mémoire, et qu’il a écrit « dans le calme de la famille et longtemps après la tourmente » de telle sorte que ses « jugements ne risquaient plus d’être déformés par les terribles impressions du moment ». On peut le regretter car ce ne sont pas les conditions les plus favorables au témoignage. En effet, les dates précises sont rares dans son texte ; par contre la description des lieux et des épisodes est fort bonne, comme le montre la comparaison avec les informations contenues dans le JMO du régiment.
Le récit (100 000 mots d’après Marc dos Santos) présente d’abord des faits et des situations bien connus par ailleurs. La mobilisation, effectuée dans la « désolation générale » ; « de gentilles dames » qui distribuent médailles pieuses et formules de prières, ce que n’apprécie pas l’instituteur laïque ; les trains dans lesquels on boit et on chante. Très vite apparaissent les premières critiques des chefs : le général Taverna à la parole peu fiable ; le colonel qui n’aime pas les soldats du Midi ; les officiers qui volent les hommes sur la nourriture ; les lâches qui ne sortent pas de leurs abris, même pour leurs besoins naturels ; le général Grossetti, qualifié de « Boucher de Beauséjour ». Pierre Bellet décrit les blessures volontaires, les prisonniers allemands contents de leur sort, l’arrivée des bleus de la classe 14, les troupes marocaines à propos desquelles il se demande pourquoi ces hommes-là font cette guerre. Il pense que le grignotage du père Joffre est une tactique « absurde et criminelle ». Les attaques échouent : « le courage ne peut rien contre des fils intacts, une boue qui rend tout mouvement impossible, et des mitrailleuses bien cachées qui rentrent en action au moindre indice d’attaque ». Les sorties sont « précédées d’un bombardement de 75 sans effet et qui prévient charitablement les Boches que nous allons attaquer. L’ennemi ne riposte pas encore, mais dès que les hommes sortent des tranchées, les mitrailleuses les déciment et les marmites rappliquent. Finalement, les hommes ne veulent plus marcher. » Alors, les officiers eux-mêmes fournissent de faux rapports, comme l’a très bien montré Jean Norton Cru. Des ententes tacites se produisent dans la guerre des mines qui éclatent à heure fixe, ce que le JMO ne contredit pas (SHAT 26 N672/5) et dans le respect de ceux qui, dans les deux camps, à découvert, réparent les systèmes défensifs.
Plus rares, sans être uniques, ces notations sur les instituteurs mal vus par les officiers supérieurs ; sur les permissions au cours desquelles on espère qu’il va se produire « un événement que l’on ne s’explique pas, mais qui nous permettra de ne plus revenir au champ d’honneur, au champ de la mort » ; sur l’arrière-front où se pratique le sexe à deux niveaux : « Ayant à communiquer le rapport journalier à un capitaine princièrement logé chez une baronne, je le trouve en caleçon, sortant de la chambre de son hôtesse, tandis qu’au rez-de-chaussée, l’ordonnance lutinait la soubrette de la maison » (version édulcorée par le petit-fils de l’adjudant ; l’original est plus cru et donne les noms des personnes). Pierre Bellet évoque encore des exécutions, fruits d’une justice expéditive ; des hussards peu enclins à remuer la terre pour aménager leurs tranchées ; des chiens dressés pour effectuer des liaisons, mais qui se retrouvent tous aux cuisines pour récupérer quelques morceaux… Terminons sur cette situation décrite vers la fin de la guerre dans un village de Lorraine où « des hirondelles avaient construit leur nid. Au moment des relèves, nous nous passions comme consigne de respecter ce nid. C’est avec le plus vif intérêt que j’ai suivi la vie de ces hirondelles. Je les ai vues couver et, quand je suis revenu, à la relève suivante, les petites hirondelles s’essayaient à voler et nous quittaient ensuite. » Encore une pièce à glisser dans le dossier de la transformation des combattants en brutes.
Rémy Cazals
*Marc dos Santos, Les mémoires de la Grande Guerre de Pierre Bellet, adjudant au 96e régiment de Béziers, mémoire de master, Université de Toulouse Le Mirail, 2007, 287 p. Ce mémoire contient la transcription intégrale des cahiers de Pierre Bellet.
*Ma guerre de 14, par Justin Bellet, Les Amis de Montagnac, 2009, 320 p. Le texte original a été « lissé » par Jacques Panis, petit-fils de l’auteur pourvu par erreur du prénom de Justin.
Cuny, née Boucher, Marie (1884-1960) et Cuny, Georges (1873-1946)
1. Les témoins
Georges Cuny naît le 23 novembre 1873 à Gérardmer (Vosges). Marie Valérie, dite Mimi, Boucher est née quant à elle le 19 février 1884 à Docelles (Vosges). Tous deux sont issus de grandes familles d’industriels tisserands et papetiers possédant plusieurs usines en Lorraine et en France. Ainsi, par mariage et cousinages, ils sont connectés au milieu des industries papetières et des tissages dans tout le département des Vosges et au-delà (citons ainsi les Laroche-Joubert, Schwindenhammer, Mangin, Gény, Perrin ou Michaut). Mariés le 26 avril 1906, trois enfants naissent de leur union : André (1907), Noëlle (1909) et Robert (1910). En août 1914, Georges est mobilisé comme capitaine au 5e régiment d’artillerie de Campagne. Maurice Boucher, lieutenant au 349e RI et Georges Boucher, adjudant dans un régiment de chasseurs à cheval, frères de Marie, sont également mobilisés. Dès lors, Célina Boucher accueille chez elle Marie, sa fille et ses trois enfants ainsi que sa belle-fille Thérèse Boucher, elle-même mère de 2 enfants. Ce resserrement familial pour endurer la guerre est démonstratif de cet esprit de famille qui va teinter l’échange d’une correspondance assidue entre les époux Cuny, reproduite du 4 août 1914 au 29 juin 1918. Frères et beaux-frères reviennent sains et saufs de la Grande Guerre et Georges Cuny est démobilisé le 14 janvier 1919. Il poursuit sa carrière d’industriel et, en 1928 acquiert les Tissages Mécaniques d’Orchamps (Jura) qu’il dirige, puis la Société Française de Pâte de Bois. Il décède le 8 septembre 1946 à Cornimont (Vosges). Marie meurt à Cornimont (Vosges) le 24 février 1960.
2. Le témoignage :
Favre, Marie, Reviens vite. La vie quotidienne d’une famille française pendant la guerre de 14, chez l’auteur, 2012, 556 pages.
Marie Favre, 21e des 28 petits-enfants de Georges et Mimie, publie une partie de la correspondance échangée et reçue par les époux (540 lettres de Marie, 350 lettres de Georges, complétée d’un millier de lettres reçues de la famille) dans une édition familiale, replacée dans un contexte historique et sommairement annotée.
Le 2 août 1914, Georges Cuny est mobilisé comme capitaine au 5e régiment d’artillerie de Campagne dont le dépôt est à Besançon. Au commandement de la 45ème batterie, il participe aux divers combats de ce régiment. Il est blessé le 31 octobre 1914 alors qu’il est en batterie dans le secteur de Braine (Aisne) et est proposé pour la Légion d’Honneur avec la citation suivante : « A dans l’attaque de nuit du 31 octobre au 1er novembre énergiquement soutenu et excité le moral et l’ardeur de ses hommes continuant à tirer sous le feu repéré d’une batterie allemande. Gravement blessé à la fin de l’action par un projectile mettant hors de combat tous les canonniers d’une même pièce, a demandé avec instance qu’on s’occupa d’abord des blessés de sa batterie ». Hospitalisé à Fleury-Meudon, il revient à sa batterie le 6 décembre dans le secteur de Soissons. Le 7 mars 1917, il écrit à Marie : « Pour te faire plaisir, je me suis laissé proposer pour le grade de chef d’escadron », grade qu’il atteint effectivement le 10 mai 1917. Il est alors affecté au 1er groupe (puis au 2e) du 260e RAC qui stationne à Vieil-Arcy, au sud du Chemin des Dames. En juin 1917, il part dans les secteurs de Pont-à-Mousson et de Toul, qu’il qualifie de calmes. Le 4 janvier 1918, le 2e groupe quitte Bicqueley (Meurthe-et-Moselle) pour Verdun, secteur de Douaumont. Le 12 mars 1918, alors qu’il se trouve à son PC, il est victime d’un bombardement à gaz et légèrement touché aux yeux, ce qui l’éloigne un temps du front, du fait d’une courte hospitalisation à Bordeaux, où sa femme vient le rejoindre. Il rejoint son groupe de batteries le 20 avril 1918 et fait plusieurs mouvements pour contrer l’offensive allemande du printemps 1918 (secteur de Senlis-Villers-Côtterets) puis reviens sur l’Aisne en juin. La dernière lettre de lui reproduite est datée du 29, alors que son groupe appuie une attaque dans le secteur du ravin de Cutry, au sud d’Ambleny (Aisne). Le reste de son parcours est alors évoqué par le biais du JMO de son régiment et des grands évènements de l’époque, collectés par la presse.
Marie Cuny quant à elle témoigne de Docelles dans les Vosges, à quelques kilomètres d’Epinal où elle a resserré les liens familiaux. Argentée et libre de ses mouvements – conductrice acharnée de sa propre voiture – elle parcourt le département mais prend également des vacances à Angoulême ou fait quelques visites parisiennes ou nancéennes, ce qui lui permet de donner des nouvelles de la grande famille industrielle.
3. Analyse
Pour plusieurs raisons liées à une correspondance incomplète (du 15 septembre 1915 au 29 juin 1918) et censurée (même si Georges parvient à tromper la censure en écrivant certains toponymes à l’envers), mais aussi par un regard industriel distancié du fait de son statut militaire, l’analyse des courriers de Georges Cuny n’atteint pas l’intérêt contenu dans les lettres de son épouse Marie. En effet, au fil des 540 lettres reproduites, la vie, l’activité économique et les devenirs des militaires mobilisés dans la grande famille industrielle des Cuny-Boucher sont évoqués dans une correspondance de Marie d’une grande liberté de ton et une censure très relative. Dès lors, ce témoignage, en forme de journal d’une civile au statut très particulier, à l’intérieur d’un département concerné par la ligne de front, devient un formidable miroir de l’intimité d’une famille d’industriels vosgiens dans la Grande Guerre. En effet, dans la littérature testimoniale de ce département, jamais la parole d’une femme d’industrielle n’avait été publiée [si l’on excepte les 43 jours de guerre (août et septembre 1914) à Saint-Dié de la comtesse Bazelaire de Lesseux publiés dans le bulletin de la Société Philomatique Vosgienne de 1964. Dans ce département, le corpus publié des témoins civils est encore lacunaire. Aussi, la publication des lettres de Marie Cuny permet d’obvier à cette sous-représentation testimoniale mais aussi sociale. Si la publication du journal de guerre de Clémence Martin-Froment avait permis d’illustrer le témoignage d’une civile plébéienne dans la zone occupée du département des Vosges (voir dans ce dictionnaire sa notice in http://www.crid1418.org/temoins/2011/09/26/martin-froment-clemence-1885-1960/), la publication des lettres de Marie Cuny permet d’appréhender la vie d’une industrielle de l’arrière dans ce même département. Alors est illustré le témoignage d’une femme en avance sur la génération de la Belle Epoque, fortunée (elle a trois bonnes à son service), libre et moderne, d’une strate sociale qui n’avait pas témoigné jusqu’alors. Marie nous éclaire ainsi sur une quantité de questionnements traitant à l’échelle sociale, la vie quotidienne, l’économie industrielle et les affres de l’occupation militaire française de l’arrière-front des Vosges. La famille, possédant plusieurs usines dans les secteurs de la papeterie et du tissage, mamelles économiques du département, tente de limiter les dégâts dans une économie industrielle gravement obérée par la guerre. La mobilisation des ouvriers, le gel des marchés puis leur nécessaire réorientation vers une économie de guerre, les restrictions, les réquisitions multiples (décrites page 58), l’appauvrissement des matières premières et la dévolution des énergies aux usines travaillant directement pour la défense (expliquée page 198 et car le classement en usine de guerre donne des avantages sur les approvisionnements (page 424)) font de la gestion des entreprises une préoccupation quotidienne. Georges, du front, ne peut gérer correctement ses avoirs, et les échanges épistolaires ne sont pas satisfaisant pour la marche des affaires. Il s’en ouvre dans un courrier du 5 octobre 1916 : « Tu serais bien gentille, ma chérie, de m’accuser réception, au fur et à mesure des lettres que tu reçois de moi. Je t’y demande quelquefois des renseignements que tu oublies de me donner et je crains qu’elles ne te parviennent pas toutes. S’il en était ainsi, j’aimerais bien en être prévenu, afin de ne pas t’écrire des choses relatives aux affaires, il est inutile que l’Etat mette le nez là-dedans. C’est comme PM, il aurait pu se dispenser de m’envoyer tout l’inventaire. Cela peut être excessivement dangereux par ce temps de guerre où on ouvre beaucoup de correspondance. En tous cas, je ne le lui renverrai pas. Un paquet de cette importance serait certainement ouvert, car on se demande quels documents si importants peut avoir à envoyer un officier du front » (page 313). Car la guerre n’est pas propice à la confidentialité qui sied à toute gestion d’entreprise : les déclarations de la nouvelle imposition sur le revenu mise en place en novembre 1916 en est un révélateur : « J’ai reçu la feuille d’avertissement pour l’acquit de l’impôt sur le revenu, nous avons 160 francs à payer, ce n’est donc pas cela qui nous appauvrira beaucoup. Je vais dire au bureau de Cornimont de payer le percepteur. Mais tu vois comme la loi est bêtement faite, on fait soi-disant une déclaration sous enveloppe fermée qu’on adresse au directeur des contributions pour que personne du pays ne la connaisse, mais le percepteur vous envoie un avertissement où tout est nettement indiqué, de sorte que les petits commis que les percepteurs ont souvent chez eux et qui sont du pays pourront répandre dans le village tout ce qu’ils savent » se plaint Marie (page 333). D’autant que les Cuny, possédant une usine en Russie, à Dedovo, la situation du grand allié préoccupe comme leur Révolution. Le 1er mai 1918, Marie dit à Georges : « Là-bas en plus de la guerre et des Boches, il y a la révolution qui continuera à bouillir pendant quelque 10 ans. Peut-être arriverons-nous à l’éviter ici ? » (page 476). En 1919, les cartes auront d’ailleurs été particulièrement remaniées tant en terme de production que de propriétés industrielles. Ainsi, Marie Cuny n’a aucune complaisance pour un jeune capitaine d’industrie appelé Marcel Boussac qui monte un empire et qui rachète des usines qui vont, pour elle, immanquablement devenir des « nids à grèves » (page 358). Elle déplore le gâchis (page 178), les saccages, et les pillages de ses usines par la troupe française, notamment en septembre 1914 (pages 37 et 41) mais aussi en novembre 1915 (page 169) et se plait aussi du comportement « des troupes du midi » (pages 37, 42 et 129). Parfois démoralisée par la guerre, elle en craint les conséquences sociales : « Grand Dieu ! Si tous les soldats reviennent aussi flemmards et buveurs après la guerre, ce sera terrible. Il y aura une révolution après la guerre, car tous ces hommes (sauf ceux du vrai front, de la ligne de feu) (…) depuis un an n’ayant rien fait ou si peu, bien nourris, vont trouver étrange en rentrant d’être obligés de travailler pour gagner leur pain et celui de leurs femmes et enfants et les 8, dix ou douze heures de travail qu’ils seront obligés de fournir leur sembleront bien dures et amères » (page 120). Ce sentiment est partagé par Georges qui confirme l’intérêt de faire réaliser par le commandement « toutes sortes de travaux de terrassement, je pense pour occuper nos hommes, qui sans cela deviendraient de fameux paresseux. C’est une très bonne chose et c’est essentiel car enfin la plupart de ces braves gens seront obligés de travailler en revenant chez eux et il ne faut pas qu’ils en perdent l’habitude » (page 164). Marie ne déclare-t-elle pas à Georges le 17 avril 1916 : « Sois tranquille, se sera encore nous qui seront forcés de payer les frais de la guerre » ? (page 235). Plus loin, « mais c’est inévitable que des petits jeunes gens qui ont été laissés seuls maîtres un grand moment n’acceptent plus de réprimandes et deviennent de petits coqs. On aura bien du mal à reprendre la direction. C’est la même chose avec les bonnes » (page 289). Marie estime que la guerre est teintée de lutte sociale ; le 11 février 1916, elle note que « les civils n’ont qu’à se taire pour le moment et je crois que certains militaires sont heureux en ce moment de prendre leur revanche sur les industriels qui les écrasaient parfois de leur luxe en temps de paix » (page 210). La guerre modifie la société et les comportements : « Quand tu reparles du jour de notre mariage [1906 ndr] et de ta naïve petite femme, mon Géogi, c’est vrai que j’étais bien loin d’être aussi savante que toutes les jeunes filles de maintenant, toutes nos cousines élevées à l’américaine » (page 292), méthode qu’elle va appliquer à sa propre fille Noëlle. Mais avec une réserve toutefois : « car je veux une fille soumise, non pas comme les jeunes personnes modernes. J’en ai vu encore à Angoulême, gamine de 18 ans, qui avait si bien l’air de mépriser sa mère, dédaigner ses idées et conseils et j’ai entendu un ménage (…) dire de leur fille âgée de 9 ans, qu’elle commande dans la maison, Mademoiselle invite ses amies pour tel jour et en avertit ensuite sa mère, et d’autres petits détails de ce genre. Il faut de l’initiative aux garçons, mais je déteste l’indépendance chez les jeunes filles et, avec l’intelligence de Noëlle, ce serait désastreux » (page 333). Cette difficulté à élever les enfants semble générale ; Pauline Ringenbach écrit à Marie, sa patronne, le 19 juillet 1917 ; « Il y a passablement des mariages, qu’on ne dirait pas que l’on est en guerre, quoique cela devient plutôt ennuyeux de vivre depuis trois ans toujours la même chose, les femmes en sont bien lasses, car elle ont vraiment du mal avec les enfants sans pères depuis si longtemps » (page 422). Un peu avant en 1916, « dans toutes les banques en ce moment il faut faire joliment attention, ils n’ont que des galopins de 16 ans, qui n’ont pas la tête à ce qu’ils font » (page 299). Elle-même se prend à dire : « si j’étais pauvre, je serais rudement socialiste » ! (page 315).
La guerre lui pèse pourtant. Une femme n’est-elle pas morte « dans un accès de neurasthénie due à la séparation » d’avec son mari (page 324) ? Aussi les artifices pour faire revenir son mari, au moins pour un temps, sont multiples. Elle écrit à Georges en 1916 : « Tu sais qu’on a aussi des permissions supplémentaires dites du berceau pour les naissances d’enfants. Quel dommage que je ne sois pas assez forte, on aurait peut-être encore eu le temps d’avoir une permission de berceau avant la fin de la guerre, mon pauvre Géogi » (page 259). Car la durée de la guerre est une préoccupation récurrente et les pronostics, finalement fantaisistes, sont sans fin, jusqu’aux derniers mois du conflit (pages 58, 96, 142, 165, 278, 288, 289, 302, 390 (quand la fin de la guerre est garantie pour 1917 !) ou 424). Le 1er août 1916, Georges dit à Marie, « il y aura demain deux ans que je suis parti pour Besançon. Nous ne prévoyions certes pas à ce moment-là que nous resterions si longtemps séparés et je crois d’ailleurs que, si les Français avaient pu prévoir la longueur de la guerre, ils seraient partis avec moins d’enthousiasme » (page 288). Elle-même revient en 1916 sur son comportement le 2 août 1914, non détachable de son rang social : « Voir moi mari partir m’oppressait à un tel point que je n’ai pas eu le courage, tu te rappelles, de t’accompagner à la gare. Ce n’était vraiment pas chic et depuis je me le suis tant reproché mais je n’aurais pas pu arrêter mes larmes et il valait peut-être mieux ne pas te montrer cette faiblesse, ni la faire voir au public » (page 289).
Georges quant à lui, officier du rang, fait écho à une réflexion reçue de Maurice Boucher, son beau-frère, qui estime en 1915 qu’ « il y a autant de différence entre un officier de troupe et un officier d’E.-M. qu’entre un ouvrier et un comptable » (page 143) et se plaint d’« une maladie aigüe qui sévit même sur le front, et bien entendu pour les officiers de l’active, c’est l’avancite, et cette maladie-là fait beaucoup de mal (page 171) ».
Plusieurs autres thématiques pouvant être dégagées de cette lecture, Reviens vite concourt donc à l’analyse de l’histoire économique et sociale du département des Vosges pendant la Grande Guerre, et au-delà de la vie quotidienne d’une famille industrielle à l’arrière du front, et érige Marie Cuny en témoin de référence.
La généalogie de la famille Cuny-Boucher est consultable sur http://jh-as.favre.pagesperso-orange.fr/site%20cuny-boucher/genealogie%20cuny-boucher.htm
Yann Prouillet – décembre 2012
Aubert, Frédéric (1897-1940)
AUBERT Frédéric, Avec ma section, La bataille de la Marne du sous-lieutenant Fred Aubert (27 mai 1918-15 août 1918), Association Bretagne 14-18, 2011, 65 pages (21×29,5) – 54 pages de texte du carnet de guerre de Fred Aubert et 10 pages consacrées à la biographie d’Octave Aubert, père (1870-1950) et des trois enfants, Fred (1897-1940), Louis ( 1900-1945) et Germaine (1908-2011) – I.S.B.N : 2-913518-47-8.
1 – Le témoin
Frédéric, Louis, Charles Aubert est né le 19 novembre 1897 à Saint Brieuc. Dans sa famille on appelait Fred cet aîné d’une fratrie de trois enfants et ce prénom lui resta. Il suivit sa scolarité à Saint Brieuc, puis à la faculté de droit de Rennes, se préparant à devenir avocat. Appelé de la classe 17, il rejoint, au mois d’août 1916, la caserne du 47e RI à Saint Malo. Le 30 avril 1917, il est nommé aspirant et est envoyé en renfort toujours au 47e. Arrivé au front vers la fin du mois de mai, Fred Aubert participe avec son régiment, à partir du 15 juin 1917, à la deuxième bataille défensive de Verdun entre les bois des Fosses et le bois des Caurières. Le 47e reste sur le front de Verdun jusqu’au 20 mai 1918. Après l’offensive allemande du 27 mai 1918, le régiment malouin fait partie du dispositif de défense qui, dans le secteur de Dormans, contient l’avancée allemande. Le 24 juin, l’aspirant Fred Aubert est nommé au grade de sous/lieutenant. Le 14 juillet 1918, les Allemands lancent la 4e bataille de Champagne ; pendant cinq jours, les 14, 15, 16, 17 et 18 juillet, le 47e fait face aux attaques. Puis, à partir du 19 juillet, il prend part à la poursuite. Fred Aubert est alors chef de section. Le 15 août, intoxiqué par les gaz, il est évacué sur l’ambulance de Sézanne, puis transporté à l’hôpital de Périgueux où il se rétablit lentement pendant deux mois. À la suite d’une courte convalescence dans sa famille, il rejoint, après l’armistice, son régiment cantonné à Mutzig et entre dans Strasbourg le 22 novembre, puis en Allemagne.
2 – Le témoignage
Avant de présenter ce témoignage, il faut parler de la suite de la vie de Fred Aubert. Homme influent de Saint-Brieuc entre les deux guerres, cet avocat laïque et républicain mais farouchement indépendant, est de nouveau mobilisé en 1939, comme commandant de la 3e compagnie au 19e RI. Cette unité se trouve face aux Allemands dans les Ardennes lors de leur offensive éclair le 10 mai 1940. Le 14 mai, alors que, partout, les troupes françaises reculent, le capitaine Fred Aubert, menacé d’encerclement, refuse de retraiter et prend l’initiative d’une contre-attaque au cours de laquelle il est tué d’une balle au front. La guerre va être cruelle pour ses parents car leur second fils, Louis Octave, très engagé dans un réseau de renseignements, sera dénoncé, arrêté, torturé, déporté au camp de Sandbostel où il décédera juste après l’arrivée des Alliés. Il ne restait plus aux époux Aubert que Germaine qui fut, elle aussi, un personnage important de réseaux de renseignements et d’évasions et qui vécut jusque 103 ans. Dès 1945, Octave Aubert, célèbre éditeur breton, forma le projet de publier le court carnet de guerre laissé par son fils aîné Fred où il relatait, jour après jour, ses combats sur la Marne et au nord du fleuve, du 27 mai au 15 août 1918, jour de son évacuation. Première édition, discrète, d’une cinquantaine d’exemplaires distribués dans la famille ou chez les proches. L’association Bretagne 14-18 qui avait pu se procurer un de ces exemplaires put obtenir des dernières nièces de Fred Aubert l’autorisation de rééditer ce témoignage.
Du 27 mai au 15 août 1918, l’aspirant puis le sous-lieutenant Fred Aubert avait consigné les événements de chaque journée de combat au sein du 47e RI. A partir du 15 juillet, jour de l’attaque allemande, le texte se densifie, devient plus détaillé, et il va le rester jusqu’au 15 août. Le 47e est alors très sollicité et participe presque quotidiennement à de très âpres combats. Cette guerre de juillet-août 1918 relatée par Fred Aubert n’a plus rien à voir avec la guerre de positions. Le front se modifie sans cesse, au fur et à mesure des assauts allemands de la mi-juillet puis de leurs reculs progressifs. Il est recommandé au lecteur de ce carnet de posséder une carte pour suivre les incessants mouvements des belligérants.
3 – Analyse
Ce récit est un document brut, écrit à chaud. Fred Aubert, qui s’avèrera plus tard comme un auteur de talent, ne se prête pas ici à un exercice de style. Il relate, de façon parfois haletante, presque sans pause, les péripéties d’un combat sans merci. Ce ne sont que des phrases très brèves, ce n’est qu’un récit saccadé qui rend bien compte de ces violents engagements sporadiques en rase campagne, souvent confus. Les soldats français sont certes mus par la perspective de la victoire, après les journées indécises de la mi-juillet, mais les Allemands s’accrochent et ne cèdent que pied à pied. La journée du 28 juillet est narrée comme une forme de match (Fred Aubert fut un footballeur passionné ; le stade de Saint-Brieuc porte son nom), sans répit. Le sort de la bataille reste longtemps indécis. Les pertes sont épouvantables des deux côtés et Fred Aubert ne cache rien de ces horreurs. Il avoue ses fatigues, ses incertitudes dans un affrontement impitoyable de presque tous les instants mais ne dévoile rien de ses sentiments qu’ils soient de peur, de compassion ou de haine. Il ne se met pas en valeur, il se contente de décrire sans fioritures et sans apprêt de style. Il est tout entier impliqué dans la bataille et ne décrit que la bataille. La sécheresse de ce petit récit trépidant et captivant fait encore plus approcher l’épouvante de ces journées décisives et finalement assez mal connues où ce qu’on appela la poursuite fut loin d’être une simple promenade militaire pour les troupes alliées. Fred Aubert n’envisageait pas de publier ce petit texte, rangé dans ses archives. Les circonstances firent que son père, pour honorer sa mémoire, le sortit d’un oubli programmé par l’auteur.
René Richard
Voivenel, Paul (1880-1975)
1. Le témoin
Son père, d’origine normande, était capitaine de gendarmerie dans les Hautes-Pyrénées, ce qui explique la naissance de Paul Voivenel à Séméac, le 24 septembre 1880. Il fait des études de médecine à Toulouse et se spécialise dans les maladies mentales, montrant aussi un vif intérêt pour la littérature et le rugby. Lors des manœuvres de 1913, il sauve la vie de l’attaché allemand von Winterfeldt, victime d’un accident, ce qui lui vaut une décoration prussienne qu’il renvoie lors de la déclaration de guerre. Pendant la guerre, il devient médecin de bataillon au 211e RI de Montauban, puis au 220e. Il connaît les premiers échecs de 1914, la Marne, les attaques stériles de 1915, puis deux engagements à Verdun, en février et septembre 1916. Il est alors nommé médecin chef de l’ambulance 15/6, puis d’une ambulance Z, spécialisée dans les soins des victimes des gaz.
Après la guerre, il reprend son activité de médecin neuropsychiatre à Toulouse, rédigeant de nombreuses chroniques médicales, littéraires et sur le rugby (il est président d’honneur de la Fédération française de ce sport). Le monument aux morts de son village d’adoption, Capoulet-Junac (Ariège), dû au ciseau de son ami Bourdelle, est inauguré par le maréchal Pétain en novembre 1935. Grand notable, ses sympathies le portent vers le maréchal au pouvoir. Ses œuvres du début des années 40 en témoignent, mais il n’est pas inquiété après la chute du régime.
2. Le témoignage
Jean Norton Cru donne à Paul Voivenel une place dans Témoins. Il cite quatre livres de réflexions, écrits en collaboration : Le courage (1917) qui ignore les meilleurs témoins, cite quelques bons et beaucoup de médiocres ; La psychologie du soldat (1918), plus concret, mais marqué par un nationalisme superficiel ; Le cafard (1918), affaibli par la prise en compte des héros de romans ; La guerre des gaz (1919), journal d’une ambulance Z, étude émaillée de souvenirs personnels sur le service de santé en général. Jean Norton Cru estime que Voivenel a eu raison de publier ces volumes, mais qu’il n’a pas fait montre d’assez d’esprit critique, qu’il s’est laissé prendre aux pièges d’une littérature verbeuse et irresponsable. Sa conclusion : « Nous aurions beaucoup gagné, et Voivenel aussi, à ce qu’il s’en tînt à sa 67e division et à son poste de secours. »
Voivenel s’est félicité des remarques positives de JNC et a admis ses critiques : « Il fait à mes livres de guerre les reproches que précisément je leur ferai moi-même. » Mais il avait tenu un carnet personnel et, piqué au vif par la conclusion de JNC, il le publie entre 1933 et 1938, en quatre volumes faisant un total de 1256 p., sous le titre Avec la 67e DI de réserve (Paris, Librairie des Champs Elysées), recueillant les appréciations favorables de Genevoix, Dorgelès, et Pétain. Gérard Canini en a donné les passages concernant Verdun, tirés des tomes 2 et 3, dans Paul Voivenel, A Verdun avec la 67e DR, Presses universitaires de Nancy, 1991, 186 p.
3. Contenu
Le docteur Voivenel décrit les illusions des premiers jours, puis l’adaptation à la guerre des tranchées. En plein accord avec Jean Norton Cru et tant d’autres bons témoins, il note qu’il n’a pas observé de blessure par baïonnette. Pour médecins et infirmiers, les périodes calmes alternent avec l’afflux de blessés qu’on ne peut soigner que sommairement (voir Albert Martin et Prosper Viguier). Il note la distribution de gnôle avant l’attaque et le fait qu’à ce moment-là, « ne pas obéir serait se déshonorer ». Il critique les attaques stupides pour alimenter le communiqué : « Pour ne rien obtenir on s’est entêté à sacrifier des hommes. » Voivenel s’en prend aux officiers d’état-major « tirés à quatre épingles » et aux décorations distribuées de manière scandaleuse. Le fantassin, quant à lui, « veille, il creuse, il va en patrouille, il vit en permanence au milieu des dangers qui excitent l’imagination des autres. Il ne se croit pas héroïque, mais il plante des piquets en avant de la tranchée, installe des réseaux de fil de fer, porte sur le dos d’énormes rondins, le charbon, la chaux, va au ravitaillement à une heure de marche par tout temps, se fait par surcroît tuer dans des assauts dont le pourcentage de pertes est presque connu à l’avance, et… passe devant le Conseil de guerre à la moindre vétille. » Le docteur note des blessures ou maladies « bidon » quand ça se gâte, mais il admet la « peur morbide » et défend toujours les soldats : il est fier qu’aucun n’ait été fusillé au sein de la 67e division.
Il critique les embusqués (notamment certains confrères toulousains, ainsi que les journalistes) et le bourrage de crâne, donnant à Barrès le titre de « littérateur du territoire ». Il partage la mauvaise appréciation de Jean Norton Cru sur Barbusse et Remarque, mais épargne son ami Dorgelès. D’ailleurs, les légendes peuvent avoir l’utilité de maintenir le moral. Se retrouver entre Méridionaux, et parler occitan, cela peut avoir le même effet. Mais, au final : « De près, c’est ignoble. C’est affreux la guerre. »
Rémy Cazals
Clergeau, René (1886-1920)
René-Louis-Paul Clergeau, né le 20 octobre 1886 à Sainte-Lheurine en Charente Inférieure, aujourd’hui Charente Maritime. Il est issu d’une famille d’instituteurs. Son père, Adolphe, et sa mère, Louise berthe Lebrun exerçant tous deux cette profession, comme lui-même. La guerre déclarée, il est affecté au 206e RI de Saintes, régiment dans lequel il est chargé du ravitaillement. Le 8 août 1911, il épouse à Saintes Augusta Lacan, elle même institutrice (puis professeure d’anglais, de français et de mathématique, et qui s’éteindra le 2 avril 1977), avec laquelle il a un fils né le 6 avril 1918. René Clergeau décède le 9 mars 1920 des suites des gazages reçus en 1918.
Clergeau, René, Les cahiers de René Clergeau, 1914-1919. La Grande Guerre au jour le jour… Villebois, La Plume du Temps, collection Histoire, 2002, 337 p.
René Clergeau, instituteur charentais affecté au 206e RI et chargé du ravitaillement, a reproduit dans 6 carnets de guerre, écrits au crayon de papier, parfois en style télégraphique, de format 110×170 mm, qu’il appelle affectueusement ses « chers petits compagnons », sa campagne contre l’Allemagne, du 12 août 1914 au 24 février 1919. Il dit dans l’introduction de ceux-ci : « Ce carnet est pour ma femme, pour mon fils, pour moi si je reviens » et nous renseigne sur sa volonté de transmettre : « J’ai donc écrit au jour le jour, tout simplement les évènements survenus durant la campagne, soit dans mon régiment, soit à moi personnellement. Je ne cherche pas à faire le plus petit étalage sensationnel de faits plus ou moins authentiques n’ayant qu’un but, celui de donner un semblant de valeur à leur acteur. (…) D’ailleurs, je ne fais point un roman mais un simple recueil qui devra aider pour ma mémoire dans l’avenir » (page 8).
Principalement affecté en Lorraine, il subit de plein fouet la bataille de Verdun dans le secteur d’Avocourt et renforce parfois d’autres secteurs en ébullition, notamment au cours de la deuxième bataille de la Marne. Caporal puis caporal-fourrier, il traverse toute la guerre sans aucune blessure – sauf une égratignure de ronce et une grippe espagnole peu active – mais il décède toutefois des suites des gazages de 1918.
3. Résumé et analyse
Formidable document d’une continuité et d’un intérêt descriptif remarquables. Instituteur, son esprit est vif et clair et sa plume, parfois sans concession. René Clergeau nous donne à lire un carnet de guerre référentiel dans la littérature testimoniale. De nombreux éléments peuvent être dégagés de son étude et sa longue affectation en Lorraine, ainsi que la vision du choc de Verdun sont autant de tableaux d’intérêt. Tout y est ; description du front, organisation du régiment, noms de lieux et de personnes, le texte ne manque pas d’informations utiles à l’Historien même si les notes s’espacent pour l’année 1918, étant regroupées mensuellement par le scripteur. Certes, René Clergeau se fait promoteur d’un certain bourrage de crâne dans les premières pages mais il ajuste ses tableaux au fil du temps et livre parfois ses sentiments, vindicatifs contre la presse ou l’arrière. Sa vision, même sommaire, des mutineries est également d’intérêt mais il est singulier de constater le laconisme du 11 novembre 1918 où René Clergeau ne semble faire montre d’aucun sentiment particulier à cette date pourtant mémorable. Cette note révèle l’attrait d’une étude psychologique pouvant être effectuée sur ce témoignage. Est-il un héros du front ? Le témoin se décrit comme un « poilu de derrière la tranchée » type de combattant auquel il rend hommage (page 160). Mais non combattant, il n’est pas un « non souffrant » et, à Culmont, le 16 février 1916, il déclare : « Mes yeux sont encore malades mais cette fois ce sont seulement les paupières, intérieurement. Si je dis cela à ma chère femme, elle va s’inquiéter et je sais d’avance quelle fâcheuse répercussion cela produirait sur sa santé, la sachant impressionnable et prête à s’alarmer. Me faire voir au major, c’est me faire évacuer, ma femme l’apprendra et se frappera encore bien plus. Evacué, je peux suivre un traitement court et rester dans la zone des armées, je pourrais revenir à mon régiment mais si le traitement est long et qu’on me fasse filer dans un hôpital de l’intérieur, c’est ensuite le dépôt et le départ pour un régiment quelconque où je ne connaîtrais personne. Tout cela m’ennuie bien et cependant je ne peux écrire cela à ma chère femme, je préfère lui mentir un peu plutôt que de l’inquiéter » (page 128). Ainsi sont résumés plusieurs raisons répondant aux questions de l’autocensure et du pourquoi ils ont tenus.
Certes il rapporte au début de la campagne qu’ « on a vu dans leurs tranchées, des hommes debout morts, se soutenant mutuellement tellement ils sont nombreux » (page 12), il souscrit à une espionnite qu’il voit durable (pages 14, 30, 96, 123 et 244), constate l’inexplosion des obus allemands, n’explosant pas dans une proportion de 20/50 (pages 12, 49 et 67) ou rapporte les ruses allemandes (pages 23 et 69), comme les puits volontairement empoisonnés par les Allemands avec leurs propres cadavres (page 40). Il dit rencontrer d’ailleurs deux agents secrets et recueillir leurs confidences (page 42). Il rapporte la lecture de l’ordre Stenger d’assassiner les prisonniers français le 20 décembre 1914, à Champenoux (page 43) ou les martyrologes, tel celui de l’instituteur d’Hoéville, revenu de captivité le 22 février 1915 (page 53). Il rapporte également des combats au corps à corps épiques et sanglants mais surréalistes, venant d’un non-combattant, et bien entendu, « les Allemands ont employé dit-on » des balles explosives et dum-dum (page 70).
Il n’est pas tendre dans son appréciation de la population locale Meurthe-et-Mosellane, qu’il trouve grossière et sale, en un tableau peu reluisant (pages 22 et 23) et décrira de même plus loin les Auvergnats ! (page 57). Son tableau d’après bataille de la récupération du matériel abandonné, souillé est intéressante (page 24) et il confirme l’utilisation du vin en remplacement d’une eau insalubre (page 26). Il renseigne à plusieurs reprises sur les pratiques mortuaires (pages 26 et 32). Il décrit l’engagement d’un enfant de troupe (page 34 mais aussi pages 78 et 99 pour savoir ce qu’il est devenu). Le 10 mars 1915, il voit des condors qu’il prend pour des Taube (page 57) ! Il rencontre également des soldats devenus fous (pages 69 ou 188) et évoque un tir ami sur un homme perdu et tué (page 100). Il évoque également des déserteurs (page 127) mais fait aussi un éloge des soldats sobres (les Martiniquais) (page 187) ! A Verdun, le 8 septembre 1916, il rapporte horrifié une attaque de Sénégalais décapiteurs « sans s’occuper d’autre chose que leur zigouillage » (page 197) qui lui fait hiérarchiser l’horreur : « la guerre du fusil est terrible, le pilonnage de l’artillerie est épouvantable mais ce massacre au couteau, ce travail de boucher est monstrueux. Quelle affreuse chose que ce corps à corps au couteau ! Non, ce n’est plus la guerre, c’est… je ne peux pas le dire » (page 198).
Côtoyant plus souvent que le poilu la gent féminine, il voit à Velaine-sous-Amance quelques jeunes filles « malades », terme militaire pour syphilitiques, et qui « trouvent quand même quelques imbéciles pour s’occuper d’elles » (page 75). Comme pour la population, la vue de ces adolescentes enceintes, ces filles malpropres, aux sales mœurs (pages 82 et 84) voire dépravées et malades (page 165) apparaît récurrente. Il évoque aussi les « légitimes » telle cette veuve deux fois ayant épousé deux frères morts successivement (page 238) ou ces femmes (dont la sienne) rejoignant presque simultanément leur mari en cantonnement parisien de repos (page 242). Il parle aussi des occupées, évoquant les relations consenties de femmes avec l’occupant allemand à Berlencourt (page 255) et a même un mot sur les femmes belges (page 264) pour lesquelles il a plus de dilection.
Comme beaucoup, il se prononce parfois sur la durée prévue de la guerre ; ainsi Clergeau pense au 22 novembre 1915 que la guerre ne peut matériellement durer plus de 2 ans (page 112).
Soldat de l’arrière, il avoue avoir acheté « pour 20 sous, une belle fusée de 130 en cuivre et une bague de 105 » pour faire faire un coupe-papier en artisanat de tranchée (page 114) dont il évoque les dangers (pages 180 et 181). Il parle de la guerre psychologique, arguant que des cadavres allemands sont laissés sciemment sur le terrain pour démoraliser l’ennemi (page 136). De sa durée aussi, criant son amertume quant au sentiment du peuple envers le soldat le 1er avril 1917 (page 176), contre les journalistes quand ils évoquent le moral du poilu à cette période (page 194 ) ou contre ceux de l’arrière « que la guerre ne touche pas » (page 222). Les mutineries sont proches, et les mouvements collectifs qu’il décrit au théâtre aux armées du camp de Bois l’Evêque, près de Toul, où la Marseillaise est sifflée en présence des officiers supérieurs, ne sont pas équivoques (page 230). Dans ce camp, il précise que la mutinerie du 17 juin 1917 est partie d’un non-paiement du prêt par les officiers de peur s’enivrement des hommes (page 231). Il n’y prend pas part et précise que « tout cela est noté sans commentaire » (page 231) mais il constate les cas, y compris des trains aux portes arrachées par les permissionnaires (page 235).
A Hoéville, le 22 février il relate l’affaire de l’évasion et de la re-capture au front d’un prisonnier de guerre allemand en bleu horizon (page 212). Devant un « essai de vaccin », il suppute le poilu cobaye médical (page 217). Il peste contre les Américains et les Anglais, plus au café qu’au front (pages 244 et 257), évoque les effets physiologiques de l’ypérite (page 262) ou l’omniprésence du gaz à Esnes, qui gâte jusqu’aux vivres (page 269). Enfin sa vision de la cote 304 et du Mort-Homme en mars 1918 est impressionnante (page 269).
Il en ressort un ouvrage formidablement intéressant sur le plan du contenu mais souffrant d’une présentation médiocre, à l’instar de la reproduction iconographique, qui font leur cette observation d’Egger, historien de la littérature : « … car des milliers d’écrits nouveaux qui se publient chaque année, il n’y a jamais qu’un petit nombre d’œuvres qui méritent d’être distinguées par leur valeur scientifique ou littéraire, et celles-là ne trouvent pas toujours des éditeurs dignes d’elles » (in Egger, Emile, Histoire du livres depuis ses origines jusqu’à nos jours, Paris, Hetzel, ca. 1880, page 236).
Yann Prouillet, CRID14-18, décembre 2011
Guichard, Henri (1897-1982)
1. Le témoin
Né le 14 décembre 1897 dans la Drôme, Henri Guichard est issu d’un milieu paysan, domicilié à Combovin. En janvier 1916, à 19 ans, il intègre le 111e RI d’Antibes et ne retourne à son foyer que le 2 septembre 1919. En février 1921, il épouse Alice Combe et le couple s’installe à Châteaudouble puis à Montmeyran comme agriculteurs. Trois fils naîtront de leur union. Sa petite-fille, présentatrice des carnets, indique qu’il devint après-guerre un « pacifiste acharné, un écologiste actif et un citoyen du monde convaincu » et que, en 1972, il se rend à Gross Bieberau en Allemagne, ville jumelée à Montmeyran, où il « serre fraternellement, non sans émotion, la main de quelques poilus d’en face ! ». Il meurt le 1er mai 1982.
2. Le témoignage
Henri Guichard, Guichard-Dahl Eliette (prés.), La Grande Guerre du soldat Guichard. Itinéraire peu commun d’un poilu. Carnets de route 1916-1919, Charenton-le-Pont, Presses de Valmy, 2000, 243 pages.
Le soldat Henri Guichard est mobilisé le 1er juin 1915 au 111e RI d’Antibes. Malade, il va d’abord connaître les hôpitaux puis les camps d’entraînement avant d’être débarqué comme divisionnaire à Froidos dans la Meuse le 20 avril 1917. Ce n’est qu’un mois plus tard qu’il arrivera en ligne, à la 15e compagnie. Il restera sous Verdun jusqu’au grand repos de fin septembre.
Deux mois s’écoulent quand, alors qu’il se prépare à remonter au front, il apprend que son régiment est de ceux qui vont devoir aider l’Italie bousculée par l’offensive autrichienne. Le 31 octobre, il arrive dans les plaines alliées pour un mois d’arrière front avant l’approche vers la zone de combat dans les montagnes du nord. Mais en fait, cette approche est avortée par une permission qui ne rendra le soldat Guichard à la guerre italienne que mi-janvier 1918, où, sur le Monte Tomba enneigé, il est placé en réserve. Au front pendant un petit mois, il est relevé par les chasseurs. Il redescend dans la vallée jusqu’au 26 mars 1918, date à laquelle « personne n’est content de quitter ce beau pays, nous avons passé de si bons jours et nous savons que si nous allons en France, c’est pour nous battre… » (page 65).
On le retrouve dans la Somme, à 11 km d’Amiens, secteur de Prouzel, le 5 avril, où il connaît l’enfer des tranchées et de la boue. Avril se poursuit en ligne, sous les gaz, le bombardement et les attaques partielles et mai la relève pour un secteur plus calme de Lorraine, devant Pont-à-Mousson.
Le 11 juin, après un retour de permission, il apprend sa nomination pour le « groupe franc » du bataillon. Non volontaire, il attribue cette « guigne » à sa jeunesse et à sa condition physique. Il inaugure quelques patrouilles sur la Seille, dans ce secteur réputé calme où il tente de monter des embuscades, parfois tragiques pour les camarades. Peu de résultats au final pour ce groupe qui sera relevé (et dissous) le 5 août par l’arrivée en secteur des Américains. Août l’envoie donc à l’ouest de Soissons où il participe aux attaques d’août devant Epagny. Frôlant la mort plusieurs fois, il est finalement blessé au pied par un éclat d’obus le 29 et échoue à Paris dans un hôpital.
Là, il renoue quelque peu avec le culte protestant dont il était par force éloigné. Il restera à l’arrière jusqu’à ce que les bruits d’armistice laissent espérer une fin prochaine de la guerre. Son retour au front l’a amené dans l’Oise mais il ne retournera pas de suite en secteur combattant car, grippé, il entre à l’infirmerie en cette fin d’octobre. Le 30, les ultimes attaques alliées le trouvent à l’est de Saint-Quentin. C’est de là qu’il participe à la marche en avant et franchit le canal en avant de Guise, sous les balles et le gaz. Les Allemands, s’ils reculent, ne sont pas encore à genou. Pourtant, il repart vers l’arrière, son bataillon étant relevé et apprend l’Armistice, le 11 novembre 1918 en matinée à la sortie de la ville de Nesle, loin du front. La guerre est terminée et Henri Guichard escompte sa démobilisation. L’heure n’a pourtant pas encore sonné et de nombreuses heures de marches vont se succéder avant l’entrée en terre reconquise qui se fera pour le soldat Guichard le 23 décembre 1918 à Saales, dans le Bas-Rhin, aux opinions très francophiles. Dès lors, il parcourt les villages d’Alsace et s’achemine au nord de Strasbourg où il voit enfin le Rhin. Il poursuit son « itinéraire touristique » quand, le 4 mars 1919, il apprend son changement d’affectation pour intégrer le 10e bataillon indochinois qui part vers l’Orient.
Après une permission, il embarque sur le « Vinh-Long » le 19 avril et accoste le 3 mai dans le port Roumain de Constanza. Il visite Constantinople, la Bulgarie, Bucarest et échoue dans le port de Varna où il devient manutentionnaire. Le 23 août, il apprend la démobilisation de sa classe, la 17. Il va rentrer alors en France, à Combovin où il retrouve son père le 2 septembre 1919.
3. Résumé et analyse
Le soldat Guichard entre en guerre tardivement et par à-coups et il reste le plus souvent le spectateur de sa propre guerre et même l’Armistice n’est pas vécu au front. Pourtant, le soldat Guichard aurait pu fournir un témoignage de premier ordre sur un parcours particulièrement intéressant et singulier. Le début de sa guerre, en 1917 est similaire à la masse mais il participe à la campagne d’Italie où il agit peu. Il rentre en France, retrouve les tranchées et est affecté dans un groupe franc, dont peu de soldats évoqueront le rôle et les caractéristiques exactes. La fin de 1918 l’entraîne à la poursuite d’une Allemagne agonisante et son témoignage se poursuit bien au-delà de l’Armistice. Là encore, cette singularité aurait pu apporter beaucoup ; il parcourt une Alsace libérée et paysanne et surtout intègre la seconde période d’Orient qui lui fait parcourir la Roumanie et la Bulgarie. Malheureusement, son parcours de guerre est trop secondaire ; il témoigne « en touriste » et sans renseigner le lecteur sur sa formation et son rôle exacts en Roumanie. Enfin, de religion protestante, il apporte sur ce point une autre singularité dans les témoignages de guerre dans la masse de témoignages d’autres obédiences.
Comment expliquer la constance d’une telle faiblesse dans le témoignage ? Est-ce dû à l’origine plébéienne du soldat Guichard ? Son évidente découverte du monde en même temps que de la guerre trahit son manque de culture, de vocabulaire et d’à-propos pour décrire les heures extraordinaires et les expériences vécues. Ayant manqué totalement d’un élémentaire sens de la description, son texte manque ainsi globalement d’intérêt. L’auteur écrit avec une simplicité naïve sans s’attacher au véritable intérêt des situations qui l’entourent. Trop peu fouillé, il s’agit souvent d’un étalage de banalités et de menus faits quotidiens. Sa passivité même nous laisse à penser qu’il ne participe jamais aux attaques et certaines de ses expressions sont incompréhensibles (voir page 125 « Je trouve en arrivant un assez bon trou où je couche avec un camarade. Ce trou est recouvert d’un trous d’obus, ce qui fait que s’il pleut, nous ne mouillons pas » !). Même si le personnage est touchant (il ne haï pas l’Allemand sauf quand celui-ci coupe les arbres fruitiers, page 135), il ne capte pas l’intérêt du lecteur. Il donne pourtant une bonne définition d’un secteur tranquille « car l’herbe pousse partout où nous sommes » page 23. Il décrit le 11 novembre à Nesle (Somme) et passe l’ancienne ligne de front dans les Vosges (vallée de la Fave) et l’Alsace recouvrée (vallée de la Bruche dans la Bas-Rhin) en décembre 1918, y notant une zone dévastée de faible largeur, « 5 ou 6 kilomètres au plus » (page 143) et dont la forêt a été par place surexploitée (page 147). Il découvre une Alsace plus moderne et plus jolie que la France (page 149) où il règne toutefois « un peu d’hostilité » à l’égard des Français (page 147), même si, sur le pont de Kehl à Strasbourg, il indique que ce sont les Alsaciens eux-mêmes qui chassent les Boches de la ville.
Ainsi, le texte, naïf, est, par le style et par la présentation, destiné au néophyte. Les annotations complétives du glossaire d’Eliette Guichard-Dahl, présentatrice des carnets, apportent peu et sont superficielles. L’introduction et la postface se veulent un hommage mais se révèlent inutiles et lacunaires pour la véritable appréhension du personnage. On peut toutefois se reporter à ce témoignage pour quelques tableaux de la fin d’année 1918 et quelques lignes sociologiques sur l’Alsace libérée. L’édition présente une erreur de numérotation dans le glossaire et une typographie trop aérée. Il n’est pas illustré ni cartographié.
Parcours géographique de l’auteur (avec datation et pagination entre parenthèses) :
1917 : Froidos (20 avril) (16), Fleury (15 mai) (17), Auzéville, Brabant-en-Argonne, Vraincourt, Boureuilles (15 mai – 16 juin) (17-26), Neuvilly, Clermont-en-Argonne, Auzéville, Granges-le-Comte, Vraincourt, Aubréville, Parois, Avocourt (15 mai – 16 juillet) (26-30), Vauquois (27 juillet – 3 septembre) (30-32), Avocourt, camp Marquet (3-25 septembre) (33-35), camp de Saint-Ouen (27 septembre – 17 octobre) (35-36), Blacy à Sommessous (18-29 octobre) (36-38), Embarquement ferroviaire, Italie, retour dans la Somme) (29 octobre 1917 – 5 avril 1918) (38-70).
1918 : Reuil, Tillé, Beauvais, Pouseaux, Saint-Omer-en-Chaussée, Marseille, Poix, Conty, Prouzel (5 avril) (71), Rumigny, Grattepanche (8-10 avril) (71-72), Estrées-Saint-Denis, Guyencourt, Remiencourt, bois Sénécat (10 avril – 1er mai) (72-88), Dommartin, Cottenchy, bois d’Enfeuil (1er mai) (88-89), Estrées-Saint-Denis, Grattepanche, Saint-Sauflieu, Nampty (4 mai) (90), Loeuilly, Conty, Belleuse, Lavacquerie (5 mai) (90), Mesnil-Conteville, Hamel, Grez (6-9 mai) (90-91), de Grez à Autreville (Meurthe-et-Moselle (10-21 mai) (92-96), Flammechamps, Morville, Sainte-Geneviève, Port-sur-Seille, Millery (23 mai – 7 août) (96 – 107), Millery à Epagny (Aisne) (8-22 août) (107-110), Vassens (23-29 août) (111-116), Paris (convalescence), retour au front (30 août – 16 octobre) (116-120), Mesnil-Saint-Georges, Montdidier, Warsy (16-30 octobre) (120-123), de Warsy à Grand-Verly (Aisne) (30 octobre – 1er novembre) (123-125), Grand-Verly (1er-7 novembre) (125-131), Lesquielles, Grougis, Aisonville, Boukincamp, Montigny, (8 novembre) (131) Fieulaine, Fontaine-Notre-Dame, Homblières, Saint-Quentin, Holnon, (9 novembre) (132), Savy, Etreillers, Vaux, Germaine, Foreste, Douilly, Matigny, Y, (10 novembre) (133), Béthencourt, Mesnil-Saint-Nicaise, Nesle, Rethonvillers, Sept-Fours (11 novembre) (134-135), Crémery, Fresnoy, Damery, Andechy, Guerbigny, Warsy, Davenescourt, Hamel-Contoire, Pierrepont (12-13 novembre) (135-136), Hargicourt, Malpart, Grivesnes, Le Plessier, Coullemelle, Rocquencourt, Tartigny, Caply, Troussencourt, Maisoncelle (Oise) (14 novembre) (136-137), de l’Oise à l’Alsace (17 novembre – 23 décembre) (137-143), Fraize, anould, Saint-Léonard, Saulcy-sur-Meurthe, Sainte Marguerite (22 décembre) (143), Coinches, Vanifosse, Neuvillers, Frapelle, l’Alsace (Vallée de la Bruche à Strasbourg) (23 décembre 1918 – 28 février 1919) (143-162).
1919 : Lorraine mosellane à l’Orient (28 février – 19 avril) (163-171), Roumanie et Bulgarie (19 avril – 1er septembre) (171-230).
Yann Prouillet, CRID14-18, décembre 2011
Defaye, Raymond (1892-1974)
1) Le témoin
Né le 7 janvier 1892 à Guéret, dans la Creuse, Raymond Defaye a 22 ans lors de la mobilisation. Fils du directeur départemental des Postes de Tarn-et-Garonne, il est étudiant en médecine à Lyon en 1914. Il est mobilisé le 2 août à Montauban, et part pour la Marne. Très vite affecté à la conduite de convois militaires (122e section automobile TP), il est nommé médecin dans le 347e régiment d’infanterie le 15 juin 1915. Le 16 septembre, il tombe malade et est évacué vers l’intérieur. Après la guerre, il est médecin aide-major, élève de l’Ecole du Service de Santé militaire. Il soutient à Lyon le 26 mars 1919 sa thèse de doctorat en médecine, sur « La lutte contre les émanations gazeuses en guerre de mine ».
2) Le témoignage
Les carnets de guerre de Raymond Defaye ont été publiés dans Bleu horizon : témoignages de combattants de la guerre, 1914-1918, parallèlement à ceux de Raymond Moles (sous la direction de Gilles Bernard, Éditions Empreinte, 1999). Son carnet s’accompagne de 160 photographies inédites sur les 500 qu’il réalisera pendant la guerre avec son appareil Kodak. Par ailleurs, l’éditeur a choisi de publier les extraits les plus significatifs de sa thèse.
3) Analyse
Le témoignage de Raymond Defaye est riche parce qu’il permet de croiser les photographies et les carnets de ce combattant. Ce jeune homme, à l’arrière front, rapporte les nombreuses rumeurs qui circulent : « Un turco serait revenu avec une tête de boche la jugulaire encore sous le menton. Un autre aurait plusieurs paires d’oreilles dans sa musette » (du 25 au 28 août 1914) ; « On coupe les doigts aux enfants pour les empêcher d’être soldats français » (11 septembre 1914).
Il est fasciné par le spectacle de la guerre et attentif aux traces de la bataille. Le regard qu’il porte sur l’ennemi est complexe. Il note le 12 septembre, travaillant aux côtés d’un médecin allemand prisonnier l’absence de distinction dans les soins accordés aux soldats allemands ou français. Le lendemain, ses camarades se réjouissent à l’idée de pouvoir « descendre quelques boches ». Pour autant, cette opportunité ne se présente pas. Devant Reims en flamme et les collines en feu, il observe « au-dessus un ciel moyen qui reflète l’incendie et qui est sillonné par les obus. C’est magnifique dans son horreur. » (14 septembre 1914). En direction de Reims, en octobre 1914, il se réjouit de « pouvoir voir ce bombardement fantastique. » Mais la lassitude et l’ennui s’installent progressivement. Il supporte difficilement le regard que portent sur lui officiers et soldats exposés au feu ennemi (5 février 1915). Par ailleurs, la fixité du front et l’inaction pèsent : « tous les fantassins en ont plein le dos et tout le monde attend la fin avec une vive impatience. On est découragé de cette inaction. La moindre chose en avant fait aussitôt naître une lueur d’espoir puis quelques jours après tout revient dans le calme un peu plus désespéré qu’auparavant », écrit-il le 18 mai 1915.
Il est titularisé médecin auxiliaire et affecté à la 52e DI, au 347e RI. Il est alors envoyé dans un poste de secours en première ligne. Il partage ainsi le quotidien des combattants. Il s’insurge contre les officiers qui font sentir de façon outrageante leurs galons et se sent déconsidéré.
Le 16 septembre, il est déclaré malade et évacué vers l’intérieur.
Ses photographies offrent un regard tout aussi intéressant sur son expérience de guerre. Les clichés et le carnet se font écho : les photographies témoignent de la vie dans le service automobile au début de la guerre et donnent surtout à voir les mouvements de troupes. R. Defaye photographie également les maisons ou les églises détruites, les cimetières, les activités quotidiennes (creusement d’une tranchée, cuisine, défilés, cérémonies, etc.). Les photographies de Reims s’apparentent à un reportage ou il fixe les ruines avec son appareil. Certaines, photographies ont été prises en 1ère ligne : les cadavres et les explosions y sont montrés (ex. p. 74). L’ensemble des photographies est consultable aux Archives Départementales de la Haute-Garonne.
Marty Cédric, 19 mars 2010.
Massignac, Clément (1894-1917)
1. Le témoin
Massignac Henri, Alfred, Louis, dit Clément, est né le 22 février 1894 à Tournecoupe (Gers). Fils de cultivateurs, il devient apprenti dans une briqueterie du village. Avant-guerre, il cherche à créer sa briqueterie sur l’exploitation paternelle qui permet difficilement à elle seule de faire vivre la famille. On lit La République des Travailleurs, organe de presse radical-socialiste, mais Clément est catholique et participera aux offices à la guerre quand il le pourra. Mobilisé le 8 septembre 1914 au 11e RI de Montauban. Départ pour le front de Champagne dès le 16 novembre. Transfert à Arras le 23 avril 1915. Départ de ce secteur le 1er mars 1916. Montée en ligne à Verdun le 20 juillet 1916. Le 25, blessé à Thiaumont. Hospitalisé jusqu’au 20 août. Il participe ensuite à un stage de mitrailleurs, puis à un stage de servant du canon de 37, du 26 septembre au 27 octobre 1916. Il remonte à Verdun, côte du Poivre, du 14 au 26 novembre 1916, avant de tenir les tranchées dans le secteur d’Apremont du 3 décembre 1916 à mars 1917. Le 17 avril, il participe à l’assaut de la 4e armée sur les Monts de Champagne ; il est tué sur les pentes du Téton le 19 avril 1917.
2. Le témoignage
Lettres originales conservées par les descendants. 19 pour 1914, 106 pour 1915, 99 pour 1916, 26 pour 1917. Au total 250 lettres pour une période de 879 jours de campagne. Une correspondance régulière, un courrier tous les 3 à 4 jours. Les lettres sont publiées, in extenso ou en fragments commentés, in Laurent Ségalant, Lignes de vie, Des Gascons dans la Grande Guerre, Orthez, Éditions Gascogne, 2009, 3 volumes. Les références données dans l’analyse ci-dessous renvoient à cet ouvrage. Pendant toute la période considérée, le témoin appartient à la même unité, le 11e RI.
3. Analyse
Les lettres relatent à la famille les scènes habituelles de la guerre (tranchées inondées, poux, rats, médiocrité du ravitaillement parfois), et les remarques souvent rencontrées sur les rapports combattants/arrière (prix exorbitants pratiqués par les commerçants sur le marché captif des soldats, diatribes contre les embusqués).
Dans un style difficile, contraint d’une part par un faible niveau de formation scolaire et d’autre part par la superposition du français à l’usage du gascon, l’expression et la pensée du témoin progressent de façon nette dans le fil de la correspondance. Cet échantillon de lettres significatif en volume et en durée est intéressant car écrit par un jeune homme socialement représentatif de la masse des fantassins. On y découvre en premier lieu l’instruction bâclée réservée à la classe 1914, la plongée immédiate de cette classe dans la guerre des tranchées. Très vite, dès le 7 décembre 1914, le témoin comprend la nature de cette guerre : « Nous sommes dans les tranchées mais on ne tire presque jamais. Il n’y a que l’artillerie qui donne, surtout celle des Boches » (tome I, p. 482). La lassitude de la guerre est vite exprimée, Clément cherche à survivre en devenant ordonnance d’officiers, puis, dès 1915, en avouant espérer “la fine blessure”, enfin en expliquant que les stages suivis n’ont d’autre but que de profiter d’un sursis. Il relate plusieurs épisodes où la mort l’a frôlé : un ensevelissement à Verdun (tome II, p. 415), deux marmitages (tome II, p. 383 et 385). Les lettres sont riches d’indices de stratégie d’évitement, ou de “vivre et laisser vivre”.
Pour le premier thème, une lettre du 19 mars 1916 explique sa survie lors de l’assaut meurtrier du 9 mai 1915 en Artois, survie qu’il impute au comportement de son capitaine : « Il a refusé de sortir à l’ordre du commandant et lui a dit que sa compagnie ne sortirait que quand les mitrailleuses boches qui étaient devant nous seraient démolies par l’artillerie et qu’il ne voulait pas nous conduire à la boucherie » (tome II, p. 351). On trouve en outre trace d’une “délégation” au commandant sur l’insuffisance de la ration qui débouche sur un sabotage discret des travaux : « Tout le monde n’était pas content, mais aussi, le travail qu’on fait est petit » (11 mai 1916, tome II, p. 367).
S’agissant du second thème, Clément note le 29 mai 1915 : « Ici, on nous fait couper l’herbe devant les Boches, et eux font de même, ils nous tirent pas un coup de fusil » (tome II p. 109). Un témoignage indirect sur une scène qui se serait déroulée au 9e RI sur le front d’Arras est rapporté dans une lettre du 30 octobre (tome II, p. 200) : « Eux sont moins en danger que nous parce qu’ils sont bien avec les Boches. Ils se sont passés du pain entre eux, mais vous savez, leur pain n’est pas si blanc que le nôtre. Un sergent de notre compagnie y est allé les voir à leur secteur, ils sont à deux kilomètres de nous plus sur la droite et ils lui ont raconté ça. Ils plaçaient des fils de fer ensemble et ils ne se tiraient pas un coup de fusil, ils sont allés dans leurs tranchées. Quelqu’un et des officiers boches ont causé avec des officiers à nous, et ils disent qu’eux aussi en ont marre. Le jour de l’attaque du 25 septembre, il y en avait dans les entonnoirs près de la tranchée boche et pendant la nuit les Boches leur ont porté des confitures, et toute la journée le 75 a tapé sur notre tranchée, et il a esquinté la moitié du 9e. Et sur tout le front, ça devrait être comme ça. Peut-être que la guerre comme ça se finirait. Seulement, maintenant, ils les ont avertis : le premier qui parle avec un Boche est fusillé sur place. »
Un autre élément intéressant réside dans la quantification (bien entendu approximative) des épisodes où le témoin a été confronté à l’alternative “tuer ou être tué”. Dès son arrivée en Champagne, Clément relate des scènes de bombardements quasi ininterrompus. Le risque d’être enseveli est fréquent : « Nous sommes restés toute la journée dans une tranchée, couchés à plat ventre, et il y avait des moments que les obus nous couvraient de terre, on avait des blessés et des morts à côté de nous » (19 février 1915, tome II, p. 41). Le 11 janvier 1915, Clément passe à côté du pire : « Hier, nous avons passé une terrible journée, les obus sont tombés toute la journée, nous n’avons eu qu’un mort et un blessé. À moi, il m’en a éclaté un devant la cabane, et a brisé la gamelle à un copain qui était à côté de moi » (p. 30). Mais le danger vient aussi des balles : « J’ai vu les casques à pointe de près, j’ai eu la capote trouée par une balle » (25 décembre 1914, tome II, p. 26). Les narrations du danger subi sur le front d’Arras en 1915 évoquent exclusivement les bombardements. Mais un risque nouveau est mentionné le 12 mai : « Je crois que bientôt les tranchées seront inhabitables à cause des mines. Moi, j’ai sauté à 2m de l’autre côté des tranchées, sans avoir mal » (tome II, p. 87).
Fin janvier 1916, pour faire diversion aux préparatifs de l’offensive de Verdun, le front d’Arras est embrasé par les Allemands. L’historique régimentaire du 11e liste trois attaques allemandes, une contre-attaque et un combat à la grenade. Le 4 février 1916, Clément relate le premier assaut adverse du 28 janvier : « L’autre matin, ils ont sauté en face de nous et les tranchées ne sont qu’à 20 mètres l’une de l’autre et ils ont commencé à monter sur les tranchées en criant “hurrah” mais les mitrailleuses ont ouvert un feu croisé et ils sont vite redescendus quand ils ont entendu ces pruneaux siffler » (tome II, p. 279). On réalise très vite que les adversaires sont restés à distance, d’ailleurs ce sont les mitrailleuses qui ont bloqué la tentative, les fantassins ont-ils seulement eu le temps d’intervenir par le feu individuel ? Le 17 février 1916, nouvelle lettre, nouveau combat pour la reprise d’une tranchée gagnée par les Allemands, dont les formulations montrent que Clément n’est pas acteur : « Hier, il y en a qui ont voulu la reprendre, il y en a deux qui se sont fait tuer » (p. 282). Mais la lettre du 19 février, qui relate la dernière des tentatives de diversion allemande dans le secteur tenu par le 11e RI, évoque une réalité d’une autre nature. Pour la deuxième fois sans doute, Clément est engagé dans une lutte interpersonnelle : « Hier, dans la nuit, nous avons fait 4 prisonniers et 2 ou 3 morts. C’était une patrouille qui s’avançait sur nous. Ils étaient 9, ils avaient pour mission de reconnaître la 1ère ligne à nous. […] Mais seulement, on les a arrêtés, il n’y en a que 2 qui n’ont pas eu de mal, ils ont sauté dans notre tranchée en abandonnant le fusil et l’équipement, les autres étaient broyés par les balles » (p. 282). On peut penser que, cette nuit là, Clément a tué, au minimum il a tiré à faible distance sur des ennemis visibles…
En avril 1916, changement de secteur, retour à la butte du Mesnil, retour à la “routine” du bombardement : « Nous sommes terrés comme des renards toute la journée » (5 mai 1916, p. 362). Au passage, Clément demande à recevoir La République des Travailleurs car « par ici, les journaux nous disent toujours qu’on les aura. Moi aussi je dis qu’on les aura – les bidons vides ou les poux – mais les Boches jamais ».
Un nouveau danger est rapporté : « Avant-hier, nous avons eu une attaque allemande. Nous autres, nous avons souffert beaucoup des gaz lacrymogènes qu’ils ont envoyés en arrière. Et vous savez, c’est très mauvais, ça vous brûle les yeux et ça vous fait vomir » (4 juin 1916, p. 375). Pour le reste, les bombardements sont très majoritairement évoqués. On comprend d’ailleurs pourquoi : Clément manque à deux reprises de mourir. Alors qu’il est de corvée de paille, « voilà qu’il arrive un obus et qui éclate en plein sur nous. C’était peut-être du 200 » (15 juin 1916, p. 383), « Encore maintenant, au moment où j’allais commencer cette lettre avec plusieurs qu’on était, voilà qu’il arrive une rafale d’obus qui tombent à 10 mètres de nous. Heureusement que personne n’a été touché » (20 juin 1916, p. 385).
Le 1er juillet 1916, le 11e quitte la Champagne pour monter à Verdun le 21 juillet. Le 25, Clément est blessé à la jambe par un éclat d’obus. Il avoue s’être terré dans un trou d’obus, il a vécu là plusieurs jours de combats. Outre la blessure, une autre mort aurait pu le prendre : « J’ai été enterré par un obus dont j’ai pas pu me dégager pendant 2 heures avec Guiobert de Saint-Clar » (27 juillet 1916, p. 415).
Enfin, les lettres montrent un soldat paysan s’intéressant à distance à la marche de l’exploitation familiale (date des semis, prix du bétail, opportunité d’acheter une nouvelle machine), s’informant du sort des camarades du village mobilisés, tentant, dès qu’il le peut, de retrouver des habitudes rurales, par la pêche et la chasse (tome II, p. 353). Clément, gourmand, nous montre son dégoût de l’excès de viande, sa nostalgie des légumes du pays, sa découverte de la bière et de la cuisson au beurre des crêpes…
Laurent Ségalant, janvier 2010
Frot, Paul (1897-1964 ?)
1. Le témoin
Paul Frot est étudiant préparant HEC et a 19 ans lorsqu’il est appelé avec la classe 17. Il effectue six mois de préparation à l’école d’officiers de Saint-Maixent ; maîtrise la langue allemande, ce qui lui permet d’interroger des prisonniers à plusieurs reprises.
Baptême du feu le 15 juin 1917 en Flandres au 165e R.I. ; 9 mois de tranchées de Coxyde à Nieuport.
29 mars 1918 : transféré dans le secteur de la Somme (Boves) ; il fait partie des troupes envoyées stopper l’offensive allemande qui paraît alors irrésistible ; brûlé à l’ypérite, il rejoint Verdun après sa convalescence.
En août, son régiment est sous le commandement du général Mangin chargé de la délivrance des territoires envahis ; combats dans l’Aisne.
2. Le témoignage
Ce témoignage est un journal retrouvé par les filles de l’auteur en 2004 et publié sous le titre : Paul Frot, Mon journal de guerre 1914/1918, du 15 juin 1917 au 11 novembre 1918, Paris, Connaissances & Savoirs, 2005. Cet ouvrage est précédé d’une « adresse » en guise de dernière lettre des trois filles à leur père. Ce journal est un récit composé par Paul Frot à partir des notes consignées dans son carnet de campagne ; on y trouve certains récits construits à partir des dires d’anciens (voir notamment sur l’affaire du 22 avril 1915 et la première attaque aux gaz sur le front occidental, p. 70) ; d’après « l’adresse » écrite par ses filles, cette copie aurait été réalisée sur une machine de l’armée (p. 9) « avec son ruban bleu » ; on notera qu’au moment de cette recopie, mise au propre et mise en récit, l’auteur a effectué quelques rajouts « extraits de mon carnet de campagne » qu’il signale, comme à la page 39. À partir du 9 octobre (p. 84), les dates deviennent plus fréquentes ; on peut supposer qu’à partir de cette date, le journal « colle » de plus en plus au carnet d’origine, mais de nombreux indices signalent la recomposition du récit jusqu’à la fin. Des notices historiques ponctuent le journal ; référence est faite d’un livre publié au lendemain de la guerre (p. 89)…
Ce journal a été ensuite transmis de génération en génération par la main d’hommes de la famille ayant également connu la guerre.
3. L’analyse
Les Flandres belges : longue description du front dans le secteur de Nieuport-Bains. Une particularité, pas de boue ; de l’eau et du sable. Ce qui nécessite d’étayer en permanence les tranchées ; le vent est ici un problème majeur, qui pénètre partout et enraye notamment les armes.
Malgré les bombardements, présence de civils : « quelques belges encore tolérés par l’armée anglaise, séjournent dans le village dans l’espoir de sauvegarder leurs biens. Ils passent la plus grande partie de leur vie dans les caves » (p. 55)
Cadavres : L’émotion causée par les premiers (p. 53) ; Travaux d’approfondissement des tranchées dans un charnier (p. 72) ; les marais de Martjevaert (p. 89-90), espaces pestilentiels. « […] le corps d’un soldat du 321e Fusilier Mitrailleur, noyé dans la boue et dont le casque et l’extrémité du canon du fusil émergeaient » ; « J’ai appris que nos camarades en première ligne, aux petits postes les plus avancés, avaient sans cesse de l’eau jusqu’au ventre…
Un chef : Souci du confort de ses hommes (p. 59) ; « j’ai presque honte d’avoir la satisfaction de manger, malgré ma présence en secteur, une cuisine spécialement préparée à l’intention des sous-officiers par leur cuistot attitré établi avec la roulante de la compagnie au bord de l’Yser » (p. 59) ; montrer l’exemple : « J’ai gardé tout mon calme. J’ai conscience sans vanité que mon attitude a plu aux hommes et que, pour un véritable baptême du feu, je n’ai pas trop fait mauvaise figure. Je me persuade que c’est grâce à cette attitude que j’acquerrai à leurs yeux une autorité suffisante à l’avenir pour me faire respecter malgré mon jeune âge… » (p. 77) ; d’autres réflexions sur ce thème tout au long de l’ouvrage.
Regard critique envers son supérieur direct. 2 avril 1918, lors de la remontée en ligne (secteur d’Hailles) : « un peu d’énervement chez tout le monde, beaucoup chez notre commandant de compagnie qui se confond en gémissements et en lamentations avant d’étourdir ses subalternes par des ordres et des contre-ordres qu’accompagnent des termes vexants inutiles » (p. 148) ; « Notre lieutenant, commandant de compagnie, qui n’ose pas sortir le nez de son trou et qui n’a pas manqué d’exiger un compte-rendu écrit de notre installation pour s’éviter un dérangement, a rassemblé sa liaison pour lui aménager un abri » (p. 149)
Alliés: Voisinage britannique au camp de Woesten ; les Ecossais et leur flegme étonnant sous le bombardement ; fraternisation entre alliés avec force boisson… (p. 64-65)
Assauts : Le rôle du sergent serre-file au moment de l’assaut: « Le sergent Lagache, d’un calme et d’un sang-froid imperturbables, longe la tranchée sous les obus, observant si tout le monde est à son poste et pour faire sortir si nécessaire les froussards de leurs trous ; précaution au fond inutile, car chacun fait preuve dans ces circonstances émouvantes d’une attitude parfaite » (p. 76)
Offensive allemande :
A partir du 29 mars 1918, en renfort des troupes britanniques refoulés violemment par l’offensive allemande (secteur de Bertheaucourt-les-Thennes). Attaques de la cavalerie canadienne (p. 143) ; grande tuerie de cavaliers » (p. 143-144) ; pillage consciencieux des caves mais « […] les hommes respectent les intérieurs des maisons. Nombreux sont, en effet, au Régiment ceux qui ont souffert de l’invasion et de l’occupation allemande. Ils savent bien tordre le cou d’une poulette ou écorcher un lapin, mais une sorte de respect les pousse à ne trop rien déranger du mobilier abandonné des maisons où le hasard des cantonnements les a placés » (p. 146)
Alcool : soutien du moral. 3 avril : « Le petit jour paraît. Avec lui, la gnole rempli les quarts, une gnole détestable mais réconfortante après une nuit terrible, glaciale, sous la pluie qui nous a traversés jusqu’aux os » (p 150)
13-14 septembre : la nuit précédant l’assaut sur Laffaux (Aisne) : « Impossible de chercher à trouver le sommeil. Je regarde mes hommes. Aucun ne dort. L’heure est trop grave. Les uns boivent du café corsé de gnole comme le feraient des chasseurs au marais. Les rations de gnole ont été fortes, c’est l’usage à la veille des attaques. Nous laissons aux Boches le procédé du dopage à l’éther. Jamais fantassin de France n’en a usé. D’autres rêvent éveillés, écrivent ou parlent à voix basse… » (p. 266) Ces mentions tardives des distributions de gnole au sein des troupes combattantes sont confirmées par de nombreux autres témoins. Ainsi, en dépit des inconvénients évidents de cette alcoolisation, l’armée n’a pas trouvé meilleur moyen pour consolider le moral des troupes d’assaut.
Tirs amis : Des batteries françaises et anglaises tirent sur les lignes françaises : « Malgré toutes les fusées lancées pour demander l’allongement du tir, celui-ci se poursuit… toujours trop court ! Les hommes quittent leurs emplacements pour chercher un coin plus sûr, à l’exemple du commandant de compagnie lui-même » (p. 153) ; à d’autres moments encore, les fantassins menacent de quitter les lignes…
12 avril 1918 : défense acharnée du château de Hangard (p. 162-182) ; encore des tirs « amis » (p. 169) ; l’auteur et ses hommes sont prisonniers des Allemands pendant quelques minutes avant d’être délivrés par une vive contre-attaque franco-canadienne ; 13 avril, gazé à l’hypérite pendant son repos à Domart et atteint par la grippe espagnole. Evacuation par train sanitaire sur l’hôpital n°16 de Poitiers. Le 30 mai, rejoint son corps devant Verdun.
Fin août 1918, son régiment est mis à la disposition du général Mangin pour la poursuite victorieuse.
Une réflexion sur le comportement des soldats : « 28 août [1918]. Cette terrible guerre est un grand exemple de la toute puissance de l’habitude. Le Français d’aujourd’hui combat avec une passivité qui, à la réflexion, s’avère stupéfiante pour quiconque a vécu depuis longtemps les souffrances du soldat. Au moment où les périls s’aggravent, où les embûches, se dressant partout à la fois, devraient secouer les âmes d’anxiété, les hommes, dont les maîtres attendent encore un effort gigantesque, se conduisent comme les rouages fidèles d’une force que l’on croirait mécanique. Ils se meuvent avec une précision et une si grande docilité que l’on se demanderait parfois si ce sont là des êtres qui souffrent. Pour comprendre à quel degré d’automatisme, d’assujettissement, sont parvenus les tempéraments même les plus réfractaires, il faut voir évoluer les unités de notre arme, sans cesse alertées, déplacées, oubliées, rappelées, et aussi sobres devant le danger et la mort que devant la cohue des routes et des bivouacs » (p. 232-233).
Il est significatif qu’un officier reconnaissent aussi ouvertement l’assujettissement des hommes de troupe. La force de l’habitude, le poids des automatismes, l’idée de ne pouvoir échapper à son « destin » ou son « devoir », l’idée d’être dépassé, sinon écrasé par l’événement (la guerre) ont effectivement contribué dans une certaine mesure à nourrir ce que l’on appelle la ténacité des combattants.
Panique causée par les gaz (p. 252)
Combats sur le Chemin des Dames. Septembre 1918.
Frédéric Rousseau, juillet 2008.