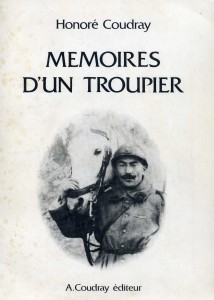Martha Hanna Ta mort serait la mienne
1. Les témoins
Paul Pireaud, agriculteur à Nanteuil-de-Bourzac (Dordogne), est marié à Marie Pireaud, née Andrieux, en février 1914. Il quitte son foyer à 24 ans le 3 août 1914, et sert d’abord au 12e escadron du Train [des équipages militaires] puis devient en 1915 canonnier au 112e régiment d’artillerie lourde, qui vient d’être créé. Il reste dans cette unité toute la guerre, passant notamment par Verdun et l’Italie. Marie accouche de leur fils unique Serge en juillet 1916. Paul, démobilisé en juillet 1919, reprend alors son activité agricole à Nanteuil.
2. Le témoignage
Matha Hanna, professeure émérite à l’université du Colorado (Boulder), a publié en anglais en 2006 « Your Death Would Bee Mine ». La traduction française a paru en 2008 avec le titre « Ta mort serait la mienne » (Éd. Anatolia, 428 pages). Ce travail est construit à partir des lettres échangées par les époux Pireaud, cette correspondance étant conservée au Service historique de la Défense à Vincennes (cote 1Kt T 458, correspondance entre le soldat Pireaud et son épouse, 1910 – 1927). L’autrice propose une histoire de ces paysans et de ce village dans la guerre, en expliquant, contextualisant et illustrant cette correspondance : à partir du dialogue échangé par ce jeune couple très épris, elle met en valeur des thèmes d’histoire sociale et des mentalités, en relation avec l’irruption du conflit dans cette Dordogne rurale, qui est aussi une irruption de la modernité. M. Hanna choisit d’approfondir certains aspects, sans négliger l’histoire militaire, et elle convoque beaucoup d’outils extérieurs (carnets, recensements, rapports administratifs, contrôle postal, etc…). Ces approfondissements s’accompagnent de nombreux extraits de lettres qui justifient tout à fait la présence de « Ta mort serait la mienne » dans notre corpus de témoignages.
3. Analyse
Le couple, qui n’est marié que depuis quelques mois en août 1914, a déjà un bon entraînement à la correspondance, car Paul a servi un an au Maroc (1912), alors qu’il était déjà fiancé. Les deux correspondants maîtrisent suffisamment l’écrit pour mener des conversations épistolaires, même si persistent des fautes d’orthographe ou de syntaxe, mais qui ne gênent pas la compréhension.
Se voir à l’arrière
Au début du conflit, l’affectation protégée de Paul (train des équipages) atténue l’angoisse de la séparation. Il fait partie d’une équipe mobile de boulangers et Marie est bien consciente de la situation privilégiée du couple : (octobre 1914, p. 78, avec autorisation de citation) « pour m’encourager je me dis que les autres sont toutes pareilles et que bien mieux je suis un peu favoriser puisque tu ne risque pas trop et que tant d’autres sont a la mort ou la vie. Si tu pouvais toujours y rester avec ces boulangers que je serais contente. » Le père de Paul est maire du village, et curieusement, lui et son fils sont d’accord pour que Marie ne demande pas l’allocation de femme de mobilisé ; d’après M. Hanna, ils sont persuadés que la guerre sera courte et surtout ils ne veulent pas prêter le flanc à l’accusation de favoritisme dans l’attribution des aides ; Marie doit s’y résoudre mais elle est furieuse, signalant (p. 88) qu’une femme au village, elle, «mange tranquillement ses 25 sous par jour. » Jusqu’à l’affectation de Paul en février 1915 au 112e RAL, une grande partie des échanges est consacrée à échafauder des stratégies pour se retrouver à l’arrière du front. C’est pour lui assez facile mais les problèmes viennent plutôt des familles, qui ne veulent pas laisser Marie voyager seule. En septembre 1914 son père lui interdit d’aller à Melun (p. 106) « Je ne suis poin contente j’aurais voulu y aller seule jamais je n’ai pu etre maitresse ni des miens ni des tiens jamais ils n’ont voulu disant qu’il y avait trop de danger (…) Je me maudit d’avoir était faible de ne pas avoir partit malgré tout. ». En octobre le père de Paul cède, mais à condition d’accompagner sa bru dans la Nièvre. Et c’est seulement à la fin de 1914 que les époux peuvent se retrouver seuls quelques jours. On constate donc ici que le processus de prise d’autonomie de la jeune femme, réel, n’en demeure pas moins particulièrement balisé.
L’artillerie lourde
Paul doit quitter son « filon » en 1915 pour une batterie d’artillerie lourde. Cette affectation, si elle est moins dangereuse que l’infanterie, n’en demeure pas moins une exposition ponctuelle au danger. Marie pose beaucoup de questions, sur son rôle, sur le danger, sur les gaz. Paul souligne la dureté des engagements ; à Verdun, par exemple, le combat est très pénible et conduit rapidement à l’épuisement physique et nerveux (mai 1916, p. 152) : « Ici c’est l’extermination sur place sans voir l’ennemi. » et « Je me demande comment je reste debout après tout cela on est hébété. Les hommes se regardent avec des yeux effarés. Il faut faire un effort considérable pour tenir une conversation. » On le voit, Paul fait peu d’autocensure, et donne à sa femme les éléments du combat tels qu’il les vit. Cette description restitue très bien le bombardement allemand, avec une précision qui ici peut rassurer Marie, quoique… (p. 153) « Je profite non pas d’un moment d’accalmie pour t’écrire au contraire ça tombe tellement fort et si près que nous sommes obligés de rester à plat ventre donc j’en profite pour t’écrire couché entre deux rondins ils tombent quelques uns a 15 mètres ça nous couvre de terre et de fumée mais là ils ne peuvent pas nous attraper car il y a un petit talus devant étant plus haut nous nous risquons rien. S’ils dépassent avec la pente du talus ils sont obligés de tomber entre 12 et 20 mètres de nous donc couchés nous risquons rien mais c’est bien terrible nul être qui ne l’a pas vu ne peut se l’imaginer.»
Puériculture à la ferme
Lorsque Marie tombe enceinte, elle fait l’acquisition d’un livre de puériculture, fait à part à Paul de l’évolution de sa santé, de ses interrogations ; lui suit de près, autant qu’il le peut, l’évolution de la grossesse, donne des conseils médicaux ou diététiques. M. Hanna développe avec bonheur ce chapitre très réussi : comment nos témoins vivent la grossesse et les premiers jours du nourrisson dans une situation de guerre et d’éloignement, mais aussi en quoi ces acteurs, par leurs préoccupations médicales et hygiénistes, sont en décalage avec la famille et le reste du village. Paul croit aux bienfaits de la science et de la médecine et prend son rôle de futur père très à cœur : il insiste pour que Marie boive beaucoup de lait pendant la grossesse, revenant sans cesse à la charge, et finissant par faire céder les deux pères qui achètent une vache laitière ; de même, il insiste pour que Marie consulte un médecin en visite prénatale, ce qui ne se fait pas au village ; enfin il lui répète de ne pas aller aux champs, de s’économiser, conseils à contre-courant dans cette société rurale traditionnelle. L’autrice montre que les Pireaud profitent de leur éducation pour tenter d’accéder aux progrès médicaux dans lesquels ils ont foi : à cet égard, le « j’ai vu sur le livre… » (p. 206) de Marie est emblématique.
L’accouchement est difficile (13 juillet 1916, et elle le décrira plus tard en détail par écrit, ce qui est aussi une rareté) : le petit Serge est chétif, souvent malade, et Marie tait ses inquiétudes à son mari. Ce sont des lettres ultérieures qui raconteront les coliques convulsives, les dangers de l’allaitement au lait de vache, et les recours au médecin contre l’avis de la famille (mère et belle-mère, pourtant ni « hostiles ni indifférentes »). Atypique aussi est la décision de faire peser le bébé, ou la demande à Paul (p. 226) « de se renseigner sur les enfants des camarades de sa batterie, pour savoir s’ils étaient allaités par leur mère, ou s’ils prenaient des biberons ». Sur le moment elle lui cache la gravité de la situation, et contre l’avis des siens dépense de l’argent en consultations médicales et en médicaments, qui finissent par mettre enfin l’enfant hors de danger. C’est dans ce combat contre les habitudes séculaires, dans la confiance dans la médecine et dans cette complicité de couple que réside la véritable modernité, avec la prise d’autonomie de cette femme contre son milieu (juillet 1916, p. 231 ) : « Et dire qu’on ose me dire que s’etait rien que sa serait tres bien passer sans soin que tous ceux qui ont des enfants malades n’ont pas vite medecin est sage femme, aussi je t’assure que je ne repond pas tout ce que je pense, quoique quelque fois il s’echape quelques mots je ne veux plus penser a sa je le soignerer comme bon me semblera (…) » et en août 1916 p. 232 « si sa me plait d’appeler encore le medecin je le ferais et je parie que tu me blamera pas au contraire. » Avec la guerre qui durait, le mari et le père ont accepté que Marie touche l’allocation, et ce n’est pas en « colifichets et rubans » – critique commune des envieux – que l’argent est dépensé, mais en sage-femme, médecin, médicaments et nourrice. L’autrice montre qu’avec cet argent venu de l’extérieur « des services considérés comme trop coûteux pour la plupart des budgets étaient désormais à portée », l’allocation représentant ici une ébauche de protection sociale.
Un non-conformisme atypique
La question de la représentativité de ce couple paysan dans la guerre se pose évidemment et le prénom Serge, totalement absent au village ou chez les grands-pères, ainsi que le refus du baptême, lui aussi assez minoritaire, plaident pour l’exception. Paul est socialiste et incroyant, et c’est lui qui refuse le baptême pour son fils, contre l’avis de Marie, qui pense que cela peut protéger la santé de l’enfant (septembre 1916, p. 237) : «Quand à la question de baptiser tu dois savoir mon idée ce n’est nullement ça qui peut l’empêcher d’être malade. Je ne te demande qu’une chose c’est de ne pas le faire baptiser tant que je serais en vie Si je viens à passer de l’autre monde fais comme tu voudras. Toutefois si à sa majorité il fait partie des croyants il sera pour lui toujours temps de se faire baptiser. »
Divers
Paul souffre de son éloignement en Italie, du manque de permissions, de l’attente interminable de la démobilisation (p.406 « c’est une sorte d’esclavage ignoble. »). En témoignent aussi les choix de titres de chapitre, extraits de passages de lettres : ch. 4, « Nul n’est heureux à la guerre », ou ch. 5 « Nous sommes les martyrs du siècle ». Intéressant est aussi le fait qu’il signale non pas se mettre à boire, mais avoir découvert le vin (p. 295) « je me suis bien habitué au « pinard ». Il doit rassurer Marie, consternée car elle pense qu’il va revenir alcoolique (p. 307) « J’ai appris à boire j’aime bien boire en mangeant tu te rappelles que je ne pouvais pas boire 1 litre à un repas et maintenant j’en boirais bien deux mais j’ai appris à boire je n’ai pas appris à me saouler et sois tranquille je ne ferais jamais cet apprentissage.»
On notera en conclusion que beaucoup de correspondances entre couples au village sont moins denses, plus convenues, parfois moins complices que dans ce corpus. Il manque aussi souvent les lettres des femmes, non ramenées du front. Pour Martha Hanna, nos témoins montrent ici l’importance de la révolution cognitive entraînée par l’acquisition de la lecture et de l’écriture, elle-même liée à l’obligation scolaire de la fin du XIXe siècle. C’est la richesse et l’originalité de cette source épistolaire qui lui permet, autour de ces paysans de Dordogne, de construire cet intéressant travail d’anthropologie.
Vincent Suard, décembre 2023