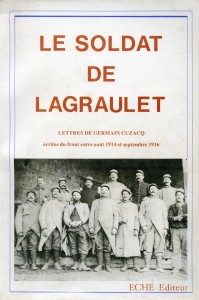1. Le témoin
Louis Plond, originaire de Nogent-en-Bassigny (Haute-Marne), exerce au moment de la mobilisation la profession de coutelier. Marié à Marthe en 1912, il a eu un fils, Raymond, en 1913. Il sert au 309e RI, régiment de réserve de Chaumont, et son théâtre d’affectation concerne le front de la région de Baccarat-Badonviller (Meurthe et Moselle). Les régiments changent régulièrement de théâtre d’opération durant le conflit, mais ce n’est pas le cas du 309e RI de l’auteur, qui reste dans ce secteur de transition entre plaine lorraine et moyenne montagne des Vosges, de septembre 1914 à sa dissolution en juin 1916. L’auteur est tué lors de l’attaque allemande du Col de la Chapelotte en avril 1916.
2. Le témoignage
Bernard Plond, petit-fils de Louis, a fait paraître aux Éditions Dominique Guéniot Mon grand-père, Louis Plond, Correspondance privée, 2 août 1914 – 27 avril 1916 (un Haut-Marnais dans la Grande Guerre), Langres, 2007, 223 pages. Le transcripteur, professeur d’histoire-géographie, avait découvert en 1977 dans la maison familiale 197 lettres de son grand-père adressées à sa femme et il en a restitué, une fois retraité, les éléments essentiels. L’organisation de l’ouvrage est originale : l’auteur a divisé le livre en huit chapitres thématiques (faits de guerre, conditions de vie, relations avec les autres militaires, etc.) avec à chaque fois une partie « transcription » (pages en gris), puis une partie « commentaire » (pages en blanc). Les parties « transcriptions » sont composées d’extraits littéraux de lettres de 3 à 10 lignes environs, et sont classées par ordre chronologique, et les parties « commentaire » donnent les explications et les appréciations du metteur en texte. L’auteur remercie en page de garde les auteurs de « La Chapelotte 1914–1918 », parmi lesquels Yann Prouillet.
3. Analyse
Le choix original de présentation d’extraits de courriers de Louis Plond présente l’avantage de donner immédiatement à la lecture les éléments les plus intéressants, en les synthétisant par thèmes. Les inconvénients de ce choix sont de deux sortes : la partie « commentaire » des extraits, d’abord, même si elle est sérieusement menée, débouche parfois sur de la paraphrase, c’est-à-dire une simple reformulation des sources sans apport extérieur suffisant ; en revanche, cette partie est tout à fait adaptée, par son souci pédagogique, à un lectorat non-spécialiste, qui est naturellement le public ciblé. D’autre part, le problème posé par la partie transcription est que, n’ayant pas la totalité du corpus, et ne pouvant donc pas juger des proportions et équilibres, on ne peut savoir si un extrait est représentatif d’une attitude sur un temps long ou s’il est anecdotique. L’auteur anticipe toutefois cette critique en apportant parfois des commentaires bienvenus d’ordre statistique, comme par exemple : «6 mentions de la censure sur 197 lettres. »
Dans la logique des deux premiers chapitres (« Faits de guerre » et « Conditions de vie »), le petit-fils souligne avec honnêteté que le témoignage n’apporte rien qui ne soit déjà connu. En effet, c’est l’illustration classique d’une relation épistolaire, non dénuée d’intérêt, d’un poilu à sa femme, pour lui raconter ce qu’il vit en ligne ou au repos. Les combats sont sporadiques mais violents (19 avril 1915, p. 28) « [nuit d’alerte – petit matin] Nous les attendons encore. Remarque bien, je ne les demande pas, mais l’ordre est donné de résister jusqu’à la mort. C’est bien beau les paroles ! Nous avons de bonnes tranchées, mais on n’est pas à l’abri des balles. Ne te tourmente pas pour cela. Je ne devrais pas te parler de ces choses- là. » L. Plond semble, s’il déteste les Allemands, qu’il nomme toujours les « Boches » (avec majuscule et guillemets), ne pas envier le sort de ses connaissances de Nogent partis avec le 109e RI sur des théâtres d’opération plus exposés, et il dit plusieurs fois se faire une raison (mai 1915, p. 32) : « Nous ne sommes pas heureux, mais ce n’est rien à comparer à ceux du Nord [offensive d’Artois] » ou août 1915, p. 37 : « On trime, quoique j’aime mieux trimer au travail que d’être en régiment d’attaque. » Il a des remarques pittoresques sur l’évolution de l’équipement ; ainsi en décembre 1914 il signale qu’ils vont toucher des salopettes bleues pour mettre sur leurs pantalons rouges. Le casque Adrian est peu goûté à ses débuts (octobre 1915, p. 39) : « On nous distribue des casques à la place des képis. Ca la fout mal ; on a tout du « Boche » avec ça ! ». Et la perception du couteau de tranchée n’évoque pas de « brutalisation » particulière des mentalités (septembre 1915, p. 37) : « On nous a distribué une nouvelle arme. Juge un peu si c’est moi qui pourrait me servir de cela : un couteau de boucher pour l’assaut des tranchées ! En effet, il ne faut point de prisonniers, il faut achever les blessés ! On « zigouille » tout ! Tu parles d’une sauvagerie ! Quand ils les ont distribués, on en voulait point. Il pourra rester longtemps dans la musette. »
Les relations entre les époux sont bonnes mais sans effusions particulières ; malgré l’interdiction, ils arrivent à se voir une fois à Baccarat, auprès d’une logeuse qui loue clandestinement des chambres et en vingt mois, ils se seront vus au total à trois reprises, dont une fois illégalement. L’auteur mentionne la nostalgie qu’il a de son petit garçon, et le regret de ne pouvoir le voir grandir (p. 184) « Voilà notre petit Raymond en culotte. C’est au moment où il aura été le plus amusant que j’en aurai été privé. Je suis bien en mal ! » On peut aussi citer une mention très intime (apparition des règles de l’épouse après une permission), qui nous renseigne sur les mentalités: la permission pousse-t-elle à engendrer ou au contraire, faut-il l’éviter ? (octobre 1915, p. 180) : « Je suis content de la bonne nouvelle que tu m’apprends pour le « débarquement ». Je ne m’en faisais pas car je savais bien ne pas avoir fait de bêtises. Ce n’est pas le moment.» Dans un tout autre domaine, l’auteur et beaucoup de ses camarades, employés en temps de paix dans des coutelleries, tentent de se faire affecter à l’arrière dans des usines métallurgiques, mais leur manque de spécialisation les fait constamment refouler (p. 172), « Dans ma compagnie, 25 avaient demandé, mais personne n’a été pris. ». Lorsque finalement un d’eux réussit à se faire détacher, cela déclenche un sentiment de désarroi, (« pour nous, ça fait drôle, il faut rester » p. 175), de jalousie ou de distanciation ironique, qui passe ici par la grivoiserie (p. 99) : « Le Louis Voilqué a écrit. Il est heureux à Paris. Il est chauffeur de four. Mais le four n’est pas encore monté. Il dit que les « mouquères » ne manquent pas et que les types mènent la belle vie avec. Enfin, en attendant de pouvoir chauffer son four, il pourra toujours chauffer les poules.» Le moral de Louis Plond, sur la durée globale de son engagement, n’est pas bon et cette tendance s’aggrave en 1916. Bien qu’il soit conscient, on l’a vu, de ne pas être dans un secteur d’offensive (Artois, Champagne ou Verdun), l’auteur dit souvent souffrir des dangers de la première ligne, des dures conditions météorologiques ou des travaux éreintants dans les bois à l’arrière. Ce cafard semble attisé par le fait que son unité reste vingt mois dans le même secteur difficile, qui n’en en rien un «filon ». Quelques extraits peuvent témoigner de ces humeurs moroses :
Mai 1915 « je dirais qu’on en a plein le dos. »
Octobre 1915 « c’est bien malheureux de souffrir pendant 15 mois, de se faire dégringoler de la sorte pour n’aboutir à aucun résultat. »
Avril 1916 « j’en ai par-dessus la tête. Je n’ai plus de courage. »
Avril 1916 « on s’use un peu tous les jours. On est fatigué de cette terrible guerre. »
Ce type d’énumération accentue évidement l’aspect sombre du témoignage, il y a aussi quelques bonnes journées, mais c’est le découragement qui domine, par exemple en mars 1916, un mois avant d’être tué (p. 84) : « On n’a jamais autant trimé que pendant ces treize jours qu’on vient de tirer. Tous, nous préférons être aux tranchées. En plus, on n’est pas bien nourris.» et il ajoute le surlendemain «Je viens de passer à la paie : 11 jours à 0.25, c’est bien maigre pour les journées comme on en fait. »
En définitive, l’aspect le plus intéressant du livre repose peut-être dans le résultat de la démarche du petit-fils Bernard Plond : celle-ci n’est pas simplement historique ou mémorielle, elle a aussi valeur de thérapie pour le présent ; au tout début du livre, après le départ de la grand-mère en maison de retraite, il décrit la découverte des lettres dans une « grande chambre nuptiale condamnée », restée intacte et inoccupée depuis 61 ans: il se rend compte alors d’un malaise diffus, qui a toujours existé dans son enfance, et du fait que sa grand-mère ne lui a jamais parlé de Louis. Il fait le lien avec sa perception d’une femme marquée à vie et qui n’est jamais parvenue à surmonter le deuil ; il la décrit comme une personne dépressive qui tenait des propos répétitifs (p. 13) « j’ai été veuve à 26 ans ! » ou « Pour ce que c’est que la vie ! ». En fin de volume, B. Plond rend alors hommage à son grand-père qu’il a découvert, témoigne du respect qu’il a pour son itinéraire « d’endurance et de souffrance », mais surtout prend conscience d’une situation qu’il a vécue enfant sans la comprendre, une angoisse, une souffrance ininterrompue basée sur le non-dit : il a pu « saisir un fait-majeur de sa propre existence.» et il termine son livre en soulignant pour lui le résultat de sa démarche (p. 218): « Aujourd’hui, je crois pouvoir affirmer que cette angoisse a fait place à une relative sérénité car elle a pris le visage de l’absent. (…) Au moins, vu sous cet angle, ma présente démarche n’aura pas été inutile. Il aura fallu deux générations et 90 années pour « apurer les comptes » avec la Grande Guerre ! »
Vincent Suard, décembre 2020