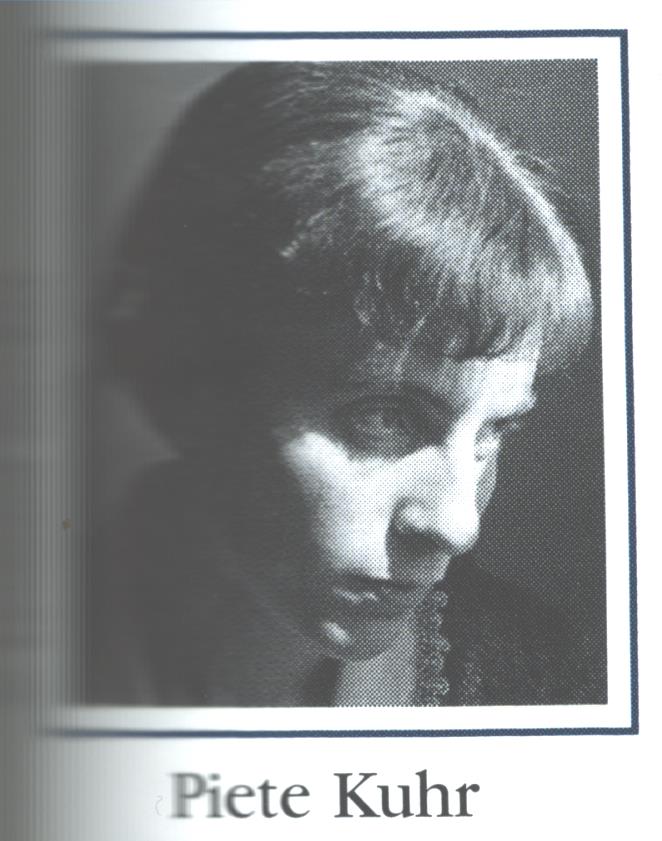1914 – 1918 La grande guerre d’Olivier Guilleux
1. Le témoin
Olivier Guilleux, né à Vouhé (Deux-Sèvres), est instituteur et sous-lieutenant de réserve au moment de la mobilisation. Il rejoint le 115e RI (Mamers), embarque pour la Bataille des frontières et près le combat de Virton, il marche en retraite jusqu’au 2 septembre, date à laquelle le 115 est transporté au Bourget. Après la Marne, il est blessé près de Noyon et fait prisonnier le 18 septembre. Restant en captivité jusqu’en juillet 1918, il aura fait une tentative d’évasion en mars 1918. Bénéficiant de l’accord sur les officiers prisonniers, il est interné en Suisse, puis il revient en France dès novembre. Reprenant ensuite sa carrière d’instituteur, il est directeur d’école primaire lorsqu’il décède prématurément en 1940.
2. Le témoignage
Les écrits de guerre d’Olivier Guilleux ont été édités en 2003, avec une introduction fouillée d’Éric Kocher-Marboeuf (Université de Poitiers, entretien par mail, mai 2024), chez Geste édition (300 pages). Le corpus est triple, avec d’abord les carnets du sous-lieutenant d’août 1914 jusqu’au 18 septembre ; ce document, rédigé sur le vif et sauvegardé (il avait été confié à un homme qui a réussi à éviter la capture), a été repris avec une rédaction soignée après la guerre, mais sans modification sur le fond. La partie centrale est constituée par la correspondance du prisonnier avec sa famille, pendant la durée de la guerre ; enfin un récit de son évasion rédigé a posteriori forme la troisième partie. Il existe par ailleurs un fonds Olivier Guilleux aux AD des Deux-Sèvres (79).
3. Analyse
A. Carnet de campagne (août – septembre 1914)
Les deux temps forts des carnets sont le combat d’Ethe (Virton) le 22 août et le récit du combat qui voit sa capture dans l’Oise, lors de l’arrêt du repli allemand après la bataille de la Marne. Il écrit le 22 août (p. 45, avec autorisation de citation de Geneviève Gaillard, petite-fille d’O. Guilleux, mai 2024) : « Nous avons reçu le baptême du feu. Et, dans quelles conditions ! Pendant quatorze heures, le 115e, après avoir attaqué, contre-attaqué, s’est cramponné aux mamelons situés au nord-est de Virton et à la lisière de la ville sous un feu d’enfer de l’artillerie et de l’infanterie prussienne. Voilà ce que j’ai vu. (…)» Il décrit l’impuissance sous le feu, car l’ennemi n’est pas visible, mais aussi sa résistance énergique, avec l’épisode d’une panique de deux sections sans officier « débouchant de la vallée sur la route », criant « ils sont là, ils viennent » (p. 48). Un capitaine, un peu en arrière et en surplomb lui crie : « Guilleux, Guilleux, quelle déroute, arrêtez-les !» Notre auteur tire son revolver et se place devant les fuyards : « Le premier qui essaie de se sauver, je lui brûle la cervelle.» Il explique n’avoir jamais éprouvé une pareille émotion, et qu’il aurait tiré si un soldat avait passé outre, car c’était tout le groupe qui partait, et « avec le groupe, ma section. ». L’auteur décrit ensuite une longue retraite qui les amène à Dun-sur-Meuse, et réfléchissant aux opérations, il estime que l’état-major [de la DI ?] a failli, s’engageant trop vite et sans prendre de précautions. Quelques jours plus tard, il évoque l’assassinat des civils d’Ethe (plus de 200 morts) qui a suivi leur passage (p. 58) «(…) les Allemands firent un massacre de la population civile sous prétexte que des francs-tireurs avaient tiré sur des soldats allemands. Mais le commandement veut surtout, par des exemples, frapper de terreur les habitants et les empêcher de réagir. C’est dans leur méthode. » Transféré en train vers Paris le 2 septembre, le 115e RI se dirige sur la Marne par Meaux, mais n’est pas engagé au début de la bataille. L’attitude des hommes envers les trophées allemands est devenue blasée (p. 77, 11 septembre) « Maintenant, ils se soucient peu de se surcharger. Ils passent, s’arrêtent, examinent, manient tous ces objets, puis, neuf fois sur dix les laissent sur place. » Dans l’Oise, à partir du 14, la résistance allemande est plus conséquente, et O. Suilleux rapporte les récits des habitants rencontrés, décrivant la brutalité des envahisseurs (pillage, incendie, viols, assassinats de suspects). Le combat local qui mène à sa capture est raconté de manière très précise, et le caractère haletant du récit est probablement lié au fait qu’il revit ces scènes, au moment où il remet au propre ses notes après-guerre. Touché aux jambes par des éclats lors d’une reconnaissance offensive, il lui faut attendre les Allemands, immobilisé dans une ferme. Il est ensuite soigné à l’hôpital de Noyon, par des infirmières françaises sous la direction de médecins allemands. Dix jours plus tard, il est transporté en Allemagne à Magdebourg, d’abord au Lazaret puis au camp de prisonniers.
B. Correspondance du prisonnier
La correspondance d’Olivier Guilleux doit se lire en tenant compte d’un double filtre : d’abord celui d’une autocensure, d’un contrôle de ses sentiments : il veut rassurer sa famille, montrer que le moral tient ; c’est probablement vrai, car c’est un homme dynamique, qui récupère rapidement de sa blessure et s’investit beaucoup dans les activités sportives du camp, mais l’absence de mention de cafard ne signifie pas qu’il n’en éprouve pas. Par ailleurs, les lettres sont lues par un censeur, et les informations qui peuvent passer sont limitées : temps qu’il fait, activités, compte-rendu des colis reçus ou en attente, etc… Ces deux prismes finissent par produire une ambiance assez lénifiante un peu trompeuse: la tentative d’évasion, par exemple, ne cadre pas avec l’ambiance somme toute supportable évoquée dans les courriers.
Dans ses lettres, O. Guilleux évoque souvent ses activités multiples, il décrit un programme chargé en août 1915 (p. 135) « Je suis arrivé, non sans effort, à me créer une vie active. Je tue le temps à force de travail.» Il ne se plaint pas de ses conditions de captivité –le pourrait-il ? –, et le sort des officiers prisonniers, non astreints au travail, n’est pas celui des hommes du rang ; ainsi par exemple, du printemps à Halle (mars 1916, p. 144) : « Le soleil est de jour en jour de plus en plus chaud. (…). Chaque officier achète son petit pot de fleurs. Ici, on vend surtout des jonquilles. » « Positiver » devient de plus difficile avec le temps, et on lit la lassitude entre les lignes : (p. 166 Hann-Münden, mars 1917) « Je me suis remis au russe avec courage. Je vais pouvoir arriver assez vite à quelques résultats. Je ne néglige pas l’anglais, non plus. Malgré tout, après presque trois ans de captivité, l’esprit manque un peu de fraîcheur et le rendement ne correspond pas toujours au travail. Mais ceci est secondaire. L’essentiel n’est-il pas d’éviter le « gâtisme » sous toutes ses formes. » Le seul moment repéré dans la correspondance où on peut considérer qu’il trompe la censure est celui des vœux anticipés pour l’année 1917 (p. 152) « Mais il est d’autres vœux que j’aurais tant aimé vous formuler sur le front à côté des camarades. D’ici je ne peux y faire qu’une discrète allusion. Mais vous me comprenez. » (…) « C’est cette conviction qui nous rend supportable une aussi longue captivité. »
Correspondance de la famille
Ses parents et ses sœurs lui racontent les travaux des champs, l’évolution du jardin, les progrès académiques des deux sœurs qui sont élèves institutrices. Ici un extrait affectueux montre le soin que l’on a de reconstituer l’ambiance familiale malgré l’éloignement (p. 120) :
« Vouhé, le 16 février 1915 Cher petit frère
Nous venons de dîner, je m’empresse de t’écrire. Je voudrais t’envoyer une bonne longue lettre qui te ferait bien plaisir. Papa, un peu enrhumé, est dans un fauteuil, Champagne sur les genoux ; grand-père se chauffe, maman, près de la lampe, tricote (…) »
Sur des photographies de prisonniers français en 1918, certains uniformes semblent encore en bon état après quelques années de détention : une mention – pour les officiers – apporte ici un éclairage intéressant (août 1915, p. 130) « Nous irons à Parthenay te commander une culotte et une vareuse chez le tailleur du régiment. Aussitôt que ce sera fait nous te l’expédierons avec ta capote. » Dans l’Allemagne affamée de 1917, il est aussi difficile de survivre avec l’ordinaire du camp, et nous avons deux descriptions très utiles de colis, d’abord de la part de sa sœur Claire (août, p. 186) :
« demain, maman te fera un colis de pommes de terre ; dans celui de jeudi, il y avait : pain, beurre, lard, tapioca, végétaline, riz, prunes, sucre. »
Puis, de la part de l’auteur, un récapitulatif de ses demandes (novembre, p. 202) :
« (…) envoyez-moi un colis par semaine composé comme suit : pain, beurre, une boîte de corned-beef, une boîte de conserves faites à la maison, chocolat, riz, café ou thé ou cacao. En plus, une fois par mois envoyez-moi un colis contenant des légumes secs. Envoyez-moi également chaque mois deux colis de pommes de terre (dans le premier, vous mettrez une boîte de végétaline, dans le second, une bouteille d’huile). (…).
C. L’évasion
La narration, rédigée après la guerre, indique que la proximité de la frontière hollandaise (une semaine de marche) [de Ströhen, 250 km., une proximité toute relative], la découverte d’un uniforme allemand dans une cache aménagée dans une cloison par des Anglais depuis transférés, et la perspective d’une vie « s’annonçant rude, triste, misérable » l’ont décidé à sauter le pas. Il se cache dans un cellier à charbon à 50 mètres du camp, puis décrit une errance d’une semaine, rapidement épuisante malgré son entraînement physique, à cause du manque de vivres, de sommeil (il se cache le jour dans des bosquets chétifs) et surtout de la perte d’orientation, car il n’a pas de carte. (p. 254) « J’avais perdu toute direction et m’en remettais au hasard. ». Il est à bout que lorsqu’un garde barrière l’interpelle le 7e jour, et il n’a plus la force de fuir. Ramené au camp, estimant bien s’en tirer en n’étant pas passé à tabac, il est condamné à 4 mois de cachot. Il est tellement épuisé au début qu’il ne s’aperçoit pas des rigueurs de sa détention, mais rapidement l’interdiction des colis se fait ressentir (p. 269) « À ce régime, je ne pourrais tenir longtemps. » Cette mention est instructive, notamment sur le sort des camarades sans colis, ou des Russes, Serbes ou Roumains…. La corruption d’une sentinelle allemande par un camarade améliore son ordinaire mais c’est surtout grâce à la visite du Consul d’Espagne, qui à l’occasion d’un passage au camp, vient écouter ses doléances au cachot, qu’il ne fait « que » deux mois d’isolement. Il bénéficie ensuite de l’accord de transfèrement pour internement en Suisse en franchissant la frontière en juillet 1918. Le 1er novembre, il écrit de Genève qu’il est inscrit à l’université et qu’il a établi un beau programme, mais (p. 287) « Je ne crois pas pouvoir le remplir car mon internement en Suisse ne saurait se prolonger. (…) La grippe sévit en Suisse avec rage. Les cas mortels sont assez nombreux. Le mieux est de ne pas y penser. »
Donc un document intéressant sur le combat de 1914, ainsi que sur le vécu de la détention d’un officier capturé très tôt, mais avec un caractère un peu irénique, comme on l’a vu, à lire avec les clés nécessaires pour appréhender la réalité vécue. C’est une bonne référence aussi sur ce que peut être concrètement un processus d’évasion (voir aussi Charles de Gaulle, Jacques Rivière ou Roland Garros…), thème assez populaire entre les deux guerres, la création de la médaille des évadés datant de 1926.
Vincent Suard, décembre 2024