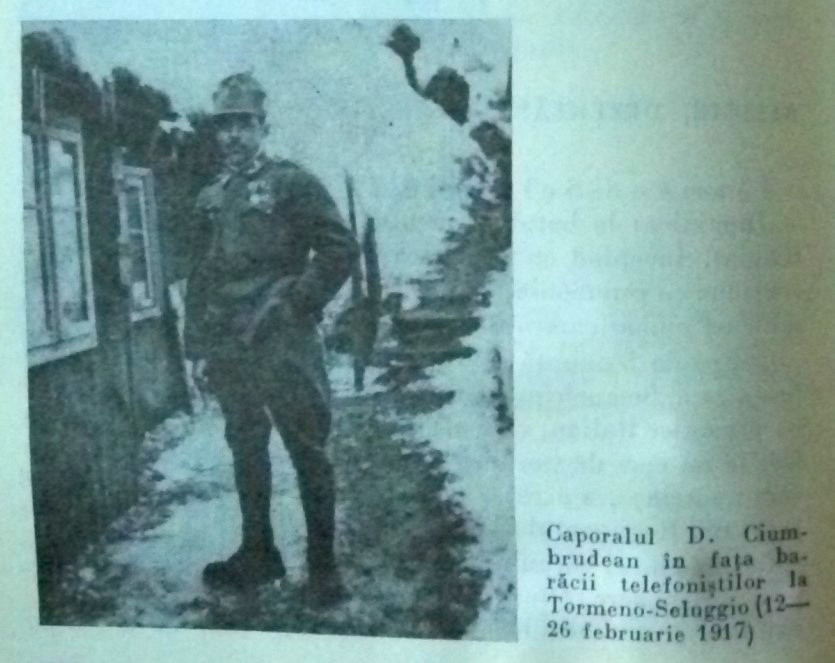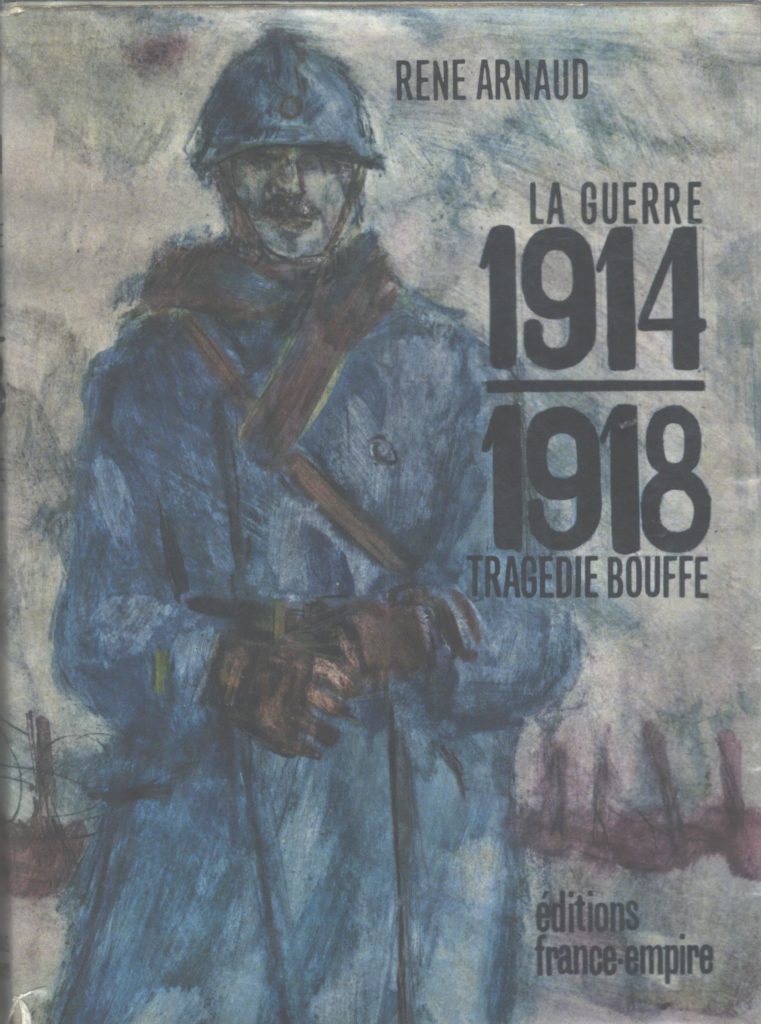De l’Artois aux Flandres 1914 Souvenirs d’un officier du 158e
1. Le témoin
Pierre Riondet (1866 – 1942) est un officier de carrière venu du rang, passé par l’école de Saint-Maixent, il a servi dans la Gendarmerie. Capitaine dans la Garde Républicaine quand arrive la guerre, il assure d’abord des missions de protocole, puis de service d’ordre et de place à Paris. Il prend ensuite un commandement au 158e RI, en Artois (octobre 1914) et en Flandres (novembre 1914) ; blessé, et par ailleurs de santé fragile, le commandant Riondet revient au front pour l’offensive de mai 1915, mais il est ré-évacué en juillet 1915 et dès lors il exercera des missions diverses à Paris jusqu’à l’Armistice. Passé hors-cadre, et jusqu’à 1936, il a été adjoint au commandant militaire du Sénat, offrant aux sénateurs ses talents de polyglotte, pour des traductions variées.
2. Le témoignage
« De l’Artois aux Flandres 1914 », Souvenirs d’un officier du 158e, de Pierre Riondet, a paru aux éditions Bernard Giovanangeli en 2012, (138 pages). Claude Vigoureux, auteur par ailleurs d’ouvrages historiques, connaissait depuis longtemps l’existence de ce manuscrit, écrit par un cousin de son grand-père maternel. Il l’a retranscrit, annoté et présenté, avec un dossier biographique et deux photographies. Il indique qu’il est vraisemblable que P. Riondet destinait ces pages à la publication, car il avait déjà donné des articles à différentes revues (avec autorisation de C. Vigoureux pour les citations).
3. Analyse
La période couverte par les souvenirs du commandant Riondet représente environ quatre mois, de la fin juillet 1914 à la fin de novembre. C’est d’abord un capitaine de la Garde Républicaine de 48 ans qui assure à la mobilisation des tâches diverses, comme la surveillance de l’embarquement des mobilisés, le signalement et l’enquête sur des individus suspects (espionnage), ou le transfert des prisonniers de la prison de Fresnes lorsque les Allemands approchent de Paris… Un des deux principaux intérêts de l’ouvrage (l’autre étant la description de la bataille d’Ypres) réside dans la relation de l’embarquement des soldats à la gare de « Saint-Germain-Ceinture » (Saint-Germain-en-Laye-Grande-Ceinture) à l’ouest de Paris, il supervise le départ des trains pendant la première quinzaine d’août 1914; sa relation du départ fait état d’un grand calme de la foule, de bonne volonté sans effusions extrêmes : le récit est-il rédigé ici pour lui-même ? Pour un projet de publication ? (p. 31) « À l’heure des trains, je passais au milieu de cette foule pour prévenir ; adieux silencieux, pas un cri, pas une larme ; pas d’exaltation non plus : chacun s’en allait, suivant docilement les indications (…). Ceux qui restaient, mères, jeunes femmes, grands-parents survivants de 70, restaient sans protester en dehors de la gare, s’approchaient des barrières et regardaient sans mot dire, agitant leur mouchoir dans un dernier adieu au moment du départ du train, et s’en allaient la tête haute, quand il avait disparu, quelques-unes essuyant furtivement une larme dont elles avaient souvent l’air d’être honteuses… » L’auteur évoque aussi le passage des trains de réfugiés italiens, qui voyagent parfois dans de dures conditions (wagons à découvert) ; début septembre, c’est le spectacle des trains de réfugiés et leur « défilé lamentable » dans Paris, ou le choc de la vision des premiers trains de blessés ; il est d’ailleurs chargé d’empêcher les blessés légers d’entrer dans Paris, où « d’aucuns, paraît-il, s’étaient perdus » (p.43).
Volontaire pour le front, il prend le commandement d’un bataillon du 158e RI en Artois en octobre 1914 (il est promu commandant à cette occasion) ; il décrit une unité très éprouvée par les combats qui ont précédé sa venue, et son évocation de Mazingarbe et Vermelles est courte mais précise, décrivant les lignes qui passent devant les habitations de mineurs (p. 59) : « Tous ces corons avaient été occupés un moment par les Allemands, puis repris par nous. Tout y était dans un désordre inexprimable ; les murs avaient été percés et l’on passait de l’un à l’autre, à l’abri des rues et, relativement, des coups. »
Le second intérêt de l’ouvrage réside dans la description de la Première Bataille d’Ypres à laquelle l’auteur a participé, lors de la poussée allemande de fin octobre-novembre 1914. L’auteur décrit au ras du sol les violents affrontements, sans répit et avec des effectifs fondants, entre combats en rase-campagne et début de la guerre de position. Ses fonctions à la tête d’un bataillon lui permettent d’avoir une bonne vue des opérations, et de les restituer clairement pour le lecteur. Le récit est tendu, haletant. Ainsi dans un passage, l’auteur, épuisé, doit prendre un moment de sommeil ; il est réveillé par un lieutenant qui lui apprend que le colonel Houssement, commandant le régiment, (4 novembre, p. 95) : « venait d’être tué au bord d’une tranchée de première ligne, et que je prenais dès lors le commandement du régiment. Je ne compris pas tout d’abord, mais peu à peu, la réalité se présenta à moi. J’étais atterré et navré… Il n’y avait pas quinze jours que j’étais au front et je me voyais chef, responsable de tout un régiment, en plein combat, sur une position importante qu’il fallait conserver à tout prix. Je ne pense pas que jamais officier ne se soit trouvé en situation plus tragique. » Bien que de « culture gendarmerie», c’est-à-dire peu entraîné à la direction du combat d’infanterie, il semble s’en sortir à peu près bien.
L’auteur décrit à un autre moment une tranchée pilonnée, dont les effectifs fondent, et que les occupants rescapés demandent à évacuer : il refuse et trouve péniblement deux sections de renfort qu’il envoie, (p. 100) « L’une de ces sections perdit 15 hommes pour faire 100 mètres environ, en rampant, tellement la crête était balayée par les balles. » En effet, si ténues soient les altitudes, vers Wijtschate ou Messine, la Flandre n’est pas plate et chacun cherche à surplomber l’ennemi. Le régiment qui tient sa gauche cède, « Les Allemands se lancèrent à la baïonnette sur cette partie de la position et, au moment où ils arrivaient à la tranchée, les occupants jetèrent leurs armes et se rendirent. Un capitaine de la barricade tua d’un coup de feu l’officier qui se rendait avec ses hommes… Les Allemands commencèrent à se rabattre sur nous. » La situation finit par être rétablie au terme d’un dur combat.
La nuit venant, il reçoit en soutien une compagnie de territoriaux : «Elle était commandée par un ancien officier démissionnaire qui me parut étrange ; il devint fou, en effet, le lendemain. Je lui expliquai ce que j’attendais mais je ne parvins pas à me faire comprendre. » Le lendemain, dans le brouillard, sur une ligne à peu près rétablie, il reçoit, avec des renforts, un ordre d’attaque du C.A., ses hommes épuisés « devant se mettre en marche vers l’avant dès qu’ils seraient atteints par les éléments de troupe d’attaque, pour servir de guide. » Sceptique, à cause l’état d’usure de ses hommes, il prévoit l’échec inéluctable qui ne manque pas de se produire. (p. 105) «Cet ordre me parut singulier, mais je n’eus pas le temps de réfléchir longtemps (…) Le même ordre, du reste, contenait autre chose : il prévenait que l’artillerie avait reçu l’ordre de tirer et la cavalerie de charger sur les hommes que l’on verrait quitter les lignes de combat pour se porter en arrière. C’était probablement la capitulation des Méridionaux, la veille, qui avait inspiré le chef qui avait donné de tels ordres ; (…) Le chef, du reste, qui avait donné cet ordre, et celui qui l’avait rédigé, furent relevés de leur commandement quelques jours plus tard. »
À la mi-novembre, il est à Saint-Éloi, au sud-ouest d’Ypres, et il évoque la totalité du front septentrional dont il perçoit la réalité : (p.113) « Pendant que nous dinions et bavardions, les propriétaires de la maison faisaient en commun et à haute voix la prière du soir dans une pièce voisine. Une prière en flamand, longue et recueillie : grands-parents et petits-enfants, maîtres et domestiques. (…) Je passai une partie de la nuit dehors, à écouter cette canonnade, à regarder les éclairs à l’horizon, à écouter le ronflement et le fracas des très gros obus que les Allemands envoyaient sur Ypres, du nord-ouest et du sud-est. Toute la nuit, depuis l’extrémité de l’horizon du côté de la mer, jusque vers le sud, vers La Bassée et Lens, je sentais le sol trembler sous moi sans arrêt, comme en un mouvement sismique continu. Jusque-là, je n’avais jamais entendu que les canons proches de moi ; à la distance où je me trouvais, j’entendais ceux de toute la ligne : c’était grandiose et terrifiant… » Dans des combats ultérieurs de novembre, faisant toujours fonction de commandant du 158e, il tente, en courant, de rallier des hommes qui gagnent l’arrière sans ordres, tombe dans un fossé à cause de « la nuit épaisse » et se démet gravement l’épaule. Il finit par devoir être évacué et c’est à ce moment que s’interrompent ces carnets, ponctuels, mais documentés et évocateurs.
Vincent Suard juin 2021