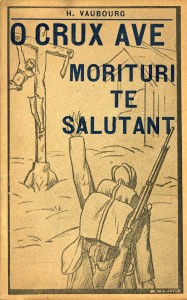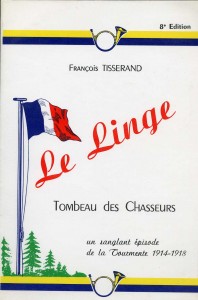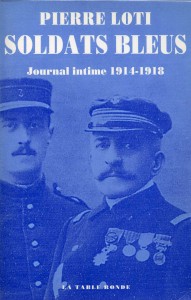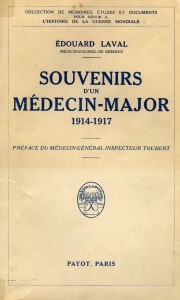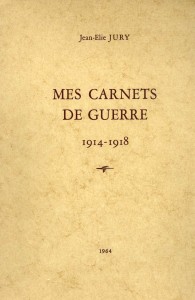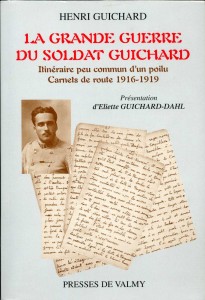1. Le témoin
Émile Carrière est issu d’une famille protestante des Cévennes, filateurs de soie et pasteurs. Interne au lycée de Nîmes, il obtient le baccalauréat scientifique, puis fait des études de chimie à Nancy. Enseignant en lycée, il est agrégé en 1911 et prépare un doctorat, qui ne pourra être soutenu qu’en 1921. Marié en 1910, il a deux jeunes enfants lorsque la guerre éclate. Il est alors mobilisé au 40e RI qu’il quitte en janvier 1915 pour entrer dans la fabrication des explosifs à Sainte-Menehould, puis à Givry-en-Argonne, enfin à la poudrerie de Toulouse, en octobre 1915. Là, il peut mener une vie familiale et il reçoit un salaire. À l’armistice, il est chef de laboratoire à la poudrerie de Bergerac. De février à septembre 1919, il remplit des fonctions de contrôleur de la Badische Anilin. Après la guerre, il devient maître de conférences, puis professeur de chimie à l’université de Montpellier jusqu’en 1970. Il meurt à l’âge de 95 ans.
2. Le témoignage
Le livre Émile Carrière : Un professeur dans les tranchées 1914-1916 est présenté par son petit-fils Daniel Carrière (Paris, L’Harmattan, 2005, 206 p.). Il contient la transcription (sauf certains propos intimes) du carnet de guerre tenu entre le 24 août et le 2 décembre 1914. Celui-ci s’interrompt à peu près au moment où le chimiste commence à solliciter diverses interventions pour obtenir un poste plus conforme à ses capacités : « Il serait bien plus intéressant pour moi de préparer les explosifs que de les employer. » Le 9 septembre 1914, il écrivait : « La transcription de mes pensées, de mes sentiments sur ce carnet constitue le seul exercice intellectuel que j’accomplisse encore. […] La vie que nous menons tue l’esprit, étouffe toute personnalité. […] Parce que je porte le même uniforme qu’eux, les propres ouvriers de mon père se croient immédiatement autorisés à me tutoyer, à me parler grossièrement. Nous vivons tous ici dans un état de promiscuité physique et morale extrême. » Tenir un carnet implique cependant d’avoir choisi « un frère d’armes » chargé de l’envoyer à la famille en cas de décès.
De janvier à décembre 1915, quelques extraits de lettres permettent de le suivre dans ses nouvelles fonctions. Dès le 29 janvier, il signale qu’il peut enfin écrire à l’encre : « Ce simple détail indique le changement survenu dans ma situation. » Les extraits de lettres n’occupent que 39 pages, contre 148 pages pour le carnet.
3. Analyse
Dès le départ (24 août), le professeur note ses réflexions : « Je suis heureux de cette occasion qui s’offre de mesurer que je suis capable de sacrifice et de courage. Je tirerai quelque fierté d’avoir participé à la revanche du droit sur la brutalité, au triomphe de la civilisation sur la barbarie, à la victoire de la liberté sur l’oppression. La France au rayonnement universel ne peut vivre que si ses enfants sont capables de sacrifice. J’ai été appelé à défendre ma patrie, je prends l’engagement d’accomplir fidèlement tout mon devoir. » Le baptême du feu apporte quelques nuances (31 août) : « L’hallucinante pensée que la vie, ce bien sacré, ne m’appartient pas s’impose à mon esprit, révolte ma raison. Tout mon être clame son désir de vivre et la collectivité m’oblige à affronter la mort. Quel droit exorbitant ! »
Il consacre de belles pages à la description d’une marche de nuit (4 septembre) puis d’une rêverie sous le firmament (23 septembre) et du paysage des hauts de Meuse (11 octobre) ; il oppose la belle nature aux visions d’horreur (ruines de village, tranchée remplie de débris humains). D’autres pages exposent son souci de l’éducation de ses enfants et sa compréhension de l’angoisse que doit éprouver sa femme, un exemple de plus qui montre comment la guerre a fait (re)découvrir et exprimer les sentiments d’amour.
Des notations ponctuelles critiquent la faiblesse du commandement, le manque d’organisation méthodique, « aussi le moral des hommes est-il déprimé » (dès le 1er septembre). Beaucoup de soldats pillent (4 septembre). Émile Carrière voudrait bien rapporter quelques souvenirs : « un casque à pointe serait d’un assez joli effet dans notre salon ! » Il défend l’honneur du 15e Corps qui s’est vaillamment battu. Il évoque les primes promises pour la capture d’ennemis, les mensonges des journaux, un « lieu de plaisir et de prostitution »… Le 16 octobre, à Béthelainville, il assiste à une exécution capitale. Il écrit à ses parents qu’il utilise une sorte d’armure faite de plaques d’acier (5 janvier 1915)…
Il participe à une attaque inutile, le 17 septembre : « Comme la pluie recouvrant d’eau mes lunettes m’empêchait de rien voir, j’ai tiré quelques balles au hasard sans viser puis j’ai fait le mort jusqu’au moment où j’ai cru pouvoir me retirer sans trop de danger. » Dès le 29 septembre, il a conscience du prix que coûtera la guerre, en ressources financières et humaines. C’est l’infanterie qui a les plus lourdes pertes et il donne déjà le conseil à son fils de devenir artilleur. Contre les obus, le fantassin est sans défense : « La plupart des hommes qui sont tombés frappés, quelques-uns à mort, l’ont été d’une façon invisible. Sur le champ de bataille, la mort plane partout, sa présence est rendue sensible à tous les combattants même les plus courageux, cependant l’on cherche en vain l’ennemi » (29 septembre). L’existence qu’il mène lui paraît un cauchemar, mais il faut tenir car la victoire finale n’est pas douteuse. Tous les projets de domination du monde, comme celui de l’Allemagne, se sont finalement effondrés. Le 9 octobre, il écrit une belle page où il définit sa conception du patriotisme : il faut combattre afin que la France « vive, dure, progresse, demeure une source de rayonnement intellectuel, un foyer intense de civilisation » ; le devoir, accepté avec résignation, « pour si terrible qu’il soit », consiste à défendre « nos biens, nos libertés si chèrement acquises par nos ancêtres, nos destinées, notre dignité collective et individuelle qui sont en péril. Il ajoute qu’en cela comme en toute chose il recherche avant tout sa propre estime.
Nouvelle attaque, le 29 octobre, après distribution d’une « ration importante d’eau-de-vie ». Elle échoue avec des pertes, face aux barbelés et à une « pluie de fer ». Le commandant conclut : « Vous vous êtes bravement, courageusement battus. Vous avez rencontré des obstacles insurmontables, c’est pourquoi votre assaut n’a pas abouti… » Émile Carrière ne dit pas nettement que les chefs auraient dû s’en apercevoir avant, mais il insiste sur l’indignité, la barbarie de la guerre, une calamité, un fléau. Quelques jours après (2 novembre), il critique la préparation insuffisante des chefs. Pourquoi avoir laissé l’ennemi pénétrer en France au lieu de lui opposer des retranchements tels qu’on les pratique aujourd’hui dans une nouvelle guerre de siège ? Pourquoi être entré en guerre en pantalon rouge ? sans artillerie lourde ? avec un système de santé inefficace ? Les soldats se désespèrent. Leur unique préoccupation est « la fin de cette calamité sans exemple que nous subissons ». La lassitude des soldats contraste avec l’optimisme de l’arrière (5 janvier 1915) : « Notre entêtement ne nous sera-t-il pas préjudiciable ? Ne conviendrait-il pas de traiter sur les bases du statu quo ? » Et, le 10 janvier, constatant que « ceux qui font simplement leur devoir sont des dupes », il justifie ses efforts pour en « sortir » : « Je crois avoir accompli mes devoirs envers la Patrie, que d’autres payent aussi leur dette. »
Devenu fabricant d’explosifs, il écrit, le 26 avril : « J’ai à nouveau retrouvé tout mon optimisme, relativement à l’issue de la guerre. » Et le 27 mai, à propos des Allemands : « Ils apprendront, ces barbares, ce qu’il en coûte de violer de grandes lois morales. Ils se seront déshonorés pour des siècles et ils auront conduit leur pays si prospère à la ruine et à la déchéance. »
Rémy Cazals, décembre 2011
Vaubourg, Henri-Louis (1875-1935)
Henri-Louis Vaubourg est entrepreneur de travaux Publics au Val d’Ajol dans les Vosges, société créée en 1850 et située en face de la gare. Il a 39 ans et est donc mobilisé comme réserviste. Technicien, cela semble logique qu’il soit affecté au 5e régiment du génie de Versailles auquel il dit appartenir en août 1914 (page 13). Il effectue en guerre de multiples emplois et dit après sa blessure, « le 10 février 1919, je quittais l’hôpital de Beauvais. Deux jours après, à Bourges, par un détournement de majeure, je ravissais à l’assistance Publique sa plus jeune surveillante » (page 323). On sait après guerre qu’il aura des enfants, dont Jacques, né en 1924, à qui il dédiera son pacifisme.
Vaubourg, H., O crux ave. Morituri te salutant. Val d’Ajol (Vaubourg), 1930, 323 pages.
Henri Vaubourg reçoit l’ordre de mobilisation à Versailles et rejoint le régiment du 5e génie, affecté à la compagnie de réserve des chemins de fer à Lyon. Il précise alors que la mobilisation effectuée par train nécessitait de la part de la compagnie des chemins de fer un effort énorme et de la part du gouvernement une surveillance accrue pour éviter d’éventuels sabotages. « Dans toutes les régions de France, une compagnie de sapeurs de chemins de fer fut envoyée à la mobilisation, avec tout le matériel de secours nécessaire. Stationnant à un nœud important de voies ferrées, elle était prête à intervenir immédiatement pour réparer les dégâts, si un accident se produisait dans son rayon d’action ». Ce qui ne se produira pas, reléguant Vaubourg à des emplois éloignés de la guerre. Il est alors affecté comme chef de gare à Pont-à-Mousson où un accident stupide – l’éclatement d’un détonateur d’obus – l’oblige à un séjour hospitalier à Nancy dont il décrit l’ambiance. Sorti peu de temps après, Noël 1914 est passé « au front », dans la forêt de Champenoux.
Milieu avril 1915, il est affecté dans une compagnie de réservistes territoriaux à Lempire (Landrecourt-Lempire), dans la région meusienne où il participe à des constructions de voies ferrées. Il en profite pour visiter et décrire Verdun et quelques impressions avant de bouger à nouveau pour participer à la construction du funiculaire de Bussang, dans les Vosges, qu’il quitte à la veille de Noël 1915. Il est affecté à Perrigny où un grand centre de triage ferroviaire est projeté puis à Clermont-Oise pour du terrassement et enfin à Proyart (Somme) où un ravin est à combler de remblais.
Septembre 1916, le territorial doit organiser la gare de Montauban-de-Picardie puis de Guillemont (Somme).
Aux alentours du début de 1917, sur sa demande, Vaubourg parvient « au piston » à se faire verser dans une unité combattante et rejoint le 152ème R.I. au dépôt divisionnaire de la 164e DI à Château-Thierry. Il va d’ailleurs, à cette place, contempler la détresse de l’armée qui sombre dans les remous des mutineries de 1917. Témoin de réunions antimilitaristes, il nous affirme qu’ « à l’arrière, c’est lamentable ». Les trains dégradés amènent un lot d’apaches débrayés, pris de boissons fortement, gardés par les gendarmes avant que le général Pétain ne « brise dans l’œuf l’anarchie naissante ». Pour ce faire, il créée des sections de discipline divisionnaires, unités chargées de mater les punis (à une moyenne de cinq ans de travaux publics avec suspension de peine) et les récalcitrants. Il en explique d’ailleurs le fonctionnement et les caractéristiques des sections disciplinaires (page 162 à 166). Gradé, Vaubourg en sera l’unique volontaire et fera ses armes à Dormans où il prend en main, hors du front, cette bande d’hommes « peu sûrs ». La discipline étant la force des armées, ces sections seront un véritable succès et la rébellion définitivement matée.
Le 25 juin 1917, le 152e est à Craonnelle, où il participe à l’affaire de la Caverne du Dragon et l’hiver 1917 transporte la section de discipline à Verdun, où elle est chargée du ravitaillement des troupes en ligne. Six mois plus tard, la section passe au 133e RI à Blainville-sur-l’Eau, dans la forêt de Parroy puis Neuilly-Saint-Front (Aisne) où s’est déclenchée la Friedensturm. Balancé sur divers points de l’arrière front, il se trouve le 17 juillet à Chezy-en-Orxois (Aisne). Le 15 août, il sauve des blessés contaminés par un obus à gaz et est atteint aux yeux ; aveugle, il est transféré à l’hôpital de Bourges. Là, il fait un long rêve allégorique (41 pages) emmenant ses hommes au Paradis. Il termine la guerre sur son lit de souffrances, qu’il ne quittera que fin décembre. Attiré par les femmes, qu’il parvient à côtoyer tout le long de sa campagne, il se marie au début de 1919.
3. Résumé et analyse
L’auteur nous donne à lire un livre simple et très singulier. En effet, mobilisé comme réserviste, il ne verra le front que par épisodes encore éloignés et bien que gradé, n’accèdera pas à une unité combattante. Vaubourg ne nous trompe pas d’ailleurs et l’affirme lui-même à plusieurs reprises ; « je ne vis pas grand’chose à la bataille ». Il donne ainsi une bonne définition de lui-même « guerrier jusqu’auboutiste pour la défense de mon pays, je répugnais au meurtre, même dans l’exercice de la guerre. Je suis rigoureusement certain de n’avoir tué, ni blessé personne, même par imprudence, mais sans le savoir par une balle perdue car je n’y ai jamais tiré un coup de fusil ». Militaire pacifique, il abhorre les bellicistes tout en restant lucide : la force et la résolution sont les garantes de la tranquillité des peuples. Son ouvrage, autoédité, paraîtra d’ailleurs avec un bandeau intitulé « Le droit chemin du pacifisme ».
L’ouvrage est également un bon témoignage sur les réservistes du train, arme méconnue du conflit où l’absence de gloire apparente de la fonction a peu fait écrire les protagonistes. Dans l’ensemble, Vaubourg décrit bien, par épisodes, ce qu’il a vu de sa guerre. Il se rappelle les lieux et les hommes et pointe de nombreuses anecdotes vues ou rapportées sans détail et avec un certain regard philosophique. Toutefois, comme souvent, ces témoignages ne sont pas vérifiés et la part de légende ou de fausseté est parfois importante. Qu’en est-il quand, au cimetière du Faubourg Pavé de Verdun, il dit être témoin de ses fossoyeurs jouant aux boules avec une tête de mort (page 57). Il en est ainsi aussi de quatre historiettes sensées se dérouler à Senones (Vosges) pendant la guerre, narré par procuration, et vantant la bonté des Allemands occupants la ville-front. L’histoire de cette localité sous le feu de la guerre pendant quatre ans ne fut en fait que souffrances et privations croissantes et aucune autre source ne vient corroborer ces histoires extraordinaires.
Singulier est aussi son rapport avec les femmes qu’il parvient à côtoyer sur les arrières de la guerre. Il en parle d’un ton badin mais avec finesse.
Globalement d’un grand intérêt, l’ouvrage pêche principalement par 41 pages d’allégorie religieuse, grand délire comateux amenant l’auteur au Paradis pour discuter avec la Sainte Trinité. Les lignes sont belles mais l’historien y perd en témoignage sur la matière.
L’ouvrage est finalement un mélange de témoignage, de roman et d’inutile. La partie témoignage est intéressante du fait de la position de réserviste de Vaubourg qui nous dépeint, certes superficiellement, mais correctement des aspects méconnus de la guerre (réserve du train ou sections de discipline). Sa vision des choses et des hommes qui l’entourent est réfléchie, teintée d’un humour fin et agréable. L’homme ne fait aucune esbroufe et ne ment pas sur sa qualité de guerrier non-combattant. Il ne raconte que peu de combats auxquels il n’a pas pris part. Quelques renseignements sont donc à tirer de l’ouvrage dans lequel l’attrait principal peut être trouvé dans les portraits des unités spécifiques qu’il intègre et les réflexions de guerre exprimées par l’auteur. Il convient donc de se reporter au texte pour retrouver les passages intéressants et pour suivre le déplacement de l’auteur au sein des arrières des 152e et 233e RI.
On peut suivre l’itinéraire géographique de Vaubourg tout au long de son périple et quelques dates éparses permettent une chronologie utile. En frontispice, un portrait de l’auteur.
Yann Prouillet, CRID14-18, décembre 2011
Tisserand, François (1897-1979)
1. Le témoin
François Tisserand est étudiant clerc de notaire à l’étude Benoist de Bourg-en-Bresse (Ain), ville où son père est cordonnier et sa mère couturière en chaussures. Il évoque un frère plus âgé mais lui a 17 ans quand il s’engage dans les chasseurs alpins le 22 août 1914 « pour la durée de la guerre », avec insouciance mais également un peu aussi à cause de l’ennui de son métier et d’une émulation de jeunesse. Sur la fin de sa vie, il sera président d’Honneur de l’association « Le Mémorial du Linge » et sera nommé chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur le 24 novembre 1977. Il décède deux ans plus tard, le 13 septembre 1979 et est inhumé à Bourg-en-Bresse.
2. Le témoignage
Tisserand, François, Le Linge, tombeau des chasseurs. Un sanglant épisode de la tourmente 1914-1918, Bourg-en-Bresse, Poncet, 1969, 278 pages.
Le chasseur François Tisserand, dit Tyrand, a 17 ans quand, reconnu bon pour le service malgré un âge un peu bas et une constitution physique un peu faible, il est affecté au 70e bataillon de chasseurs alpins, réserve du 30e BCA. Il rejoint Grenoble pour sa formation qui durera un mois et demi et prend le chemin du front. Il débarque au début d’octobre 1914 à Rambervillers et prend corps avec la guerre en passant, en direction des premières lignes, au col de la Chipotte. Affecté à la 5e escouade de la 10e compagnie, il arrive à Celles-sur-Plaine, secteur calme, où il prend rapidement les tranchées. Dès lors, la guerre pour lui est placide, entre les patrouilles et l’organisation du front dans un casernement bien peu militaire. Son baptême du feu est cocasse et imprudent, à l’image de la bleusaille qu’il représente au milieu de soldats déjà aguerris. La guerre se passe ainsi, attentiste et erratique jusqu’aux premières semaines de février 1915.
Après une montée des périls et une intensification parallèle de l’organisation des sommets, les Allemands attaquent la Chapelotte, point de contact de la rive droite de la vallée de la Plaine, en Meurthe-et-Moselle, le 27 février 1915. François Tisserand y est en première ligne et subit de plein fouet l’impressionnante attaque « à la baïonnette ». Après une défense acharnée, il retraite ; la Chapelotte est perdue.
Après un repos mérité et la reprise d’une relative tranquillité, le 70e BCA est muté dans les Hautes-Vosges, secteur du Lac-Noir, à la veille de l’été 1915. Il y est rapidement, et à sa grande surprise, affecté au poste d’agent de liaison, « coureur de Brigade ». Là, fasciné, il assiste au bombardement préliminaire à l’attaque française du piton du Linge, le 20 juillet. Il est au bord du cratère, « sommet tragique où les chasseurs n’en finissent pas de se faire massacrer » (page 187), et décrit les héroïsmes des hommes comme des chefs. Mi-août, le 70e descend au repos à Plainfaing, qu’il quitte aux premiers jours de septembre pour revenir au « Tombeau des Chasseurs ».
Le 12 octobre, une escarmouche sur le « Schratz » impose du renfort. Tisserand part dans la nuit, baïonnette au canon et marche vers le sommet quand il est couché à terre par une attaque à la grenade. Touché à la jambe d’une « fine blessure », il est transféré, le 14, dans un hôpital de Gérardmer ; Tisserand a fini sa guerre.
3. Résumé et analyse
Les souvenirs de guerre du chasseur François Tisserand trouvent leur intérêt dans la zone de front occupée, relativement méconnue de la littérature de guerre. Intégrant le secteur de la vallée de Celles-sur-Plaine et le front de La Chapelotte d’octobre 1914 à la fin de juin 1915. Ce témoignage, relativement superficiel car composé de tableaux successifs peu chronologiés, nous permet d’appréhender la genèse et l’organisation de cette partie du front des Vosges ainsi que l’attaque allemande du 27 février. Si l’ouvrage pêche ainsi par une datation chronologique peu détaillée, il est précis sur les lieux occupés et les noms des hommes que le chasseur côtoie. Il fournit également de précieux renseignements sur son environnement et le déroulement des combats. Les combats du Linge sont également décrits, bien que vus en spectateur.
Le tout, bien que semble-t-il rédigé ou remis au clair avant février 1968, est écrit avec naturel et talent et son auteur s’adresse parfois au lecteur. Le récit est vivant, agréable, imagé, largement anecdotique voire humoristique et d’une grande valeur testimoniale et ethnographique, notamment sur l’argot et le parler poilus. François Tisserand est un soldat jeune qui se place le plus souvent en exergue de sa propre histoire. Engagé volontaire, il en donne d’ailleurs quelques raisons de l’être (page 43). Ainsi, il raconte sobrement son baptême du feu, le ponctuant d’humbles « j’ai peur ». De même, le chapitre relatant de sa blessure, l’éloignant semble-t-il, définitivement du front n’est pas axé sur sa propre blessure mais sur la disparition du commandant Julliard. Sa blessure répond en tous cas au destin des chasseurs pour lesquels, selon Tisserand, la seule alternative est d’ « être tué ou blessé » (page 255). Il avoue souvent sa peur et sa tristesse. Il parle également de choses plus intimes, révélant des pans psychologiques peu étudiés par la littérature testimoniale des soldats de la Grande Guerre. Il en est ainsi de l’évocation peu commune de sa permission ou de relations sexuelles, parfois fortuites (page 133), contées avec candeur, humour (notamment sa description très imagée d’une relation pages 222 à 224) et détachement. Il tendrait d’ailleurs à démontrer que les femmes de l’arrière ne sont pas les mêmes que celles de l’avant (page 221). Les tableaux montrant les jours précédant et suivant la déclaration de guerre à Bourg-en-Bresse et son engagement à l’armée méritent également l’intérêt. Plusieurs autres sont également à conserver : l’image d’une montée en ligne de nuit dans les ténèbres des bois en utilisant le fourreau de la baïonnette (page 67). En guerre, le premier Noël l’a marqué au créneau (page 100) et du fait des cadeaux reçus (page 102). Son parler imagé permet quelques définitions illustrées : la mitrailleuse est la « machine à secouer le paletot » (page 119), le bombardement est une « foire à la ferraille » (page 200). Il décrit le poilu ; de quoi il parle, du pays et pas de politique ou de guerre (page 92), expose le stratagème de ravitailleurs pour garder la soupe chaude, à l’aide de tonnelets à poissons protégés avec des sacs en toile de jute (page 124) et rend hommage aux territoriaux (page 177). Il rapporte que les Allemands surnomment les soldats en pantalons rouges les « carottes » (page 175). Il rapporte ce que pense le civil (page 220) et ce qu’il en pense lui-même au retour d’une permission : « et je m’embarquais, ma musette pleine de bonnes choses que l’avaient préparées ma mère, et ma tête bourrée de méchants échos et des relents du bourbier de l’arrière » (page 226).
Cet ouvrage apparaît donc comme un élément essentiel du témoignage sur la guerre dans les Vosges moyennes, peu évoquées par la littérature de guerre, et dans les Hautes-Vosges.
Si la qualité exceptionnelle des souvenirs du chasseur Tisserand est évidente, la présentation et l’absence d’enrichissement d’une édition minimaliste minorent l’intérêt de l’ouvrage. La datation chronologique est à reconstituer sans garantir la précision d’une continuité, surtout sur la période nord-vosgienne, l’occupation du Linge étant un peu plus datée. Il manque au lecteur une notice biographique destinée à encadrer le récit et à le renseigner sur son auteur, personnage manifestement attachant. Celle-ci eut pu être l’objet des attentions d’A. Raffner, préfacier. Que devient le soldat « Tyrand » après la guerre ? La fin de son récit est brusque, comme la blessure, fatalité qu’il ne pensait peut-être pas atteindre. Aussi, le dernier chapitre, en forme de conclusion pseudo-philosophique, apparaît comme un bien futile ultima verba. Toutefois, l’on regrette que toute la guerre du soldat Tisserand, s’il revint jamais au feu, et même son parcours après sa blessure ne fut pas décrits aussi.
L’ouvrage est préfacé par A. Raffner, « chroniqueur de la tourmente de 1914-18 dans les Vosges » qui rappelle la place du Linge « montagne tragique » et confirme l’intérêt anecdotique du récit. L’ouvrage est illustré d’iconographies intéressantes malgré une qualité médiocre, autre carence dans cette édition minimaliste.
Index des localités et datation du parcours suivi par l’auteur (page) :
1914 : Bourg-en-Bresse, 13 juillet-22 août (23-46), Quartier Bayard de Grenoble, 23 août (47), vers le 10 octobre, la Chipotte (53), 11 octobre-24 décembre, Celles-sur-Plaine (58-100), la Halte, 24 décembre (100)
1915 : La Chapelotte, janvier – février (109) – Le Linge, 20 juillet-13 octobre 1915 (164).
Yann Prouillet, CRID 14-18, décembre 2011
Loti, Pierre (Viaud, Louis-Marie-Julien) (1850–1923)
1. Le témoin
Louis Marie Julien Viaud, dit Pierre Loti, est né le 14 janvier 1850 à Rochefort (Charente-Maritime, alors Charente Inférieure). Il est le 3e enfant de Théodore Viaud et de Nadine Texier, famille de la petite bourgeoisie protestante de la cité rochefortaise. Il suit des cours particuliers à Rochefort, entre au collège à 12 ans et suit des cours de marine mais échoue d’abord au concours d’entrée à l’école navale en 1866 puis réussit l’année suivante après avoir préparé le concours à Paris. Il fait ses classes sur le navire école Borda à Brest puis débute sa carrière navale. La mort de son père l’oriente vers une carrière de journaliste sans quitter la carrière navale. Son premier article est publié en 1880 et publie sous son pseudonyme complet l’année suivante, pseudonyme venant d’un séjour à Tahiti entre janvier et mars 1872. Il continue de parcourir le monde, est fait commandeur de la Légion d’Honneur en 1910 et est admis à la retraite le 14 janvier de la même année, ayant accompli 42 ans, 3 mois et 13 jours de service dont 19 ans, 11 mois et 8 jours en mer. Au mois d’août 1914, il est mobilisé à l’arsenal de Rochefort et parvient à être mandaté comme officier de liaison sans solde auprès au général Gallieni le 25 septembre suivant. Rappelé officiellement à l’activité le 1er février 1915, il occupe plusieurs fonctions d’état-major, notamment celui du Groupe d’Armées du Centre (GAC) et effectue des missions d’observation et de médiation avec les alliés de la France sur les arrières fronts. En mai, par sa position d’écrivain et de journaliste international, il entreprend des négociations secrètes entre la France et la Turquie. En 1916, il est affecté au Groupe d’Armées du Centre (GAE), à Mirecourt dans les Vosges, puis en mai 1917 au Groupe d’Armées du Nord (GAN). Remis à la disposition de la Marine le 9 mars 1918, il est démobilisé le 15 mais reste autorisé à être présent au G.A.N. Epuisé et malade, il est évacué le 31 mai 1918 pour raison de santé. Atteint par la limite d’âge, il est rayé des cadres de l’Armée le 11 novembre 1919. L’année suivante, il reste paralysé par une attaque cérébrale et il meurt à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques) le 10 juin 1923. Il est inhumé dans sa maison de Saint-Pierre-d’Oléron. Sa carrière littéraire entre livres, articles et contributions littéraires, est pléthorique. Il tient également un « journal intime » de guerre que les éditions de La Table Ronde reproduisent entre le 1er janvier 1914 et le 11 novembre 1918.
2. Le témoignage
Loti, Pierre, Soldats bleus. Journal intime, 1914-1918, Paris, La Table Ronde, 1998, 312 pages.
Pierre Loti, romancier, voyageur et marin mondialement connu, a débuté dès son adolescence un journal que sa vie finissante avait fait délaisser. Quand éclate une guerre européenne qui va rapidement toucher les pays qu’il aime, telle la Turquie, il ne tient pas à rester à l’écart de la vie publique. Avec une étonnante lucidité, il révèle sa conscience de l’imminence d’une guerre d’extermination, d’un cataclysme mondial, bien qu’il la considère peu maritime et de quelques mois. Dès lors, Julien Viaud veut servir la France à sa manière et demander à immédiatement reprendre le service armé. Capitaine de Vaisseau en retraite, il va solliciter l’autorité militaire et faire jouer toutes ses relations afin de trouver une place au front, quel que soit son emploi ; il « décide de vieillir en guerre » (page 8). D’abord rejeté, il obtient finalement un poste d’officier de liaison auprès du général Gallieni qu’il rejoint à la fin du mois de septembre 1914. Il parcourt alors le front nord et décrit par sa plume habituée les tableaux qu’il rencontre. Ceux-ci alimentent le journal intime de Pierre Loti mais servent surtout de base aux proses de la propagande anti-allemande pour devenir un homme public farouchement germanophobe, chantre du « bourrage de crâne » (page 9), l’un des « Rossignols du carnage » (page 11).
Rappelé officiellement à l’activité militaire, il est rattaché au ministère de la Guerre et reçoit différentes affectations. Il est ainsi nommé au Groupe des Armées du Centre, faisant fonction d’inspecteur de DCA puis aux armées de l’Est, à Mirecourt, (en 1915 à l’Etat-Major de Castelnau), avant d’être affecté dans la Somme. Outre une activité plus journalistique que militaire, il contribuera toutefois à la tenue de négociations secrètes entre la France et la Turquie dont il fut un des plus acharnés ambassadeurs. Il effectuera également des voyages de propagande en Italie avant d’être démobilisé en mars 1918. Maintenu de manière honorifique dans la zone des armées, il reste, en mai inspecteur des troupes noires.
Mais la guerre est longue et la vieillesse de l’écrivain l’oblige à des périodes de repos dans sa maison basque d’Hendaye. La lassitude et la maladie l’assaillent ; il est perclus d’angoisses, de désespoir, de solitude et est hanté par l’idée de la mort. Il est évacué le 31 mai 1918 pour raisons de santé et ne côtoie plus guère que de loin. Le 20 août 1918 et en prévision de sa mort, il cesse définitivement le journal de sa vie.
3. Résumé et analyse
Les présentateurs de cet ouvrage ont réalisé un impressionnant travail documentaire et explicatif sur Pierre Loti, son environnement et sa place dans l’actualité contemporaine de la guerre. Une longue note technique sur la méthode de transcription des notes de Loti nous renseigne sur sa pratique d’écriture (page 16). Ainsi, l’ouvrage présente, outre un rappel chronologique des grandes étapes de la vie d’une des plus grandes signatures de la fin du siècle dernier, des insérés également chronologiques de textes écrits pendant la guerre lors des visites au front et des voyages de leur auteur, qui s’érige aussi en témoin. C’est donc pour l’amateur de littérature et le passionné de Loti un ouvrage fondamental à la connaissance profonde de l’écrivain dans son intimité et sa psychologie.
Toutefois, cette présentation originale permettant un cadrage complet de la période présente l’inconvénient de redites fréquentes (voir le texte sur Venise) car Loti utilisait son journal comme base aux productions journalistiques. Mais le lecteur de penser aussi que ces textes sont également présentés dans une certaine exhaustivité pour rehausser l’intérêt du journal, bien pauvre sur le plan documentaire extra-biographique. Cet intérêt décroît encore au fur et à mesure de l’avancée de la guerre, où Loti ne voit plus que ses douleurs intérieures.
Ce journal de guerre n’offre donc qu’un intérêt très limité. En effet, Pierre Loti se révèle finalement un témoin étique car éloigné du grand cataclysme dont il ne veut pourtant pas être écarté. Ceci même si, le 23 décembre 1914, Loti achète un uniforme gris bleu qui se voit moins dans les jumelles allemandes ! (page 53). Pourtant, son journal ne reflète pas les expériences quotidiennes qu’il aurait pu décrire avec le même talent que celui qu’il employait à magnifier la France et ses alliés dans des textes d’un patriotisme enflammé et une germanophobie dure et durable (page 82) inversement proportionnelle à sa proximité de l’ennemi, qu’il appelle les « poux gris » en octobre 1917 (page 218). Il décrit les techniques allemandes pour empoisonner les puits avec de la créosote ou de la pourriture (page 153). Il analyse pourtant ces sentiments germanophiles ou germanophobes en Espagne (pages 123, note 103, page 162). Le 1er août 1914, il décrit l’ambiance à Rochefort et prophétise une guerre d’extermination, la plus atroce (page 39), faisant preuve de lucidité devant l’ampleur du cataclysme mondial à venir (page 40), même s’il pense à une guerre peu maritime et de quelques mois seulement (page 41). Il a quelques phrases originales sur le cheminement dans les boyaux (page 80) et des visions et impressions à conserver dans une ambulance de gazés (page 88), évoquant de grands feux pour neutraliser les gaz (page 90). De même sa vue d’un cimetière à Ville-sur-Tourbe et l’identification des tombes (pages 93 et 97). Quelques tableaux d’intérêt dans ses visites de Lorraine (Gerbéviller, Parroy, Lunéville, page 119), dans les Vosges (Saint-Dié le 25 juin 1916, la Fave, le 5 juillet 1916, l’Alsace et Gérardmer, pages 120 et 127 ou la Tête de la Behouille, page 270). Sa plume décrit une vision parabolique de canons, « bêtes apprivoisées » (page 132). On peut aussi garder l’intérêt de sa description de la guerre de montagne, dans les Alpes dolomitiques, et de ses spécificités (pages 124 à 127) ou d’un camp de Sénégalais (page 241).
Malgré cela, la guerre passe très largement au second plan par rapport à la psychologie et la succession de petits instants personnels formant le banal (et l’ennuyeux) quotidien de Julien Viaud-Loti. Au fil des pages, la noirceur de l’âme morbide et tourmentée du diariste prend le pas sur le témoignage de son temps et des événements exceptionnels dont il aurait pu être le témoin privilégié. Dès lors, peu de renseignements sont à tirer du journal d’un homme de lettre dont la plume descriptive s’embellissait d’une telle poésie, inemployée à décrire le quotidien d’un homme las pour lequel la guerre n’a pu réinsufler l’intérêt de la vie.
Quelques tableaux, notes et éclairages sont à extraire toutefois de cet ouvrage non iconographié qui laisse quelques zones d’ombre sur le personnage fort complexe à la vie et à la personnalité singulières (où la femme légitime de l’auteur est totalement éludée, par exemple). L’ouvrage comporte ainsi quelques pages utiles pour des tableaux d’ambiance, des paraboles littéraires, des reflets mondains ou le côtoiement de personnages contemporains.
A noter une excellente préface résumant l’ouvrage, une abondante partie « notes » et des références bibliographiques.
Yann Prouillet, CRID 14-18, décembre 2011
Laval Edouard (1871-1965)
1. Le témoin
Né en 1871, Edouard Laval est à la déclaration de guerre un médecin connu, auteur de plusieurs livres sur des sujets aussi divers que l’étude des projectiles (1899), le traitement des blessures de guerre (1901), le diabète (1903), un guide du médecin de réserve (1906) ou les champignons (1912). Son préfacier, le médecin-général inspecteur Toubert dit de lui qu’il « fut un brillant médecin de l’armée d’active, avant de devenir un distingué praticien civil » (page 10).
2. Le témoignage
Laval, Edouard, Souvenirs d’un médecin-major. 1914-1917, Paris, Payot, Collection de mémoires, études et documents pour servir à l’histoire de la guerre mondiale, 1932, 238 pages.
Médecin parisien, il reçoit aux Invalides, le 5 août 1914, son Journal de mobilisation qui l’affecte à la tête de l’ambulance n°6 du 21e corps d’armée à Epinal dans les Vosges. « C’est la première fois que je vois une ambulance autrement que sur le papier » constate-t-il le 6 août quand il découvre toute une organisation de 66 personnels, 8 voitures et 22 chevaux auxquels il ne connaît rien. Il arrive à Darnieulles, dans les Vosges, le 10 août et, après avoir avoué n’avoir aucune idée de la façon dont on se bat, se met en quête d’ordres précis et de travail. Il rencontre l’effervescence des troupes qui avancent en territoire ennemi, dans la vallée de la Bruche puis celle de la Sarre Blanche où il prend enfin en compte quelques blessés. Mais bientôt sonne la retraite jusqu’aux portes de Bruyères. Là, en pleine bataille des frontières et à l’amorce du grand affrontement sur la Marne, l’ambulance n°6 se distingue, le 31 août 1914, par sa « totale inaction » (page 26).
Le 6 septembre, elle est enlevée du front des Vosges pour se rendre derrière le front de Champagne. Là, même absence d’ordres et d’activité et le médecin de se contenter de suivre la guerre par ses traces, ses bruits et ses impressions lointaines, trop loin du front combattant, en réserve. Le 15, elle entre en action avec le traitement de 300 blessés. Début octobre, l’ambulance monte dans le Nord et s’installe à Aubigny où l’activité s’exacerbe. Elle gère les évacuations de milliers de blessés tout en déplorant encore le manque d’organisation et de moyens dans un afflux de circulaires surréalistes au pays du dénuement. 1914 s’achève sur une nouvelle affectation, au 33e corps.
Le 25 janvier 1915, Laval en a « assez de cette vie de « farniente » (page 129) car il est toujours en réserve. Cette vie va le pousser à chercher une affectation plus active qu’il parvient à obtenir en étant, le 11 mars, détaché à la 1re armée. Il est intégré comme chef de service à l’hospice mixte de Neufchâteau, à nouveau dans les Vosges, et en septembre à une commission de réforme, corollaire de la loi Dalbiez, qui va débusquer les « planqués ». En décembre 1915, nouveau tournant dans ses états de services car le docteur rencontre son patient d’avant-guerre, le général Gallieni, qui souhaite le reprendre à son service. Il entre donc au cabinet du ministre de la Guerre et partage dès lors l’intimité et la vie du général, d’esprit vif mais de santé très chancelante. Il mourra d’un cancer de la prostate le 26 mai 1916 à minuit.
Le docteur Laval retourne alors au front et débarque à Amiens le 17 juin pour prendre la direction d’un hôpital que l’on monte de toute pièce. Il multiplie les visites commentées aux formations médicales dont il dépeint les aspects, les techniques et les matériels avant l’ouverture de sa propre formation, le 21 août, pouvant recevoir 1 000 hommes. Dès lors, il n’a plus le temps de prendre des notes, opérant et soignant les blessés du front avec un personnel restreint.
Fin novembre, le poste de médecin-chef du Commandement d’Etapes de la gare régulatrice de Creil s’offre à lui. Là encore, son esprit d’observation nous dépeint son entourage et ses fonctions ainsi que les personnages qu’il côtoie. Mais c’est une situation passagère ; il quitte rapidement ce nouvel emploi et intègre, le 4 mars 1917, le poste d’adjoint au chef supérieur du Service de Santé de la 6e armée à Fismes et surveille à la création de trois hôpitaux d’évacuation (HOE), préalables à la grande offensive d’avril.
Le 31 mai 1917, Edouard Laval apprend sa nomination au Bureau technique du Service de Santé du GQG, poste qui va lui faire quitter le front et donc l’intérêt qu’il a d’apporter son témoignage. Ces récits s’arrêtent à cette date.
3. Résumé et analyse
Edouard Laval nous livre un témoignage opportun dont le contenu dispute le varié à l’intérêt. Vivant et presque naïf, l’ouvrage, sans s’ériger en pamphlet polémiste, démontre par un lancinant ressassement critique, l’inorganisation criante et répétée des services de santé français pendant la quasi-totalité de la durée de la guerre. En août 1914, alors que la bataille des frontières va coûter la vie à des centaines de milliers de combattants sur le front occidental, l’ambulance numéro 6 s’illustre, aidée par une organisation rapidement obsolète, par une inaction inexcusable à l’immédiat arrière front. Le 3 septembre, il rapporte : « Un des médecins de l’Ambulance m’a confessé que la veille, le médecin-chef avait exprimé au Directeur du Service de Santé son ennui de ne pas avoir de travail. La réponse n’a pas tardé » (page 28). Il lutte toutefois contre les ragots, notamment quand on constate, le 10 septembre 1914 dans les Vosges, que « bien des régiments on subi des [troubles digestifs]. C’est au point que l’on a accusé les Allemands d’avoir, pendant leur passage, empoisonné les sources. Rien, de leur part, ne paraît impossible a priori. Néanmoins nous savons qu’il n’est pas besoin d’invoquer ce geste criminel pour expliquer les embarras gastriques qui se produisent dans une armée en campagne. Hier, par exemple, n’avons-nous pas été obligés d’enfouir tout notre lot de viande fraîche et de recourir aux boîtes de « singe » ? » (page 32). Il constate et s’interroge aussi : « Parmi les blessés, relevé une vingtaine de plaies de l’index ou du creux de la main gauche (mutilation volontaire ?) pour lesquelles une enquête est ouverte » (page 38). Il revient sur ces cas d’auto-mutilés « excessivement rares » (page 62).
La situation est identique sur les arrières de la Marne et la cristallisation du front n’apportera pas le changement radical d’une impéritie coupable du GQG qui semble ignorer que la guerre occasionne autre chose que des morts. Le 1er décembre 1914, il déclare déjà : « En face de la réalité, les meilleures instructions ne valent même pas le papier qui les porte » (page 107). Il les critique mais propose aussi des solutions pour que s’améliorent les évacuations (page 126).
La zone des armées va certes s’enrichir petit à petit de formations sanitaires diverses (ambulances de front, HOE et hôpitaux), mais ce sont alors les moyens médicaux qui font défaut de manière inversement proportionnelle aux circulaires qui affluent sur la méthode de traitement des blessés. Il relève ces dysfonctionnements, notamment à Suippes dans la Marne (page 40).
Il éclaire sa pratique d’écriture en décembre 1914 : « Tout en écrivain, j’analyse mon geste. Curieuse, cette manie à peu près générale de recueillir ses impressions. A l’ambulance officiers et infirmiers ont presque tous un carnet qu’ils couvrent d’inscriptions chaque jour. L’observation ou le récit d’un fait nouveau sortant de la banalité provoque aux mêmes moments – moment de trêve – une levée de stylos » (pages 110-111).
Les tableaux dépeints par le médecin forment une succession d’anecdotes, médicales ou non, de rencontres avec le milieu et les gens qu’il côtoie. Il fait parfois œuvre de bons mots en donnant sa définition de la différence entre repli et recul : « Notre formation est en réserve, prête à l’avance aussi bien qu’au repli (ne pas confondre avec le mot « recul« , seul l’adversaire étant capable de reculer) » (page 38). Quelques belles lignes descriptives également du poilu notamment : « Devant la maison défilent hâves, lents et dos ronds, les soldats qui ont occupé les tranchées ces deux derniers jours. Ils reviennent trempés de pluie et épuisé, jettent un regard vague sur notre habitation de tout repos, sur nos infirmiers pour la plupart gras et roses, puis, impassibles, poursuivent leur chemin vers le cantonnement où ils chercheront l’oubli de tout. Je les vois, d’avance, s’écrouler sur la paille, engloutis d’emblée, par un sommeil sans fond, tandis qu’ils mâchonneront la dernière bouchée d’un repas pris machinalement » (page 40). Il survole trois ans de guerre, entre zone des armées et arrière, entre inaction, dont il se plaint à plusieurs reprises (voir pages 127 ou 132) et activité, entre camaraderie du front et sollicitations de cabinets. En effet, son passage au cabinet de Gallieni dépeint les relations ambiguës, mêlées de coterie et d’intégrité qui ont cours à Paris (notamment des pages 150 à 170).
Le tout forme un regard lucide et instructif, un éclairage indispensable sur les formations médicales, leur état d’esprit et leur fonctionnement et un témoignage intéressant sur les opérations de 1914. Même si le témoin est parfois éloigné de ceux qu’il appelle « combattants mes frères« , d’une manière exagérée. Il est d’ailleurs peu à l’aise dans les termes purement guerriers ; n’appelle-t-il pas les balles Bon des « balles Gond » ? (page 43).
Tout l’ouvrage est ponctué de descriptions sommaires, d’anecdotes, d’allégories et de tableaux qui ponctuent d’intérêt l’ensemble de l’ouvrage. Dans cette masse, on peut citer une méthode d’identification des tombes (page 47), une vision des chiens sanitaires (page 49), le prélèvement de souvenirs sur un uhlan blessé (page 53), des infirmières, « Chipies de la Croix-Rouge » sadiques ! (page 56), le cassage du grade d’un officier déserteur (page 58), son allégorie de la fusillade « on pense à une poêle gigantesque remplie d’huile bouillante où tomberait de l’eau » (page 60), le stoïcisme des blessés dans la salle des « graves » (page 64), dont la vision, à plusieurs reprises, rejoint les descriptions faites par Duhamel. Il évoque le tremblement des mains des soldats, du à l’ébranlement nerveux (page 87), la supériorité du matériel anglais « supply-water » (page 94) ou celle de l’organisation de la tranchée allemande (page 229). Il note aussi la réapparition de la religion (page 106). Sur les femmes, il a cette réflexion opportune : « Je suis décidé à fermer les yeux, car du moment qu’on autorise la venue des femmes dites de mœurs légères, je ne vois pas pourquoi on verrouille la porte aux légitimes » (page 133) Sur cette question, il sous-entend (page 210) que l’hôpital est un lieu où des femmes cherchent (et trouvent) un mari et autres choses tues ! Sur les gaz, il donne le coût d’une nappe de chlore de 7 km, soit 1 million de francs (page 182) et les recherches qui sont faites sur les gaz allemands (page 183). Il décrit aussi une gare régulatrice, « sphincter de l’armée » ! (pages 202 à 206). Sur le pinard, on note sa réflexion désabusée : « Ce qui frappe le plus, ce sont les acheteurs de pinard, avec leurs huit, dix bidons autour des reins, comme autant de bouées de sauvetage – comparaison nullement déplacée si l’on songe à ce que le pinard a pu sauver d’existences défaillantes » (page 231). Il évoque l’état des troupes noires dues au froid (page 227). Il a aussi une réflexion sur le parfum : « On ne saurait croire ce qui se dépense d’argent en parfums. Etrange ce besoin de se griser l’odorat » (page 233). Il fustige aussi l’ennui des conversations (page 235). Enfin, il ne donne pas cher de la peau des livres de guerre après-guerre pour les anciens combattants : « Il est une chose que l’on est incapable de faire : lire des livres, comme celui que vient de m’offrir un officier de mes amis, mutilé de guerre, sur la bataille de Morhange. [Certainement, au 19 mai 1917, celui du capitaine René Christian-Frogé, Morhange et les marsouins en Lorraine paru chez Berger-Levrault en 1916, ndr]. J’en parcours quelques lignes, parfois quelques pages et puis j’ai une telle nausée de ces spectacles trop connus – pourtant si bien décrits – que je referme le volume. Ah ! je suis bien certain qu’après la guerre ceux qui l’auront faite ne demanderont qu’à en chasser le souvenir » (page 236). Il fournit aussi quelques visions d’intérêt sur les hôpitaux-baraques (page 174), les baraques Favaron (page 175) ou l’atelier de camouflage avec Guérand de Scevola, Forain et Landowski (pages 175 à 178).
Il évoque à plusieurs reprises l’affaire (pages 21 et 68) de l’ambulance capturée de Lettenbach en août 1914. Cette affaire a été depuis exposée « de l’intérieur » dans le témoignage du docteur François Perrin [in Un toubib sous l’uniforme. 1908-1918 publié aux éditions Anovi, en 2009. Lire également les articles de l’infirmier avocat Leleu sur l’ambulance de Laval parus dans « Lecture pour tous » d’avant mars 1915 que le médecin évoque page 138].
A noter une introduction sur la littérature de guerre (page 7), la place des souvenirs de Laval dans celle-ci et les visions d’arrière front (les Vosges, la Marne, la somme en 1916-1917). Les souvenirs de Laval font incontestablement référence sur le sujet dans un livre bien écrit, qui n’est pas iconographié ni cartographié.
Yann Prouillet, CRID 14-18, décembre 2011
Jury, Jean-Elie (?-?)
1. Le témoin
On sait peu de choses de Jean-Elie Jury qui ne donne que des indications biographiques floues dans ses carnets. Il est peut-être originaire de l’ancienne commune de Saint-Julien-en-Jarez dans la Loire, où son frère, Stéphane-Irénée est né le 3 juin 1877. Il dit d’ailleurs quitter, le 1er août son lieu de résidence pour aller à Saint-Chamond. Sur son parcours militaire, il indique dans sa très courte préface « quand éclata la première guerre mondiale de 1914-1918, j’étais déjà un réserviste chevronné, j’avais exécuté mes périodes de réserve, dont j’étais sorti brigadier à l’une, sous-officier aux autres. Je fus affecté au parc d’artillerie de la 27e division » (page 5). Semble-t-il fonctionnaire du ministère des finances, il est mobilisé à la déclaration de guerre comme maréchal des logis affecté à la conduite et au ravitaillement de l’artillerie régimentaire du 155e RI de la 27e division du 14e corps. Il est promu sous-lieutenant dans une section d’artillerie le 16 mars 1918.
2. Le témoignage
Jury, Jean-Elie, Mes carnets de guerre. 1914-1918, chez l’auteur, 1964, 171 pages.
« Comme toujours, depuis ma plus tendre enfance, j’ai confié à de petits carnets mes intimes pensées de chaque jour ; j’ai continué pendant ces quatre années de 1914-1918 » (page 5). Sa pratique d’écriture est déjà ancienne et son rôle de ravitaillement ne l’expose pas au combat. Ainsi, il parcourt les arrières du front mobile de la bataille des frontières dans les Vosges d’août 1914, témoignant des visions sommaires qui s’offrent à lui. Après une entrée anxieuse et sans débordement de joie en pays reconquis, il recule et retraite par Bruyères avant de quitter les Vosges le 14 septembre pour renforcer l’armée du Nord, dans la Somme. Il reprend ses corvées de cantonnement, ponctuées de ravitaillement, mais sans réelle activité ; les jours passent dans une immobilité commentée.
En août 1915, il est transféré sur la Marne où là aussi, il rapporte peu d’activité sauf un ravitaillement de l’avant qui lui permet de s’approcher de la ligne de feu. La fin de 1915 le ramène dans les Vosges quand en février 1916 les lignes s’allument à Verdun. La division renforce le front menacé de la ville martyre mais Jury égrène les jours dans la même monotonie. Au cours d’un de ces ravitaillements vers l’avant, le sous-officier reçoit une blessure légère à la jambe, qui lui vaudra la croix de guerre. Il ne quitte ce secteur qu’avec la fin de 1916.
De retour dans la Somme en 1917, il ressent superficiellement les mutineries du printemps alors que les jours succèdent aux mois et les changements d’affectation sont rares. La deuxième offensive de la Marne le conduit à colmater les brèches sans toutefois bouleverser la placidité de sa vie d’arrière front.
Août 1918 signe la fin des offensives allemandes et le début de la débâcle, l’auteur délaisse alors son carnet et apprend l’Armistice alors qu’il est en congé. Lassé de la guerre et de la licence qu’elle occasionne, il pense sans joie, ce 11 novembre 1918, à ceux que l’on semble déjà oublier.
3. Résumé et analyse
Le journal de guerre de Jean-Elie Jury est original sous deux aspects : le premier est la vision d’un non-combattant, chargé du ravitaillement d’artillerie régimentaire stationné à l’immédiat arrière front et y faisant des incursions aussi épisodiques que brèves. Cette vision offre un regard particulier mais superficiel car n’apportant pas le témoignage vécu de la guerre. L’auteur suit les événements militaires par procuration, selon les ragots de cuisine et son récit se réduit en proportions égales à des prospectives et des banalités. Il se qualifie d’ailleurs lui-même de « demi-guerrier » (page 37). Le 3 août 1914, il constate en gare de Saint-Chamond « les trains pris d’assaut. Enthousiasme. Des cris, des hurlements, quelques ivrognes malheureusement » (page 7) mais en guerre, il rapporte les ragots : « Il paraît qu’à Saint-Dié les ennemis n’ont pas enterré leurs cadavres et que la région empuantie est inabordable » (page 18) ou cette odyssée du capitaine Boust et de 22 soldats du 140e RI parvenus à regagner les lignes françaises déguisées en paysans ! (page 19), rapporte le 14 septembre que « les soldats allemands commencent à se mutiler » (page 23). Si un de ses chefs lui donne une définition cocasse du drapeau : « Ça qu’il faut se faire casser la gueule pour », il n’est pas concerné par son emploi militaire. Plus loin il analyse deux sortes de courages : « Celui que nous avons quand nous traversons des populations qui nous acclament (…) et « l’autre qui consiste à faire simplement chaque jour, à toute heure, son métier, son devoir, de se mesurer quotidiennement avec la camarde. Celui-ci est le plus admirable » (page 27). Plus tard, il continue de rapporter une guerre dont il ne perçoit que les bruits : « D’aucuns prétendent que d’une tranchée à l’autre on fait des échanges de cigarettes » (page 43). Parfois, son analyse est plus personnelle et opportune : le 23 novembre 1914, « nous voyons défiler deux régiments, le 115ème et le 117ème qui traversent Harbonnières pour aller à Hangest. Quelle tristesse de voit tant d’hommes âgés parmi eux ! Quelques-uns, fatigués, mal rasés, paraissent des vieillards. Ils défilent bien ; on surprend dans leurs yeux des rêves qui ne sont pas très belliqueux, mais ils sont résolus. Ils n’ont plus le patriotisme paonnesque des débuts devant les femmes ; ils ont souffert ; ils ont senti le souffle de la camarde, maintenant, ils marchent froidement, résolument parce qu’il le faut et parce que beaucoup d’entre eux, qui ont vu tomber à côté d’eux d’excellents camarades ont des comptes à régler avec les Boches » (page 49). Parfois, il s’emporte contre ses supérieurs, quand, le 4 avril 1916, il « trouve à [s]on retour nos deux officiers occupés à faire un petit jardin autour de leur cagna. Jamais, jamais, je ne les ai vus s’occuper du bien-être des hommes. C’est un peu écœurant » (page 95) et y revient en mai 1916 : « Il faut que je confie à mon petit carnet tout l’écœurement que me donne nos officiers. Je ne parle pas de tous les officiers naturellement, mais des nôtres, de ceux de la 1ère S.M.I. Ils ne font rien, rien » (page 104). Il étend cette acrimonie aux généraux : « Qu’on foute donc nos généraux en 1ère ligne pour observer les mouvements de leurs troupes ! ils feraient peut-être moins de gaffes. (…) Maintenant ces messieurs après avoir fait massacrer des milliers d’hommes vont tranquillement jouer au bridge à Limoges et jouir des douceurs d’une grosse retraite. Quand je vois les souffrances et la mort autour de moi, je ne peux m’empêcher de dire comme les poilus : « Tas de crapules ! » (page 138). Cela participe du sentiment rencontré le 15 juin 1917, à l’esprit gâté de la troupe proche de la rébellion (page 139). Il participe également à l’ostracisme constaté contre les « gens du midi » : « Oh ! ces corps du midi toujours à la blague et à l’honneur, jamais à la peine » (page 102) et plus loin, le 4 juin 1916, « on murmure que tous les corps méridionaux ont flanché (une fois de plus) » (page 107).
La seconde originalité présente une attirance marquée du soldat pour un élément de sa vie dont le manque est cruellement ressenti : les femmes. Ce sentiment n’est toutefois pas développé, le récit n’étant émaillé que de quelques annotations ponctuelles sur le sujet. Cette thématique est finalement assez peu évoquée dans les témoignages de soldats, s’accordant tous à la pudeur ; le texte de Jury éclaire un peu l’historien sur ces sentiments éludés. Il indique en effet, dans la Somme en octobre 1914 : « Il y a de jolies ouvrières qui nous sourient. On ajuste son uniforme, on frise sa moustache, on se drape dans sa dignité de guerrier. Des regards s’échangent qui ne sont point chastes… Beaucoup d’entre nous, hommes et femmes, souffrent du besoin d’aimer » (page 40). Il connaîtra d’ailleurs un amour furtif en septembre 1915 (page 76). Cette préoccupation des femmes reste une préoccupation récurrente dans son parcours, favorisé par sa position de front-arrière.
Ces deux points sont malheureusement les seuls qui offrent un attrait à cet ouvrage superficiel et répétitif très fortement entaché d’une imprécision toponymique et patronymique qui confine à une systématique perturbatrice car faisant perdre ses repaires au lecteur. L’ouvrage perd de sa substance au fur et à mesure de l’avancée du conflit, se traduisant par un ressassement des jours et des expériences, à peine rehaussé par quelques missions « dangereuses » dont l’auteur sent de lui-même la pauvreté de l’intérêt. Certes, l’on sent que les souvenirs sont livrés bruts, sans retouches apparentes mais surtout sans vérification. Dès lors, cette qualité apparaît comme un défaut très largement souligné par le peu d’intérêt que revêtent la plupart des dates reportées. L’auteur dévoile des sentiments selon ce qu’il vit et une certaine incurie qui l’irrite mais c’est surtout l’ennui, le répétitif qui prévaut au fil des pages où les mois sont représentés par quelques dates éparses et quelques paragraphes délayés. Beaucoup d’erreurs toponymiques augmentent encore ce sentiment.
Au final, les carnets de guerre de Jean-Elie Jury n’offrent que peu d’intérêt à l’historien du fait de la pauvreté documentaire et descriptive du témoignage qu’il semblait vouloir apporter. L’ouvrage, semblant d’un tirage limité à compte d’auteur, est correctement rédigé, dans un style diariste simple et n’est pas iconographié. Cette présentation très austère peut rappeler les carnets dont le texte est issu.
Yann Prouillet, CRID14-18, décembre 2011
Guichard, Henri (1897-1982)
1. Le témoin
Né le 14 décembre 1897 dans la Drôme, Henri Guichard est issu d’un milieu paysan, domicilié à Combovin. En janvier 1916, à 19 ans, il intègre le 111e RI d’Antibes et ne retourne à son foyer que le 2 septembre 1919. En février 1921, il épouse Alice Combe et le couple s’installe à Châteaudouble puis à Montmeyran comme agriculteurs. Trois fils naîtront de leur union. Sa petite-fille, présentatrice des carnets, indique qu’il devint après-guerre un « pacifiste acharné, un écologiste actif et un citoyen du monde convaincu » et que, en 1972, il se rend à Gross Bieberau en Allemagne, ville jumelée à Montmeyran, où il « serre fraternellement, non sans émotion, la main de quelques poilus d’en face ! ». Il meurt le 1er mai 1982.
2. Le témoignage
Henri Guichard, Guichard-Dahl Eliette (prés.), La Grande Guerre du soldat Guichard. Itinéraire peu commun d’un poilu. Carnets de route 1916-1919, Charenton-le-Pont, Presses de Valmy, 2000, 243 pages.
Le soldat Henri Guichard est mobilisé le 1er juin 1915 au 111e RI d’Antibes. Malade, il va d’abord connaître les hôpitaux puis les camps d’entraînement avant d’être débarqué comme divisionnaire à Froidos dans la Meuse le 20 avril 1917. Ce n’est qu’un mois plus tard qu’il arrivera en ligne, à la 15e compagnie. Il restera sous Verdun jusqu’au grand repos de fin septembre.
Deux mois s’écoulent quand, alors qu’il se prépare à remonter au front, il apprend que son régiment est de ceux qui vont devoir aider l’Italie bousculée par l’offensive autrichienne. Le 31 octobre, il arrive dans les plaines alliées pour un mois d’arrière front avant l’approche vers la zone de combat dans les montagnes du nord. Mais en fait, cette approche est avortée par une permission qui ne rendra le soldat Guichard à la guerre italienne que mi-janvier 1918, où, sur le Monte Tomba enneigé, il est placé en réserve. Au front pendant un petit mois, il est relevé par les chasseurs. Il redescend dans la vallée jusqu’au 26 mars 1918, date à laquelle « personne n’est content de quitter ce beau pays, nous avons passé de si bons jours et nous savons que si nous allons en France, c’est pour nous battre… » (page 65).
On le retrouve dans la Somme, à 11 km d’Amiens, secteur de Prouzel, le 5 avril, où il connaît l’enfer des tranchées et de la boue. Avril se poursuit en ligne, sous les gaz, le bombardement et les attaques partielles et mai la relève pour un secteur plus calme de Lorraine, devant Pont-à-Mousson.
Le 11 juin, après un retour de permission, il apprend sa nomination pour le « groupe franc » du bataillon. Non volontaire, il attribue cette « guigne » à sa jeunesse et à sa condition physique. Il inaugure quelques patrouilles sur la Seille, dans ce secteur réputé calme où il tente de monter des embuscades, parfois tragiques pour les camarades. Peu de résultats au final pour ce groupe qui sera relevé (et dissous) le 5 août par l’arrivée en secteur des Américains. Août l’envoie donc à l’ouest de Soissons où il participe aux attaques d’août devant Epagny. Frôlant la mort plusieurs fois, il est finalement blessé au pied par un éclat d’obus le 29 et échoue à Paris dans un hôpital.
Là, il renoue quelque peu avec le culte protestant dont il était par force éloigné. Il restera à l’arrière jusqu’à ce que les bruits d’armistice laissent espérer une fin prochaine de la guerre. Son retour au front l’a amené dans l’Oise mais il ne retournera pas de suite en secteur combattant car, grippé, il entre à l’infirmerie en cette fin d’octobre. Le 30, les ultimes attaques alliées le trouvent à l’est de Saint-Quentin. C’est de là qu’il participe à la marche en avant et franchit le canal en avant de Guise, sous les balles et le gaz. Les Allemands, s’ils reculent, ne sont pas encore à genou. Pourtant, il repart vers l’arrière, son bataillon étant relevé et apprend l’Armistice, le 11 novembre 1918 en matinée à la sortie de la ville de Nesle, loin du front. La guerre est terminée et Henri Guichard escompte sa démobilisation. L’heure n’a pourtant pas encore sonné et de nombreuses heures de marches vont se succéder avant l’entrée en terre reconquise qui se fera pour le soldat Guichard le 23 décembre 1918 à Saales, dans le Bas-Rhin, aux opinions très francophiles. Dès lors, il parcourt les villages d’Alsace et s’achemine au nord de Strasbourg où il voit enfin le Rhin. Il poursuit son « itinéraire touristique » quand, le 4 mars 1919, il apprend son changement d’affectation pour intégrer le 10e bataillon indochinois qui part vers l’Orient.
Après une permission, il embarque sur le « Vinh-Long » le 19 avril et accoste le 3 mai dans le port Roumain de Constanza. Il visite Constantinople, la Bulgarie, Bucarest et échoue dans le port de Varna où il devient manutentionnaire. Le 23 août, il apprend la démobilisation de sa classe, la 17. Il va rentrer alors en France, à Combovin où il retrouve son père le 2 septembre 1919.
3. Résumé et analyse
Le soldat Guichard entre en guerre tardivement et par à-coups et il reste le plus souvent le spectateur de sa propre guerre et même l’Armistice n’est pas vécu au front. Pourtant, le soldat Guichard aurait pu fournir un témoignage de premier ordre sur un parcours particulièrement intéressant et singulier. Le début de sa guerre, en 1917 est similaire à la masse mais il participe à la campagne d’Italie où il agit peu. Il rentre en France, retrouve les tranchées et est affecté dans un groupe franc, dont peu de soldats évoqueront le rôle et les caractéristiques exactes. La fin de 1918 l’entraîne à la poursuite d’une Allemagne agonisante et son témoignage se poursuit bien au-delà de l’Armistice. Là encore, cette singularité aurait pu apporter beaucoup ; il parcourt une Alsace libérée et paysanne et surtout intègre la seconde période d’Orient qui lui fait parcourir la Roumanie et la Bulgarie. Malheureusement, son parcours de guerre est trop secondaire ; il témoigne « en touriste » et sans renseigner le lecteur sur sa formation et son rôle exacts en Roumanie. Enfin, de religion protestante, il apporte sur ce point une autre singularité dans les témoignages de guerre dans la masse de témoignages d’autres obédiences.
Comment expliquer la constance d’une telle faiblesse dans le témoignage ? Est-ce dû à l’origine plébéienne du soldat Guichard ? Son évidente découverte du monde en même temps que de la guerre trahit son manque de culture, de vocabulaire et d’à-propos pour décrire les heures extraordinaires et les expériences vécues. Ayant manqué totalement d’un élémentaire sens de la description, son texte manque ainsi globalement d’intérêt. L’auteur écrit avec une simplicité naïve sans s’attacher au véritable intérêt des situations qui l’entourent. Trop peu fouillé, il s’agit souvent d’un étalage de banalités et de menus faits quotidiens. Sa passivité même nous laisse à penser qu’il ne participe jamais aux attaques et certaines de ses expressions sont incompréhensibles (voir page 125 « Je trouve en arrivant un assez bon trou où je couche avec un camarade. Ce trou est recouvert d’un trous d’obus, ce qui fait que s’il pleut, nous ne mouillons pas » !). Même si le personnage est touchant (il ne haï pas l’Allemand sauf quand celui-ci coupe les arbres fruitiers, page 135), il ne capte pas l’intérêt du lecteur. Il donne pourtant une bonne définition d’un secteur tranquille « car l’herbe pousse partout où nous sommes » page 23. Il décrit le 11 novembre à Nesle (Somme) et passe l’ancienne ligne de front dans les Vosges (vallée de la Fave) et l’Alsace recouvrée (vallée de la Bruche dans la Bas-Rhin) en décembre 1918, y notant une zone dévastée de faible largeur, « 5 ou 6 kilomètres au plus » (page 143) et dont la forêt a été par place surexploitée (page 147). Il découvre une Alsace plus moderne et plus jolie que la France (page 149) où il règne toutefois « un peu d’hostilité » à l’égard des Français (page 147), même si, sur le pont de Kehl à Strasbourg, il indique que ce sont les Alsaciens eux-mêmes qui chassent les Boches de la ville.
Ainsi, le texte, naïf, est, par le style et par la présentation, destiné au néophyte. Les annotations complétives du glossaire d’Eliette Guichard-Dahl, présentatrice des carnets, apportent peu et sont superficielles. L’introduction et la postface se veulent un hommage mais se révèlent inutiles et lacunaires pour la véritable appréhension du personnage. On peut toutefois se reporter à ce témoignage pour quelques tableaux de la fin d’année 1918 et quelques lignes sociologiques sur l’Alsace libérée. L’édition présente une erreur de numérotation dans le glossaire et une typographie trop aérée. Il n’est pas illustré ni cartographié.
Parcours géographique de l’auteur (avec datation et pagination entre parenthèses) :
1917 : Froidos (20 avril) (16), Fleury (15 mai) (17), Auzéville, Brabant-en-Argonne, Vraincourt, Boureuilles (15 mai – 16 juin) (17-26), Neuvilly, Clermont-en-Argonne, Auzéville, Granges-le-Comte, Vraincourt, Aubréville, Parois, Avocourt (15 mai – 16 juillet) (26-30), Vauquois (27 juillet – 3 septembre) (30-32), Avocourt, camp Marquet (3-25 septembre) (33-35), camp de Saint-Ouen (27 septembre – 17 octobre) (35-36), Blacy à Sommessous (18-29 octobre) (36-38), Embarquement ferroviaire, Italie, retour dans la Somme) (29 octobre 1917 – 5 avril 1918) (38-70).
1918 : Reuil, Tillé, Beauvais, Pouseaux, Saint-Omer-en-Chaussée, Marseille, Poix, Conty, Prouzel (5 avril) (71), Rumigny, Grattepanche (8-10 avril) (71-72), Estrées-Saint-Denis, Guyencourt, Remiencourt, bois Sénécat (10 avril – 1er mai) (72-88), Dommartin, Cottenchy, bois d’Enfeuil (1er mai) (88-89), Estrées-Saint-Denis, Grattepanche, Saint-Sauflieu, Nampty (4 mai) (90), Loeuilly, Conty, Belleuse, Lavacquerie (5 mai) (90), Mesnil-Conteville, Hamel, Grez (6-9 mai) (90-91), de Grez à Autreville (Meurthe-et-Moselle (10-21 mai) (92-96), Flammechamps, Morville, Sainte-Geneviève, Port-sur-Seille, Millery (23 mai – 7 août) (96 – 107), Millery à Epagny (Aisne) (8-22 août) (107-110), Vassens (23-29 août) (111-116), Paris (convalescence), retour au front (30 août – 16 octobre) (116-120), Mesnil-Saint-Georges, Montdidier, Warsy (16-30 octobre) (120-123), de Warsy à Grand-Verly (Aisne) (30 octobre – 1er novembre) (123-125), Grand-Verly (1er-7 novembre) (125-131), Lesquielles, Grougis, Aisonville, Boukincamp, Montigny, (8 novembre) (131) Fieulaine, Fontaine-Notre-Dame, Homblières, Saint-Quentin, Holnon, (9 novembre) (132), Savy, Etreillers, Vaux, Germaine, Foreste, Douilly, Matigny, Y, (10 novembre) (133), Béthencourt, Mesnil-Saint-Nicaise, Nesle, Rethonvillers, Sept-Fours (11 novembre) (134-135), Crémery, Fresnoy, Damery, Andechy, Guerbigny, Warsy, Davenescourt, Hamel-Contoire, Pierrepont (12-13 novembre) (135-136), Hargicourt, Malpart, Grivesnes, Le Plessier, Coullemelle, Rocquencourt, Tartigny, Caply, Troussencourt, Maisoncelle (Oise) (14 novembre) (136-137), de l’Oise à l’Alsace (17 novembre – 23 décembre) (137-143), Fraize, anould, Saint-Léonard, Saulcy-sur-Meurthe, Sainte Marguerite (22 décembre) (143), Coinches, Vanifosse, Neuvillers, Frapelle, l’Alsace (Vallée de la Bruche à Strasbourg) (23 décembre 1918 – 28 février 1919) (143-162).
1919 : Lorraine mosellane à l’Orient (28 février – 19 avril) (163-171), Roumanie et Bulgarie (19 avril – 1er septembre) (171-230).
Yann Prouillet, CRID14-18, décembre 2011
George, Henry (1890-1976)
Henry George en août 1965
1. Le témoin
Né en 1890, il est encore étudiant ecclésiastique à Nice, à l’école Vianney, quand se déclenche la Grande Guerre. Usant de sa qualité d’ancien aide-pharmacien, il est nommé brancardier régimentaire et est affecté à la 6e compagnie du 58e RI. Après la guerre, dans les années soixante, il sera président de l’amicale de ce régiment. Auteur de nombreux ouvrages de prose et de poésie en français et en occitan, il meurt en 1976.
2. Le témoignage
Henry GEORGE, Quand ça bardait. Visions et souvenirs de guerre. 1914-1918, Avignon, édition de la Méditerranée, 1968, 156 pages.
Henry George est nommé brancardier régimentaire quand s’ébranle de sa caserne d’Avignon la 6e compagnie du 2e bataillon du 58e RI du XVe corps d’armée en direction du front de Lorraine. C’est à Coincourt qu’il passe la frontière allemande le 10 août 1914 et c’est sur la route qui mène à Xures qu’il reçoit le baptême du feu, par l’obus et la fusillade. Ce 11 août se grave alors dans ses souvenirs en de multiples tableaux indélébiles, images tragiques d’une guerre déjà terrible laissant un régiment exsangue à la veille de la retraite. Blainville et Mont-sur-Meurthe en seront les stations elles aussi sanglantes, mêlant l’horreur d’une boucherie aux scènes familières des tableaux à la Détaille.
On retrouve l’abbé brancardier devant Saint-Mihiel le 30 septembre, où la tranchée favorise le repli sur soi, prélude au cafard puis à Ville-sur-Tourbe le 17 juin 1915 et à Saint-Vaast le 4 septembre 1916 pour de courts tableaux, icônes de souffrances militaires et civiles, images d’impiétés au milieu des sacrifices. Le 16 juillet 1916, il est devant Thiaumont, sous Verdun, humble devant la mort de l’abbé Gautier.
Sa seconde partie de souvenirs plus déployés montre, dès les premiers jours de 1917, l’embarquement pour l’Orient. Salonique, Athènes, Monastir offrent de nouveaux tableaux dépaysants avant qu’une note lui parvienne au « Ravin des Italiens », près de Monastir, le 12 mai 1917. Il fait partie des rapatriables et rentre alors en France pour ne plus décrire le front.
Le 4 août 1918, alors qu’il est affecté au 136e RI de Saint-Lô, il image un dernier tableau, dans l’Yonne, souffrant de la désaffectation en la foi catholique.
Le reste de l’ouvrage est ponctué de nombreuses poésies écrites devant l’ennemi.
3. Résumé et analyse
Brossant de trop rares tableaux, les souvenirs catholiques du soldat George sont trop dilués pour retenir l’intérêt de l’Historien. Relativement datés et localisés pourtant, les scènes de guerre de ce soldat prêtre-brancardier au 58e RI mélangent tableaux à la Détaille, spleen sur la déperdition de la foi en guerre et tragiques scènes de baptêmes du feu. Arrivé en garde d’Avignon le 4 août 1914, il ne note rien de bien saillant à l’ambiance vue dans la ville depuis le lycée de la caserne Chabran, « si ce n’est l’arrachement violent par la foule des plaques en émail, réclames du bouillon KUB, produit soi-disant allemand » (page 13). Le lendemain, il décrit le départ du 58ème et l’état d’esprit des soldats : « Chacun se figurait d’aller à la gloire. L’on concevait la guerre encore en paix ! » (page 14) mais éprouve « les premières souffrances physiques de l’état de guerre » (page 20), avant même ma frontière franchie. Il décrit un tir ami (page 25), la violence multiforme de la guerre des premiers combats en Lorraine, dans le secteur de Coincourt, jusqu’au 11 août, où l’état des pertes du régiment résonne ainsi : « A partir de ces jours de malheur, nous primes le deuil, c’est-à-dire qu’il n’y eut plus, chez nous, de gaîté folle ni d’exclamations bruyantes » (page 38). Le ton change en effet à l’épreuve de la guerre : il évoque « un soldat, nouveau venu, [qui] eut le triste courage de se faire sauter deux doigts de la main gauche, en feignant un accident involontaire » (page 56).
De fait, ce ne sont que les mois d’août et de septembre 1914 en Lorraine qui trouvent l’intérêt descriptif et narratif de cet ouvrage. Certes le prêtre ne déroge pas à l’espionnite (page 60) et aux rumeurs, rapportant que la garnison du camp des Romains, devant Saint-Mihiel, n’a fait montre d’aucune résistance, « le commandant du fort ayant un beau-frère, et son avenir, dans l’armée allemande » (page 84). Mâtiné de poésies limitant encore l’attrait testimonial, la seconde partie de l’ouvrage perd son caractère descriptif pour brosser une guerre plus introvertie et plus anecdotique. Sans comparaison avec Duhamel, il évoque parfois son rôle de brancardier, notamment à l’infirmerie du 2e bataillon alors à Ville-sur-Tourbe en Champagne. Ce moment lui permet d’évoquer un tableau plus rarement rapporté par les témoins : « Je déblayai toujours, et une pénible découverte vint encore m’attrister : c’était des revues pornographiques, des numéros de « La Vie Parisienne ». Et je me dis : « Comme préparation à la mort, c’est épouvantable ! Un jour, il faudra le dire. Ce jour est arrivé. Que les auteurs de ces saletés font du mal ! Ils sont plus redoutables que les torpilles, car ils tuent les âmes ». (page 89).
L’expérience balkanique de l’abbé George ne se limite plus en fin d’ouvrage qu’en un banal carnet touristique. On note une singulière « ode au brodequin » quand « Suau prononça une élégie sur les brodequins béants qui avaient foulé le sol de Lorraine, qui avaient parcouru tant de kilomètres et qui avaient été les témoins discrets de tant d’aventures » (page 86).
L’intérêt de ces « visions et souvenirs de guerre » est donc ténu, limité aux scènes de bataille du 58e RI dans les secteurs de Lagarde – Dieuze en Lorraine annexée. Il alimente toutefois les témoignages sur la guerre en Lorraine. Il est également une pièce au dossier du XVème Corps, dont l’abbé a bien sûr connaissance, qu’il évoque peu mais qui transparaît jusqu’en Grèce, où, devant Monastir, un coup de main monté par le commandement « de l’avis de tous, parfaitement inutile » et ayant occasionné « cent hommes hors de combat » avait été monté : « Dans quel but ? Il paraît que la calomnie du XVe Corps avait franchi les mers, et que le Haut Commandement voulait se rendre compte « si l’on marchait ! » (page 137).
Le livre, entaché de quelques coquilles et d’une typographie moyenne, est complété de documents iconographiques de moindre d’intérêt.
Parcours géographique suivi par l’auteur (date) (page) :
1914 : Nice, Vaison, Avignon (1-5 août) (11-16), Crèvechamps, Ville-sur-Moselle, Ferrières (8-10 août) (19-22), Coincourt, Xures (10-11 août) (23-38), Saint-Médard, (19 août) (39-41), Bures (15-16 août) (42-44), Dieuze (20 août) (45-47), Blainville-sur-l’Eau (25 août) (48), Mont-sur-Meurthe (26 août) (49-54), Adhoménil, Vitrimont (30 août) (55-56), Blainville (2 septembre) (57-57), Rehainvillers (4 septembre) (59-61), Montfaucon (23 septembre) (62), Avocourt (24 septembre) (65-68), Bois des Quatre Enfants (30 septembre) (75-77), Saint-Mihiel (1er-14 novembre) (79-87).
1915 : Ville-sur-Tourbe (17 juin) (88-89)
1916 : Saint Waast (4 septembre) (110-112), Thiaumont (16 juillet) (119-121)
1917 : Verdun, Toulouse, Toulon, camp de Zeitenlik, Salonique, Athènes, Monastir (17 janvier – 14 mai) (121-140).
Yann Prouillet, CRID 14-18, décembre 2011
Carrias, Eugène (1895-1961)
1. Le témoin
En 1948, Eugène Carrias, qui fut sous-lieutenant d’infanterie à Verdun, présenta en Sorbonne une thèse de doctorat en histoire, sous la direction de Pierre Renouvin, lui-même ancien combattant. Le sujet : La pensée militaire allemande. D’autres livres, articles, conférences avaient précédé cette soutenance, et allaient suivre, jusqu’à son dernier livre, en 1960, La pensée militaire française.
L’auteur est né le 13 avril 1895 à Grenoble, et fut élevé par son oncle, professeur au lycée de Nîmes. Il y fit lui-même ses études et, après le bac, y prépara Saint-Cyr. Après son succès à l’écrit en 1914, il profita du décret qui déclarait reçus les admissibles qui s’engageraient tout de suite. Sous-lieutenant en janvier 1915, il fut affecté dans le secteur de Verdun, au 164e RI. Blessé le 23 février, il dut être amputé de l’avant-bras gauche. Lieutenant en janvier 1917, il remplit diverses fonctions comme interprète. Marié en 1922, il suivit des cours à l’Ecole de Guerre et en sortit breveté d’Etat-Major. Sa carrière d’auteur est évoquée plus haut et détaillée dans le livre de ses souvenirs de 14-18.
2. Le témoignage
Le livre d’Eugène Carrias, Souvenirs de Verdun, Sur les deux rives de la Meuse avec le 164e RI, est publié en coédition par Patrimoine du pays de Forcalquier et C’est-à-dire éditions, avec présentation, notes et postface d’Emmanuel Jeantet, 2009, 271 p., illustrations (photos prises par l’auteur). Ces souvenirs n’étaient pas destinés à la publication, mais ils sont rédigés comme un livre, confié à des amis, et vraisemblablement connu de Jules Romains. Le texte, rédigé avant 1928, est trop précis pour qu’il ne s’appuie pas sur des notes prises au moment. Il manque cependant de dates, mais des extraits du JMO du 164e viennent combler la lacune. Le livre donne aussi le texte d’un cahier préparatoire pour la période cruciale du 9 au 22 février 1916.
3. Analyse
Dans les premiers jours, les départs se font sous les acclamations et « on s’étourdit de bruit, on s’enivre de paroles pour étouffer l’émoi que fait naître chez tous les menaces indécises de l’avenir ». On pourchasse les « espions », et les commerçants arborent un drapeau pour affirmer qu’ils sont de bons Français et éviter les bris de vitrines. Les défaites entraînent la montée vers le front de réservistes consternés de devoir partir. Les blessés raillent les journaux qui additionnent les milliers d’ennemis hors de combat : « si ça continue […] il n’y aura plus un Boche pour faire la guerre ».
En 1915, le jeune Carrias occupe des secteurs plutôt calmes : « pas un coup de fusil » ; Allemands « de bonne composition ». On vit la « vie terne des tranchées ». Chacun s’ingénie à améliorer ses conditions de vie, et les ordonnances font de même pour les officiers. Au printemps, alors qu’il avait eu l’espoir de partir en Orient (« mirages dorés »), Carrias reste avec son régiment aux environs de Verdun. Il décrit le village de Béthincourt en ruines. « Une vie de fonctionnaire de province terne et régulière » reprend. Les hommes se transforment en bûcherons ; les officiers jouent au poker quand ils ne croulent pas sous la paperasse administrative ; « les maisons où l’on vend à boire regorgent de monde » ; des jeunes filles et des soldats vont par bandes ». La tranquillité n’est troublée que par deux exécutions, ce qui, pour Carrias, « servira d’exemple aux fortes têtes ». Mais il rapporte les dernières paroles de l’un d’eux, adressées au peloton d’exécution : « Alors quoi, vous n’allez pas faire ça ! Je suis votre copain et vous voulez me tuer… Je n’ai rien fait… C’est une blague ! Je ne veux pas mourir… Eh bien ! Les copains, vous n’entendez pas ? » On comprend qu’une sentinelle endormie remercie l’officier de lui avoir passé un savon sans que les supérieurs soient informés.
Il y eut cependant une attaque, le 5 avril 1915, et le récit de Carrias fourmille de détails concrets : avant de se lancer, on allège les sacs ; la boue dans laquelle on doit se coucher bloque les culasses des fusils et on ne peut pas tirer ; le casse-croûte mêle « pain, viande et boue » ; les blessés « se lamentent dans les champs et crient pour demander du secours ; « la pluie a repris, elle tombe serrée et froide » ; pour la nuit, les hommes creusent des trous individuels, et les ordonnances en préparent de plus profonds pour leurs officiers. Après la relève, le guide perd son chemin. Louis Barthas et bien d’autres ont décrit de telles scènes ; même similitude dans l’évocation des petites « satisfactions matérielles et terre à terre » ; et encore de la première permission qui fait découvrir la guerre vue par l’arrière, « factice, rapetissée, déformée, présentée sous forme de clichés ».
Le dernier chapitre concerne le tout début de la bataille de Verdun en février 1916. L’attaque allemande est annoncée par divers signes : on découvre des brèches dans les réseaux de fil de fer ennemis ; on distingue des mouvements de troupes qu’un barrage d’artillerie tente de perturber. Lorsque le Trommelfeuer se déclenche, il est aggravé par le tir trop court des 75 français. Eugène Carrias est enterré sous son abri effondré. Ses hommes le dégagent ; il est gravement blessé au bras, évacué vers le poste de secours. Il faut l’amputer. Il termine cependant son récit par un cri de joie : « Je vis, j’ai le droit de vivre et je n’ose croire à mon bonheur. »
Rémy Cazals, décembre 2011
Jean, Renaud (1887-1961)
1.Le témoin.
Renaud Jean, premier député communiste élu en 1920 et membre du Comité Central du Parti communiste français entre 1932 et 1940, est né à Samazan dans le Lot-et-Garonne le 16 août 1887. Issu du monde rural (son père et métayer engagé dans des mandats locaux), possédant une solide formation scolaire, adhérent au parti socialiste en 1907 et porté par des idées révolutionnaires, Renaud Jean part en guerre à l’âge de 27 ans. Il a effectué son service militaire entre 1908 et 1910 dans un régiment régional, le 88e RI d’Auch et entre en guerre affecté au 24e RI colonial de Perpignan comme caporal (volonté d’éloignement?).
Il connaît la première épreuve du feu dans les Ardennes Belges le 22 août 1914. Après la retraite, redressement de la Marne où il est blessé le septembre. Soigné à l’hôpital auxiliaire du lycée Palissy (où il rencontrera sa future épouse, professeure agrégée de sciences naturelles). Il est définitivement réformé en janvier 1915. Il sera par la suite le fer de lance du communisme rural dans le département du Lot-et-Garonne mais également par ces engagements nationaux dans entre-deux-guerres.
Document : Archives départementales de Lot-et-Garonne, série R, registres matricules – carton 1 R 643
2. Le témoignage
Le carnet de Renaud Jean, authentifié, a été publié en totalité dans le numéro 44 des Cahiers du Bazadais en 1979 par Jacques Clémens. L’original contient 80 pages, dont 43 ont été le support de l’écriture du récit au crayon. Le carnet a été tenu au jour le jour, voire heure par heure pour certaines journées, comme celle de la blessure, que l’on peut située entre 11h et 14h le mardi 8 septembre 1914. Le récit de guerre s’arrête avec elle, après le retour à Agen le 13 du même mois.
3. Analyse
Assurément, les quelques notes laissées par Renaud Jean montrent un homme d’abord profondément antimilitariste. Il impute au « capitalisme », « patriotisme », « colonialisme » et « nationalisme », la responsabilité de l’entrée en guerre, soutenue par des « chefs » militaires injustes et pétris de « discipline ». Citant Kropotkine, « le prolétariat n’a pas su faire le socialisme », c’est un homme de culture révolutionnaire qui prend l’uniforme, c’est un homme aussi déçu par le cours des événements. L’attente du combat pèse sur ces propos de plus en plus défaitistes, d’autant qu’il se retrouve dans un régiment colonial où la cohabitation avec les cadres sous-officiers et officiers de carrière semble difficile. Et le 22 août dans les Ardennes belges, c’est l’épreuve du feu : le soldat Jean devient combattant, ce qui transparaît dans l’évolution de l’écriture. Le récit des combats, des rumeurs constamment évoquées, de la peur qui laisse peu de place à la réflexion de fond : « Quand on est au combat, on s’abrutit, on ne pense à rien » (31 août). L’adaptation se fait par la force des circonstances, qui sont d’abord celles de la retraite qu’il compare à la Débâcle de 1870 racontée par Emile Zola. Il perçoit rapidement que la guerre se gagnera avec l’artillerie et l’aviation que les militaristes « prussiens » utilisent avec intelligence. « Nous sommes victimes de l’incurie des administrations et de l’incapacité des chefs », écrit-il le 3 septembre. L’escouade, la section, le camarade que l’on voudrait retrouver dans le désordre du combat deviennent autant de repères qui montrent l’intégration littérale du soldat Jean dans la guerre, avant que la blessure ne l’éloigne définitivement du champ de bataille. Celui de la Grande Guerre tout du moins puisqu’il écrivait dès le 18 août : « (…) Je suis persuadé que dans 20 ou 40 années nous en aurons une nouvelle, et ainsi jusqu’à la consommation des siècles. Attendre la paix des gouvernants, c’est folie. » Son parcours de l’entre-deux-guerres est bien déjà en germe à l’automne 1914.
Alexandre Lafon