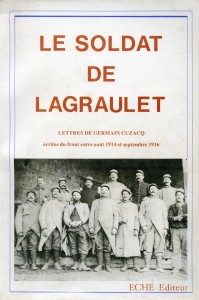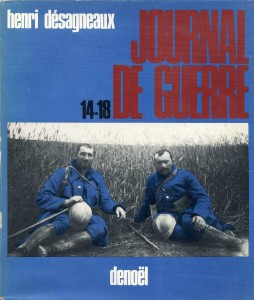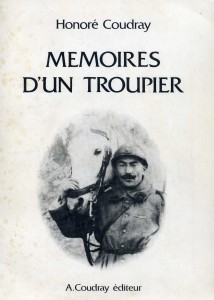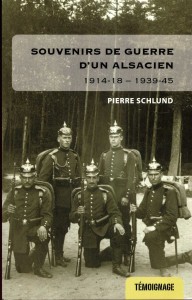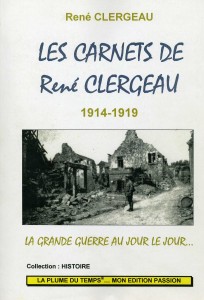Né à Perpignan le 19 janvier 1872 dans une famille de gros propriétaires terriens très catholiques, il a fait ses études au Caousou de Toulouse où on lui présenta la République « sous des aspects rien moins qu’attirants » (Gérard Cholvy). Il allait rester attaché à l’Action Française.
Devenu prêtre, il fut en 1899 secrétaire particulier de Mgr de Cabrières, évêque de Montpellier, catholique légitimiste, puis en 1907 vicaire général du diocèse de Perpignan, et en 1915 évêque de Gap. Appelé au service auxiliaire en février 1916, il était un des deux évêques assez jeunes pour être mobilisés. Il obtint d’être envoyé au front comme aumônier volontaire, rattaché au Groupe de Brancardiers du 30e Corps. Une photo le représente dans sa « cagna », qui semble relativement confortable, et où il arbore un drapeau tricolore marqué du Sacré-Cœur. Au cours de ses permissions, il revenait s’occuper de son diocèse.
Après la guerre, il participa à une mission au Levant de décembre 1919 à mars 1920 pour affirmer la présence et le rayonnement de la France. En 1928, il devint archevêque d’Avignon.
Les nouvelles de l’évêque, données par La Quinzaine religieuse du diocèse de Gap, constituent une sorte de carnet de guerre, qui n’a pas été retenu dans la publication des documents réunis et présentés par (un autre) Gabriel de Llobet, membre de sa famille. Le petit livre donne des extraits des lettres de l’évêque à sa sœur, puis les souvenirs du front de l’Aisne de mai à septembre 1918, rédigés en 1922. L’évêque signale la boue et les rats et il comprend les souffrances des soldats : « Ceux qui parlent de la guerre, dans les articles de journaux, sans en avoir jamais rien vu, feraient bien de s’inscrire pour un hiver ici. Et notre cas n’est rien à côté du pauvre poilu de la tranchée ! » Mais il revient bientôt à ses positions politiques : « Le régime s’enlise dans la boue et il ne faut attribuer à autrui les maux dont il est cause. »
* Un évêque aux armées en 1916-1918, Lettres et souvenirs de Mgr de Llobet, documents réunis et présentés par Gabriel de Llobet, préface de Gérard Cholvy, Limoges, Pulim, 2003, 133 p.
Rémy Cazals
Gabard, Ernest (1879-1957)
L’acte de témoigner explicitement peut se matérialiser sous différentes formes. Ernest Gabard, âgé de 35 ans lors de l’entrée en guerre, ancien élève de l’Ecole des Beaux-Arts à Paris, versé au 270e RI, est l’un de ces artistes qui ont utilisé leur talent au service de leur mémoire de guerre. Il choisit ainsi de fixer son expérience du conflit à travers la production d’aquarelles, prolongeant après-guerre son activité artistique par les sculptures ornant une quinzaine de monuments aux morts érigés dans le Sud-ouest de la France dans les années 20, dont beaucoup seront de facture pacifiste.
Les 42 aquarelles publiées avec soin dans le cadre des missions éducatives du CDDP des Pyrénées-Atlantiques ont été réalisées sur des feuilles de petit format, reliées entre elles par un anneau, facilement transportable dans la musette. Le régiment de l’auteur oscille alors entre les différents secteurs du front de l’Argonne, entre La Harazée et la rive gauche de Verdun. La confrontation avec le Journal des Marches et Opérations de son unité montre que le témoignage reste fidèle à l’expérience de l’auteur.
Chaque aquarelle porte, comme un album photographique construit, date et légende permettant de localiser scènes et paysages. La production conservée et publiée couvre la période de novembre 1915 à avril 1916.
Les aquarelles d’Ernest Gabard se rapprochent des productions et du trait de Mathurin Méheut, notamment lorsqu’il s’agit de dessiner les hommes du front (voir en particulier pp. 11 et 57 dans MÉHEUT Maturin, 1914-1918, des ennemis si proche, présenté par Elisabeth et Patrick Jude, Rennes, Éditions Ouest-France, 2001). Dans le cas de la production d’Ernest Gabard, le spectateur se trouve face à une succession de sujets propres à l’expérience de fantassin vécue par l’auteur, à l’image de cette aquarelle datée du 23 mars 1916, réalisée à Villers-les-moines et portant la légende : « La loge à cochon… que j’habite ! » L’auteur croque ainsi des scènes du quotidien : « Nubécourt, Noël 1915 à la veille de « prendre les tranchées » le lieutenant réunit les offs et s/offs du bataillon. Réunion des plus gaies et des plus cordiales. Le s/lt Allain chante « Chargez ! » On retrouve les thèmes classiques de la littérature de témoignage : la vacuité du temps long de l’attente, les jeux, les tranchées, les abris, le matériel et les armements auxquels doivent faire face les combattants, l’arrivée des premiers casques et des masques à gaz… Ernest Gabard choisit un cadrage ressemblant à la photographie sépia usant d’une riche variation de teintes. Ses œuvres décrivent un univers guerrier et masculin, comme une sorte de « huis-clos » dont les civils sont absents, empreints d’une certaine douceur qui rompt avec la réalité de la violence de la guerre de siège. Cet univers est marqué par l’adaptation continue de ses occupants, à l’image de la transformation de l’autel d’une église en pleine air qui « devient salon de coiffure et bureau où chacun va faire sa correspondance ». Le « regard » de l’artiste offre alors à l’historien une porte d’entrée supplémentaire pour appréhender la guerre de tranchée, propice à la production d’un tel témoignage.
Il reste à souligner la qualité de l’édition qui propose lexique et appareil critique utile et complet, et surtout la mise à disposition d’un site Internet qui permet d’avoir accès aux aquarelles : http://sites.crdp-aquitaine.fr/gabard/
Carnet de guerre. Aquarelles. Novembre 1915-avril1916, Pau, CDDP des Pyrénées-Atlantiques, 1995.
Alexandre Lafon
Bronchart, Léon (1896-1986)
Le témoin
Né en 1896, à Bapaume, Léon Bronchart grandit dans les villes ouvrières du Pas-de-Calais et du Nord. Fils d’une dévideuse en soie et d’un tailleur de pierre, il suit si bien l’enseignement élémentaire qu’il obtient le certificat d’études primaires à onze ans. Mais, alors qu’il espérait poursuivre des études, la maladie de son père prive la famille de revenus et le jeune Léon doit trouver du travail. D’abord teneur de moule dans une verrerie blanche, il change plusieurs fois de fonction et d’employeur, travaille notamment dans le bâtiment, avant d’être embauché par la compagnie des chemins de fer du Nord. Influencé par son père, syndicaliste et coopérateur, mais aussi par sa mère, fervente catholique, il s’intéresse très tôt au débat public et le curé de sa paroisse lui fait fréquenter un milieu catholique engagé où il « dévore » les brochures de Marc Sangnier dont la condamnation des idées par le Vatican, en 1910, est un « coup de masse » qui éloigne Bronchart de la religion.
Après la Grande Guerre, il reprend son travail dans les chemins de fer, où il acquiert une qualification de mécanicien (qui lui permet de conduire les locomotives à vapeur), et s’engage dans le mouvement socialiste, à la SFIO et à la CGT. Opposé à la division syndicale, il est localement un des précurseurs de la réunification au début des années 1930, ce qui ne l’empêche pas d’être en 1923 volontaire pour l’occupation de la Rhénanie où il contribue à briser la grève des cheminots allemands. Il part pour le Maroc deux ans plus tard, au moment de la guerre du Rif, et s’y insurge à propos des inégalités que subissent les cheminots marocains par rapport à leurs collègues métropolitains (p. 65-69). Dans ses mémoires, il dit avoir été le seul de son site ferroviaire à faire grève en février 1934 (p. 105). En 1939, à la déclaration de guerre, bien qu’âgé de 44 ans et père de trois enfants, il tente d’intégrer dans une troupe combattante mais ne parvient qu’à être affecté à une section de chemins de fer de campagne. Son engagement dans la Résistance (à Combat, notamment dans les NAP, puis dans les MUR) est ensuite la cause de son arrestation par la Gestapo puis de sa déportation, à Oranienburg-Sachsenhausen, puis Buchenwald et Dora. De retour après la Libération, il retourne à la SNCF jusqu’à sa retraite, en 1947. Après avoir été honoré par de nombreuses décorations (il est notamment commandeur de la Légion d’Honneur), il meurt en 1986.
Le témoignage
Publié en 1969, Léon Bronchart… Ouvrier et soldat, un Français raconte sa vie (Vaison-la-Romaine, imprimerie H. Meffre, 204 p.) est le récit autobiographique d’un homme qui explique que, « depuis toujours, [s]es amis [lui] demandaient d’écrire, de raconter [s]a vie ». Organisé en cinq parties, l’ouvrage est structuré par les deux guerres mondiales, ce que reflète le choix de leurs titres : « Avant 1914 » (20 pages), « La guerre 1914-1918 » (34 pages), « Entre deux guerres » (20 pages), « La guerre 1939-1945 » (104 pages) et « Après 1945 » (29 pages). C’est la Seconde Guerre mondiale qui constitue l’élément le plus important de ce récit : plus de la moitié du livre y est consacré. En dehors même du récit des deux guerres et des captivités de l’auteur, nombre de passages correspondent à un témoignage original, tel le subterfuge de son premier employeur qui fait sonner la cloche de la verrerie avec un timbre particulier « quand un inspecteur du travail se présente, afin que les gosses qui n’ont pas l’âge prennent la fuite et se cachent » (p. 19). Sa description de la solidarité dont bénéficie un enfant de gréviste à la Belle Epoque est particulièrement intéressante (p. 16-17) tandis que le rôle éminent qu’il prête à un de ses instituteurs recoupe les nombreux écrits de jeunes gens scolarisés sous la Troisième République (notamment le roman inachevé d’Albert Camus). Comme tout témoignage, cet ouvrage est une œuvre de mémoire et nous en apprend beaucoup sur la perception d’événements et de dynamiques par son auteur au moment de la rédaction sans qu’il faille espérer y trouver une relation rigoureuse de faits. Ainsi, pour ne prendre que cet exemple, il évoque « l’excommunication de Marc Sangnier » (p. 24-25) alors qu’il s’est agi en réalité de la condamnation par le pape Pie X de la « fausse doctrine du Sillon ».
S’il est longtemps resté peu connu, ce livre a néanmoins a été diffusé parmi les anciens déportés (ceux de Dora notamment). C’est au début du XXIe siècle, dans le contexte d’un intérêt manifesté au rôle des chemins de fer dans la politique nazie de destruction des juifs d’Europe (Christian Chevandier, « Le grief fait aux cheminots d’avoir, sous l’Occupation, conduit les trains de la déportation», Revue d’histoire des chemins de fer, Actes du colloque de Paris -décembre 2005-, Les cheminots dans la Résistance. Une histoire en évolution, n° 34, printemps 2006, p. 91-111.), que le livre acquiert une certaine notoriété. Son auteur consacre une demi-page (p. 100-101) à son refus d’assurer le 31 octobre 1942 la traction d’un train comprenant deux voitures de prisonniers politiques, suivi quelque temps plus tard par celui de conduire un train de troupes allemandes. Mis en avant comme le témoignage du « seul refus de conduire un train de déportés », alors qu’il s’agit plus précisément du seul témoignage connu à ce jour d’un refus de conduire un train comprenant des voitures d’internés (politiques dans ce cas), il a notamment donné lieu à une recherche dans les Archives de la SNCF qui ont permis d’approfondir la connaissance de cet épisode : Marie-Noëlle Polino, « Léon Bronchart, ouvrier, soldat… et cheminot : un destin, une figure », Revue d’histoire des chemins de fer hors-série, n°7, 2e édition, août 2004, p. 160-172 (cet article ne figure pas dans l’édition initiale de novembre 2002).
Analyse
Le premier souvenir de l’armée que raconte Léon Bronchart est celui d’une confrontation entre celle-ci et la population de la paroisse à l’occasion de l’inventaire de l’église de la Madeleine, dans la banlieue de Lille, lorsqu’il rentre de l’école alors qu’il a une dizaine d’année : « Tout cela bouleverse ma conscience d’enfant » (p. 15). Sa participation lorsqu’il est adolescent à la société scolaire de tir « à la carabine Lebel » et à la société de gymnastique et de préparation militaire, parmi d’autres activités (il est ainsi baryton à l’Harmonie municipale et joue également dans l’équipe de football), lui permet d’être assez familier de la chose militaire. Cela, à en croire ses mémoires, n’empêche pas une vision critique de l’institution. Les souvenirs de son grand-père maternel, ancien soldat du Second Empire qui a gardé un souvenir aigu de la campagne du Mexique, sont souvent sollicités par le petit-fils qui apprécie « le récit des faits d’armes, des actes héroïques ». Mais l’aïeul « termin[e] toujours en essayant de [lui] faire comprendre les atrocités de la guerre » (p. 26). Ce qui le conduit, avec un ami adjudant de réserve, à exprimer à l’été 1914 « [leurs] craintes sur les malheurs d’une guerre et [leur] désir de voir la paix maintenue ». Tous deux sont alors traités « de lâches et d’antipatriotes » par leur auditoire. « Notre avenir fut notre réponse », conclut-il en évoquant la mort de son ami Raymond Quette « à la tête de sa section » pendant la bataille de la Marne.
Tout comme il a intitulé le chapitre II de son ouvrage « Ouvrier à 11 ans », il dénomme le suivant « Soldat à 17 ans », la précocité de ses expériences étant une des caractéristiques de la vie de l’auteur. C’est que, dès le 28 août 1914, il doit, avec ses parents qu’il quitte à cette occasion (notamment son père, qui s’engage également et qu’il ne reverra plus), évacuer leur région. Il se joint alors à une compagnie du 60e régiment d’infanterie qu’il accompagne dans sa retraite : « J’ai ramassé un fusil, récupéré les munitions que j’ai pu trouver ; je suis devenu l’agent de liaison du lieutenant » (p. 30). Lorsque son unité est près de Paris, il se rend au bureau de recrutement de la Porte de la Chapelle. En dépit de l’absence de divers documents (notamment une autorisation paternelle), son engagement est accepté et il part de la gare de Lyon pour rejoindre à Annecy, comme engagé volontaire, le 11e bataillon de chasseurs alpins. C’est « quelque part vers Péronne » qu’il est, très vite, fait prisonnier. Il est alors transféré en Allemagne en un « voyage » de huit jours assez éprouvant : « Dans les gares, les sarcasmes des hommes, les lazzis des enfants, les poings tendus des femmes » (p. 35). En captivité, il demeure alors à Wittenberg, à Stendal où il est employé à l’extraction de la tourbe dans les marais avoisinants, à Orhdruf, Soltau, Rubeland, Mannheim, Kürnbach, Rheinau, etc. Ses nombreuses tentatives d’évasion ne l’empêchent pas de sympathiser parfois avec ses geôliers ; c’est ainsi qu’à la prison de Pforzheim, il a de longues discussions avec le gardien-chef auquel il explique que « si les Allemands avaient écouté Liebknecht comme les Français écoutent Jaurès, la guerre n’aurait pas existé » (p. 43). A Kirchheim, il prépare une nouvelle évasion lorsqu’il est libéré, début novembre 1917, dans le cadre d’un échange par la Suisse. Après un mois de permission au cours duquel il apprend la mort par tétanos de son père blessé dans un combat, il essaye de rejoindre son frère cadet, engagé dans le régiment de marche de la Légion étrangère. Bien qu’il estime qu’il n’a pas tenté de s’évader pour « devenir un «embusqué» », il est affecté comme infirmier à l’hôpital Sébastien-Gryphe de Lyon. Alors qu’il est prévu qu’il se rende à Salonique, il insiste avec la force de caractère dont il fait preuve tout au long de sa vie pour être affecté sur le front français. C’est ainsi qu’il devient brancardier au 1er bataillon du régiment de marche de la Légion étrangère, assiste à des assauts de chars, subit des bombardements : « Nous avons traversé un champ de bataille où pas un cadavre n’avait été bougé. […] L’horreur dans toute son ampleur. Sur tout cela, planait une odeur pestilentielle, qui nous prenait à la gorge et dont il nous a fallu un certain temps pour [se] défaire » (p. 52). C’est à cette occasion qu’avec d’autres soldats il croise une automobile. Un légionnaire « regarde à l’intérieur », reconnaît le général Mangin et « crie d’une voix très forte » à ses compagnons : « Connaissez-vous le boucher ? » Il (p. 53). Léon Bronchart participe ensuite à des combats au Chemin des Dames (notamment à Terny-Sorny, Juvigny, Margival, Laffaux) avant de retrouver son frère, qui est gazé : « Ce n’est peut-être pas désespéré, mais très-très grave. J’ai pensé à lui, à Maman » (p. 55). Il assure le commandement de l’infirmerie du bataillon (« Tous mes camarades ont été tués ou blessés ») lorsque est signé l’armistice. C’est après la fin des hostilités qu’un jeune lieutenant-médecin avec lequel il avait sympathisé est tué accidentellement lors d’une séance de pêche à la grenade : « Lorsque je me suis penché sur lui, il a juste remué les yeux. Moment le plus atroce que j’ai vécu de toute la guerre » (p. 59). Avant d’être démobilisé, il participe à l’occupation du Palatinat et en profite pour rendre visite à Rheinau au directeur de l’institution à laquelle était rattaché son kommando et des mauvais traitements duquel il avait été victime durant sa détention. L’ancien prisonnier lui rend alors « la monnaie du compte qu’il [lui] avait si largement ouvert » (p. 59).
A partir de 1918, le souvenir de sa Grande Guerre obsède Léon Bronchart, et les références explicites et implicites y sont courantes dans son récit de la Seconde Guerre mondiale. Il présente l’engagement au sein de la Résistance comme étant dans la logique d’une vie d’ancien combattant (sans qu’il faille y supposer une connotation religieuse, il parle de « même foi » à propos d’un de ses amis ancien de 1914-1918 et participant à l’action d’un mouvement de Résistance). Cela est d’ailleurs assez commun et si la « manifestation patriotique » à laquelle il participe le 11 novembre 1942 est organisée le jour anniversaire de l’armistice de 1918, beaucoup de démonstrations populaires de la Résistance ont, sous l’Occupation, lieu ce jour-là (ainsi que les 14 juillet et les 1er mai). Lorsqu’il passe en conseil de discipline à la suite d’un refus de conduire, le président des cheminots anciens combattants de Tours propose, en vain, de le défendre. Il parvient cependant à déstabiliser le conseil de discipline en situant son geste dans la continuité de son action pendant la Grande Guerre et il n’a qu’une sanction minime (p. 105-107). Mais, s’il cite des courriers qu’il a reçus et où il est question de « Boches » et de « Bochie », l’on ne trouve jamais sous sa plume le moindre propos germanophobe.
Christian Chevandier
Cuzacq, Baptiste dit « Germain » (1886-1916)
1. Le témoin
Baptiste Cuzacq (ou Cuzac) dit Germain est né au lieu-dit Lagraulet à Geloux dans les Landes. Il est le 4e de neuf enfants d’une famille de métayers gemmeurs d’origine plébéienne et dont le père est analphabète. Il quitte l’école de son village à 11 ans mais continue sa scolarité par des cours du soir et acquiert ainsi une bonne instruction primaire, l’enrichissant d’une passion pour la lecture encouragée par les instituteurs du village. Il travaille donc très tôt au champ et à la forêt avant, en 1906, de faire deux ans de service militaire au 144e RI à Bordeaux, puis deux périodes de réserve en 1910 (28 jours) et en juin 1914 (17 jours). Vers 1910, il reçoit de son père la direction de la métairie et se marie en octobre 1912 avec Anna Labarrère, née en 1893. Il a une fille, Julia, née en octobre 1913, qui vient agrandir un foyer où se côtoient déjà 11 personnes pour trois générations d’une même famille. Le 6 août 1914, il quitte sa ferme et rejoint le 234ème R.I. de Mont-de-Marsan où il est affecté et meurt le 3 septembre 1916 à Fleury-devant-Douaumont.
2. Le témoignage
Cuzacq, Germain, Le soldat de Lagraulet. Lettres de Germain Cuzacq écrites du front entre août 1914 et septembre 1916. Toulouse, Eché, 1984, 156 pages.
Baptiste Cuzacq, dit Germain, a 28 ans à la déclaration de guerre et se voit affecté à la 22e compagnie du 234e R.I. de Mont-de-Marsan, réserve du 34e d’active. Ce 13 août 1914, après un voyage en train depuis les Landes, il débarque à Nancy sous les vivats de la foule et prend à pied le chemin du front, vers son baptême du feu dont il ne témoignera pas « à chaud ». Pourtant, la prise de contact du 234ème avec les réalités d’une guerre qui tue est terrible. Jeanty Dupouy, autre « pays » rapporte « une certaine émotion » à défaire les paquets de cartouches devant Delme, en Lorraine allemande. Après avoir essuyé quelques balles, c’est la retraite jusqu’au Grand Couronné de Nancy où les poitrines se redressent et font à nouveau face à l’ennemi. Germain quant à lui écrit sa première lettre le 9 septembre. Les grands affrontements de la bataille des frontières sont passés et aucun sentiment ni aucune nouvelle alarmiste ne transpire alors. Il va rester sous les monts du Grand Couronné jusqu’au 18 juin 1915 et n’envoyer à sa famille que des nouvelles apaisantes d’un front calmé dans lesquelles il tente d’exercer malgré les distances son rôle de chef de famille. Ce premier hiver de guerre est rude dans la forêt de Champenoux ; la santé se maintien mais les tranchées sont humides et sentent mauvais. L’hiver passe, les beaux jours reviennent, monotones sous la voûte d’artillerie.
Le 18 juin 1915, le régiment quitte le secteur de Champenoux pour celui, plus terrible, du bois du Zeppelin dans le secteur de Lunéville. Le 28, il écrit : « il y a dix jours que nous sommes sous un bombardement continuel ; nous occupons des bois et des marais où, nuit et jour, il faut se retrancher et se battre sans jamais avoir de repos afin de se garantir un peu des projectiles. Nous avons aussi fait une attaque. Le hasard m’a sorti encore sain et sauf jusqu’ici » page 63). C’est enfin l’aveu des souffrances de guerre. Le 7 juillet, il avoue « je vous assure que j’ai bien eu besoin ces jours-ci de ce que vous m’avez envoyé ; autrement, je ne vivrais plus » (page 65), le bombardement et la maladie transparaissent enfin de ces lettres jusqu’alors familiales et presque détachées de la guerre.
Le 11 juillet, il regagne le secteur de Laneuvelotte, plus calme, avant de faire une courte apparition dans les Vosges, du côté de Fraize, jusqu’au 3 août, et de revenir aux avant-postes devant Nancy à l’entrée de l’hiver.
Le 13 janvier 1916, il part pour sa première permission au cours de laquelle il retrouve les siens, dont sa fille Germaine qu’il n’avait pas vue depuis 17 mois.
En février 1916 s’allume à quelques dizaines de kilomètres de Nancy la formidable bataille de Verdun. Le 28 février, le 234e reçoit l’ordre d’occuper le Bois Chenu entre Châtillon et Moulainville. Les tranchées sont « des trous que nous avons faits dans la terre sans être recouverts. Nous sommes toujours sous l’ouragan de feu et d’acier et les Allemands nous envoient aussi des gaz suffocants » (page101). De plus, Germain Cuzacq souffre à nouveau de diarrhées, accentuées par un temps épouvantable. Il tient grâce au renfort moral de sa famille et des colis, nombreux, qui sont le lien entre l’arrière et l’enfer. Le 22 juin, après une courte période de repos, le régiment remonte en première ligne au Réduit d’Avocourt, sur la rive gauche de la Meuse. Ce séjour va dépasser en épreuve ce qu’il a connu jusqu’alors de la guerre. Exténué de fatigue lors de la « simple » montée en secteur, pataugeant dans 20 centimètres de boue au fond de la tranchée, paysage lunaire constamment arrosé de tout ce que l’artillerie prodigue en projectiles, le soldat de Lagraulet voit tomber autour de lui les copains, morts, blessés ou malades. La bataille de Verdun ne cesse pas d’intensité et le 29 août, le 234e est engagé devant Douaumont, dans ce que fut Fleury, autre fournaise. Pressent-il sa mort le 27 août, lorsque arrivé en secteur il prend toute disposition pour que les copains préviennent sa famille : « Alors par les uns ou par les autres, vous pourrez toujours avoir des nouvelles en cas d’accident… » (page 138).
Le 2 septembre, il écrit : « Ma santé est toujours bonne (…). Sommes ici pour le quatrième jour ; nous ne savons pas quand nous serons relevés, nous avons toujours des pertes énormes » (page 142). Le lendemain, Baptiste Cuzacq meurt à son tour dans le charnier perpétuel, laissant à sa femme et à ses deux enfants la dernière lettre comme ultime souvenir d’un mari et d’un père.
Deux annexes commentent certaines des lettres de Germain Cuzacq telle celle faisant référence à une volonté gouvernementale de favoriser la natalité, soulevant pour les soldats l’indignation du spectre de la chair à canon et de la débauche des femmes restées au pays ou celle semblant parler de fusillés énigmatiques au 234e RI. Enfin, l’histoire du trésor que représentent ces quelques 400 lettres rappelant au lecteur comme à l’historien la possibilité de verser au patrimoine commun et à l’immortalité les histoires intimes de chacun de ces héros.
3. Résumé et analyse
Pierre et Germaine Leshauris, la fille de Germain, présentent cette histoire du jeune Landais de Lagraulet dans une courte notice biographique qui démontre l’origine plébéienne de ce fils de métayers-gemmeurs passionné de lecture. Ils commentent et enrichissent 400 lettres en les amorçant pour la période du 1er au 13 août 1914. Une correspondance intime, très personnelle, entre un mari et sa femme où la guerre, si elle est omniprésente, est secondaire et peu décrite par ce métayer-gemmeur très soucieux de ses affaires et de sa famille restées au pays. C’est également l’édition de témoignages également rares des soldats landais, discrets et besogneux qui sont venus mourir aux frontières du nord, pays si lointains dans une guerre incompréhensible pour ces paysans, comme l’est la signification du glas qui sonne à l’église de Geloux le 1er août 1914 (page 11).
L’ouvrage est opportunément présenté et enrichi par Pierre et Germaine Leshauris de témoignages de quelques autres soldats du 234e RI tels les extraits du journal, intéressant et intense, de Jeanty Dupouy du Meysouet, le témoignage oral de Jean Sady et la correspondance d’autres membres de la famille Cuzacq qui comblent les vides épistoliers et annoté de quelques commentaires généraux ou techniques. Ceux-ci portent sur des sujets aussi divers que le repeuplement et le sentiment du soldat, qui le voit comme une incitation à la débauche des femmes restées à l’arrière (page 145), la légende des gendarmes pendus à des crocs de boucher à Verdun (page 146) ou l’histoire de Herduin et Millan, fusillés sans jugement (page 147). Ce livre représente au final un exemple correct de présentation de ces archives familiales indispensables pour parfaire la connaissance sociologique de la Grande Guerre.
Le livre est aussi abondamment illustré de clichés généraux mais également de photographies tirées d’archives iconographiques présentant le 234e en secteur. Elles sont reportées hors pagination. Quelques cartes précisent les lieux d’affectation de l’unité mais, dessinées à main levée, leur précision est discutable (dans les Vosges, le col de la Chipotte est par exemple confondu avec le col du Haut-Jacques (page 69).
L’ensemble présenté est d’honnête qualité, quelque peu desservi par une illustration médiocre. Le régime d’annotation avec renvoi en fin de chapitre est peu clair et fastidieux à la recherche, page à page, car non indiqué. Celles-ci eurent pu être reportées en bas de page, présentation plus lisible. On note également de nombreuses fautes typographiques et de relecture, surtout vers la fin de l’ouvrage et également quelques erreurs géographiques dans l’étude des parcours de l’unité. Malgré ces errements, « le Soldat de Lagraulet » peut apparaître comme un ouvrage d’intérêt pour l’étude des soldats landais dans la Grande Guerre au cours de la période d’août 1914 à septembre 1916.
Plusieur éléments sont à retirer de l’étude de cette correspondance majoritairement consacrée aux relations familiales et civiles de Germain Cuzacq et de sa famille et à la survivance quotidienne. L’auteur replace dans le contexte les mille petites choses et actes du quotidien du soldat. L’ouvrage en est ainsi riche d’enseignements sociologiques sur la vie du poilu. Le 12 août 1914, lors du trajet vers le front, Germain écrit : « En cours de route, des officiers nous annoncent que la guerre a déjà fait beaucoup de blessés mais peu de morts » (page 16). Il rapporte ainsi d’emblée le bourrage de crâne, qu’il connaît avant même l’arrivée au front et l’espionnite, avec l’arrestation d’une femme qui faisait des signaux aux Allemands (page 21). Il est aussi confronté à la sévérité disciplinaire de ses cadres (pages 35 et 36) dont il ne partage pas les mêmes conditions de vie : « Il ne faut pas comparer notre existence à celle des officiers parce qu’ils ont tout ce qu’ils veulent. Vous ne pouvez pas vous figurer les tenues fantaisies qu’ils ont à leur disposition et don t ils se servent jusqu’aux postes les plus avancés. Quant à leur nourriture, la plupart de ces messieurs n’ont jamais été aussi bien nourris avant la guerre » (page 95). Il confessera plus loin qu’il en profite un peu toutefois (page 113). S’il mange de la « viande congelée depuis 10 ans » (page 37) au début de la campagne, il trouve anormal de devoir jeter du pain, délivré en trop grande quantité (page 54). Il évoque aussi le « singe », « viande de bœuf cuite assaisonnée dans de petites boîtes en fer battu de 300 grammes » (page 64). La nourriture restera une préoccupation permanente tout le long des courriers. Le colis est primordial ; celui du premier noël de guerre vient des « familles riches » (page 38), les autres auront une telle importance dans le moral des hommes qu’il en dit : « autrement je ne vivrais plus » (page 65). Par contre, Cuzacq fustige l’alcool, le « Chicogno » (page 134). Le sac est aussi important ; la perte du sien, pulvérisé par un bombardement est un petit drame qui touche à l’intime comme au fonctionnel (page 85).
Comme beaucoup, il s’étonne du peu de malades en regard des conditions climatiques à la tranchée (page 41). Il parle beaucoup de son uniforme, du pantalon rouge râpé (page 40) bientôt remplacé, le 6 février 1915, par la tenue bleu horizon dite « grise » ainsi que le képi (page 43), nouvelle tenue dont il déplore la médiocre qualité (page 48). Il trouve moins cher et moins fastidieux de donner ses vêtements à laver (pages 44 et 50). L’hygiène et la maladie font également partie de ses préoccupations et les petits trucs sont rapportés comme le camphre respiré dans un mouchoir contre les épidémies (page 45) ou sa lutte contre la boue par l’adjonction d’une tige tibiale en cuir, serrée à la cheville (page 112). Cette boue « que personne ne peut se figurer ce que c’est que celui qui s’y trouve, c’est abominable » (page 127).
Il raconte finalement peu ses combats, redoutant l’attaque « à la fourchette », la baïonnette, (page 49) et parle peu de l’ennemi. Le 7 1915, il en dit : « Nous avons le droit d’envoyer certains objets allemands comme souvenirs mais comme ils sentent si mauvais, je ne m’en suis pas occupé » (page 65).
Index des localités, dates (et page) du parcours suivi par l’auteur :
1914 : Mont-de-Marsan, 1er août (11), Tours, 11 août (16), Troyes à Nancy, 12 août (16), Villers-les-Nancy, 13 août (17), Lenoncourt, 15 août (19), Cercueil, Velaine, Brin-sur-Seille, forêt de Gremecey, Fresnes, Delme, Puzieux, 19 août (20), Donjeux, forêt de Gremecey, 20 août (21), Pettoncourt devant Moncel, Mazerulles, Laneuvelotte, Seichamps, Vandœuvre, 21 août (22), Plateau de la Rochette, Ecuelle (ferme de Quercigny, ferme du Cheval Rouge), lycée de Bosserville, Faulx, 22 août -14 septembre (23), Dommartin, 18 septembre (29), Laître-sous-Amance, 5-9 octobre (30), Lay-Saint-Christophe, 15 octobre (30), forêt de Champenoux, 18 octobre (31), Lay-sous-Amance, 28 octobre (32), Velaine-sous-Amance, 3-14 novembre (32), Lay-sous-Amance, 14 novembre (33), Laneuvelotte, 3-14 décembre (35), Brin-sur-Seille, 18 décembre (36), forêt de Champenoux, 19 décembre (36), Laneuvelotte, 20 décembre (37), Etang de Brin-sur-Seille, 21 décembre (37).
1915 : Laneuvelotte, 3 janvier (38), Mazerulles, 21 janvier-10 avril (41), Réméréville, 11 avril (49), Champenoux-Mazerulles, 21 avril-2 juin (50), Laneuvelotte, 2 juin-16 juin (55), Courbesseaux, 17 juin (61), forêt de Mondon (sud-est de Lunéville), 18 juin (61), Bois du Zeppelin, 20 juin (62), Reillon, 21 juin (62), Bois Sans Nom-Bois Noir, 23-30 juin (62), Domjevin, 1er juillet (64), Veho-Leintrey, 2-7 juillet (64), Marainviller-Laneuvelotte-Bouxières-aux-Chênes, 8-18 juillet (66), Fraize, 22 juillet-1er août (68), Laneuvelotte, 4-9 août (70), Quercigny, 9 août-4 septembre (71), Bouxières, 5 septembre (74), Mazerulles, 10 septembre-18 octobre (75), Bouxières, 24 octobre-6 novembre (79), Velaine-sous-Amance, 7-28 novembre (80), Quercigny-Lanfroicourt-ferme Candale, 29 novembre-14 décembre (83), Laneuvelotte, 16 décembre-11 janvier (86).
1916 : Bouxières, 12 janvier-25 février (89), Bouxières-Silmont (Meuse), 27 février (99), Bois-Chenu-Chatillon-sous-les-Côtes-Moulainville-camp de la Béole, 28 février-5 mars (100), Camp de la Chiffour, 6-29 mars (102), Moulainville-Basse, 29 mars-25 avril (106), Canal de l’Est entre Dieue et Haudainville, près de Dugny, 26-30 avril (113), camp de la Chiffour, 30 avril-11 mai (114), entre Eix et Damloup, 12-21 mai (116), camp de la Chiffour, 22 mai-7 juin (117), Réduit d’Avocourt-camp de la Verrière, 27 juin-19 août (125), Triaucourt-camp de Jubécourt, 19 août (137), Riancourt, 21 août (138), camp d’Avoust, 27 août (138), Fleury-devant-Douaumont, 29 août-4 septembre (138).
Yann Prouillet, CRID14-18, janvier 2012.
Desagneaux, Henri (1878-1969)
1. Le témoin
Henri Desagneaux est né le 24 septembre 1878 à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne). Il fait ses études à la capitale, au collège Massillon, et devient juriste, attaché au Contentieux de la Compagnie des Chemins de Fer de l’Est. Lieutenant de réserve, son ordre de mobilisation prévoit qu’il rejoigne le service des étapes et des chemins de fer à Gray (Haute-Saône). Il débute la guerre dans son domaine et est réaffecté en janvier 1916 dans une unité combattante. Entre-deux-guerres, il devient conseiller municipal, adjoint au maire de Nogent, de 1920 à 1942, après une courte période de remobilisation comme chef de bataillon de réserve pour la campagne 1939-1940. Il a au moins un fils, Jean, qui publie ses souvenirs. Henri Desagneaux meurt le 30 novembre 1969.
2. Le témoignage
Desagneaux, Henri, Journal de guerre. 14-18. Paris, Denoël, 1971, 291 pages.
L’ouvrage a été traduit en anglais sous le titre A French Soldier’s War Diary, Elmsfield Press, en 1975.
Le vendredi 31 juillet 1914, à la Compagnie des Chemins de Fer de l’Est, l’ambiance est mêlée d’anxiété quand survient l’ordre de transporter les troupes à la frontière. La France est menacée ; c’est le début d’une gigantesque guerre européenne dans laquelle Henri Desagneaux, alors lieutenant de réserve dans le service des étapes et des chemins de fer à Gray, devra prendre sa place. Pour l’heure, le 3 août, il assure son poste ferroviaire et prend la conduite des trains de ravitaillement. Il rapporte de suite le grand bouleversement des peuples et des choses, des hommes qui partent au front, remplaçant d’autres qui en reviennent dans des trains de blessés. Il entend les invraisemblances des bruits populaires et note les détails de la fourmilière qui l’entoure. Le 18, la mobilisation ferroviaire est terminée alors que s’engage le choc de la bataille des frontières. Le 20 août, il prend un train qui l’emmène à Badonviller et s’approche alors du front, dont il peut sentir le souffle de mort. Il rapporte ses visions de blessés et se fait le vecteur des horreurs boches inventées dans le sein populaire alors que l’ennemi recule. Mais c’est bientôt la retraite d’août, prélude à la bataille d’arrêt qui borde, en terre lorraine, la Marne.
La guerre s’est installée quand Desagneaux apprend sa nomination, à la veille de 1915, au poste d’adjoint au commissaire régulateur de Gray, puis de Besançon. Décideur, il endosse et rapporte alors les fonctions bureaucratiques mais effervescentes qui permettent l’écoulement des besoins d’une armée et le glissement des divisions. Le travail est intense mais monotone et insipide et l’année 15 se passe à compter les trains et leur contenu, hétéroclite ou tragique.
Le 1er décembre 1915, une loi prend naissance pour réintégrer dans leur arme les officiers de chemin de fer de moins de 40 ans. Le 10 janvier, il quitte son « service fastidieux et si peu récompensé ». Il est affecté au 359e RI de la 129e DI et part sans regret aucun au centre d’instruction des commandants de compagnie à Remiremont, dans les Vosges. Après des débuts difficiles – il n’est pas annoncé, n’a pas d’ordres -, il suit un mois de cours intensifs et intègre un secteur en Lorraine le 16 février 1916. Là aussi, il n’y pas de place pour lui mais reçoit toutefois une affectation à la 22e compagnie du 6e bataillon du 359e RI. L’accueil qu’il reçoit est froid et il juge sans complaisance ses nouveaux subordonnés, de tous grades, mais aussi le désordre qu’il constate. Quand éclate l’orage sur Verdun, la division est en réserve en Lorraine, sur la Seille, à Arraye-et-Han. L’activité y est peu importante et les coups de main ne servent qu’à attraper du poisson dans la rivière.
Le 31 mai 1916, c’est Verdun et le fort de Vaux dans la fournaise, domaine d’une artillerie toute puissance qui fait tout trembler, même les « gens avec la croix de guerre » ! Les nuits, les jours sont terribles ; « on vit dans le sang, dans la folie »… « A la 24e compagnie, deux hommes se suicident ». Et Desagneaux de décrire l’enfer et l’hécatombe, les blessés devenus fous qui veulent que leur lieutenant les délivrent à jamais…
Le 5 juillet, le lieutenant Desagneaux passe capitaine à titre définitif, nomination agrémentée d’une citation. Le 14, il est au Bois le Prêtre où le crapouillotage n’est pas moins virulent. Il quitte ce secteur pour une période de manœuvres au camp de Bois l’Evêque.
C’est ensuite – le 20 novembre 1916 – la Somme où une attaque est prévue puis ajournée. Dès lors, l’activité est moindre mais les conditions climatiques d’une pluie quasi perpétuelle liquéfient le moral. Le 11 janvier 1917, Desagneaux n’est pas mécontent de quitter ce secteur pour intégrer le Groupe d’Armée de Rupture, qui sera chargé, avec 400 000 hommes de réaliser une percée.
Pour l’instant et après un voyage de 42 heures, il arrive à nouveau dans les Vosges, à Corcieux, où ne règnent plus le bruit et la boue, mais le froid persiste. Il va connaître un autre type de guerre à la Chapelotte, dernier contrefort vosgien au nord du massif montagneux, en Meurthe-et-Moselle ; la guerre de mines. Le secteur est considéré comme important et le travail n’y manque pas. En effet, le colonel veut des prisonniers ; il faut donc multiplier les coups de main. Préparés à l’arrière par des officiers hors de propos, ils sont systématiquement coûteux et infructueux.
Le mois de mai le renvoie à l’exercice à l’arrière mais « l’esprit de la troupe devient de plus en plus mauvais ». Les mutineries pointent alors que le 359e monte maintenant au Chemin des Dames, à la Royère, où c’est de nouveau le règne du bombardement. Là se produiront les attaques allemandes de juin et juillet devant des troupes débandées qui refusent parfois d’attaquer (comme les 120e et 121e BCP les 22-23 juin). Les troupes environnant notre capitaine ne seront pas à la hauteur, tâche indélébile aux yeux des décideurs de l’arrière. Mais le régiment est tout de même exsangue et Pétain, grand sauveur de l’armée en dérive, se révèle à Desagneaux être une « triple brute » ! Dès lors, la rétorsion s’abat sur le régiment : les citations sont systématiquement refusées, les exercices, les revues et les brimades s’y multiplient, les hommes sont traités comme des bêtes avant la remontée en ligne à Cœuvres puis, à la fin de juillet 1917 dans le secteur de Vauxaillon où l’enfer reprend, où « il faut vous habituer à vivre dans la merde ».
1917 s’achève en travaux et en soutien de l’armée anglaise à Champs, dans la Somme, qui s’est calmée depuis son précédent séjour, terrible. Il creuse, plante des piquets ou attend, dans le froid et la neige.
1918 commence également dans le froid mais sur un autre front où il arrive le 4 février à Saint-Ulrich en Alsace. Là, il travaille encore la terre. En effet, secteur réputé calme, l’Alsace voit venir nombre de politiques et de militaires qui viennent « sur le front ». Le capitaine Desagneaux change d’affectation. Il quitte sa 21ème compagnie le 28 avril et est nommé capitaine adjudant-major, adjoint au commandant du 5e bataillon. La division retourne bientôt sur la Somme où elle reste en réserve de l’armée britannique, en alerte, puis entre en Belgique dans le secteur du Kemmel au nord-ouest d’Armentières. Là, la bataille fait rage et l’espoir d’être relevé ne s’allie qu’à l’idée d’atteindre 60 % de pertes. Les attaques se succèdent et chaque jour passé est une victoire sur la mort. Le 20 mai 1918, c’est l’attaque qui combine l’artillerie et les gaz et les heures terribles d’angoisse.
Le 11 juin 1918, une nouvelle terrible attaque, aidée de tanks, secoue le capitaine Desagneaux et sa compagnie. Les pertes sont considérables mais insuffisantes et l’été se succède en coups de mains. Cet été si terrible pour les Allemands, se passe dans l’Oise, à Courcelles. L’Allemagne lâche pied, c’est la poursuite et la continuation des attaques. Mais la division ne quitte pas le secteur, elle est en ligne depuis juin et a avancé de 30 à 35 kilomètres avant d’enfin, le 5 septembre, quitter le champ de batailles qui a vu tomber tant des siens.
Le 7 septembre, il revient en Lorraine. Les victoires françaises se multiplient et c’est là que le coup de grâce doit être donné. Après une permission de 16 jours, Desagneaux fait retour dans un régiment dissous (le 4 octobre 1918). Il est appelé à la fonction d’adjoint au colonel et est chargé de préparer les coups de mains de l’attaque de novembre, conjointe avec les Américains, soit 600 000 hommes en ligne. L’artillerie s’amasse, le général Mangin est annoncé dans le secteur, quand les plénipotentiaires allemands s’avancent dans le Nord. Il apprend dans la liesse l’Armistice et note qu’il peut maintenant dormir sans entendre le bruit du canon. Le 17 novembre, Desagneaux entre en Lorraine annexée près d’Arracourt et débute une occupation morne avant d’être démobilisé, sans joie, le 30 janvier 1919.
3. Résumé et analyse
Henri Desagneaux livre au lecteur et à l’historien un témoignage brut, dur, dense et précis, tant dans la psychologie du combattant que dans l’horreur vécue, décrite sans fard et sans autocensure. Jean Desagneaux, son fils, à qui l’on doit cette publication, nous renseigne peu sur l’auteur mais indique que ses notes n’ont subi aucune modification postérieure : « elles sont là telles que chaque jour elle furent notées sur le carnet. Plus tard le Capitaine Desagneaux en les recopiant leur adjoint des coupures de presse qui venaient les compléter ou les recouper ». Un journal aide-mémoire donc, qui permit à l’auteur de « prendre conscience de ce qu’il vivait », un moyen d’être sûr qu’il ne devient pas fou (page 8).
La première année de guerre, vécue dans le chemin de fer est une année d’attente. L’auteur est un témoin éloigné des choses du front, aussi il relaye à l’envi les psychoses et les ragots d’août 1914, à défaut d’un véritable intérêt dans l’emploi qu’il occupe. Ainsi, les deux premiers chapitres qui couvrent la première année de guerre, du 2 août 1914 au 10 novembre 1915, ne couvrent que 38 pages.
Début 1916, son affectation dans le 359ème R.I., régiment d’active, sans cesse à la peine, va plonger l’auteur dans un enfer perpétuel de mort et de souffrance. Sans souci de style Desagneaux reporte cette horreur et introduit le lecteur « in situ », dans la tranchée invivable, le froid, la boue, les gaz, les râles et le sang. Dès lors, il livre un excellent témoignage, dont on trouve des similitudes d’intensités avec celui de Dominique Richert (il passe d’ailleurs à Saint-Ulrich, village du poilu alsacien) par le réalisme des descriptions d’attaques.
Henri Desagneaux est de surcroît un officier de réserve, lieutenant puis capitaine ; il n’en a donc pas la retenue militaire et ne se prive ainsi pas dans la description de ses sentiments sur les hommes et les choses militaires qui l’entourent. Sans souci de pondération, il écrit dans ses notes ce qu’il ressent et chacune des inepties qu’il rencontre est rapportée avec zèle. Officiers, techniques, moral, habitudes typiquement françaises sont critiquées au même titre que la gestion déplorable des hommes, tant dans l’attaque, en tout temps, que dans la crise morale de 1917. Desagneaux confirme et enfonce le clou ; le soldat craque, se suicide avant l’attaque, râle en implorant qu’on l’achève, souffre plus que le supportable, mais le soldat est aussi sale, voleur, là où l’officier d’active est planqué et le commandement incompétent et loin de toute réalité. Autant de personnages décrits avec réalisme dans leur diversité. Ce sont donc trois années de guerre qui sont bien décrites, de 1916 à 1918 où Desagneaux, en témoin honnête, déroule sa vie de soldat, dure et teintée de profond dégoût.
Ainsi, l’ouvrage offre une multitude d’anecdotes, de détails et de tableaux sur la guerre dans les différents milieux côtoyés par l’auteur. Les renseignements sur les hommes, bruts et sans retouche littéraire, sont à privilégier. A noter aussi de très bonnes descriptions psychologiques de l’attaque.
En bon agent de chemin de fer, les premières pages en témoignent. Desagneaux déplore ainsi les rames superbes du Paris-Vienne dégradées par la « destruction française » (page 16) et relève la moyenne des trains à la mobilisation ; 2,5 km/h. Il relève les inscription sur les trains (page 18) et la mort de notables en auto, tués par des G.V.C. dans lesquels il y a trop d’alcooliques (page 19). Il relève qu’il y a trop de non-combattants à l’arrière (page 21), les carences dans l’organisation du transport des blessés et du ravitaillement (page 21) et voit arriver au front les voitures hétéroclites de livraisons des magasins parisiens (page 23) mais au final, il conclut pour cette période, le 18 août 1914 : « La mobilisation est terminée ; le tout, au point de vue chemin de fer, s’est passé avec une régularité parfaite, avec un retard de 2 heures sur l’ensemble des 18 jours, pour l’horaire établi » (page 24). Plus loin, il compare la régulation effectuée et le chiffre des denrées transportées pour une armée dans le premier Noël de guerre (page 41).
Sa tâche effectuée, il devient plus critique envers ce qui l’entoure. Il commence, comme tant d’autres, par éreinter le XVe corps dont il dénonce la lâcheté (pages 30 et 37) et les exactions (page 37). Sa rancune semble tenace car il reviendra sur ces « Lâches ! gens du midi » en juin 1918 (page 240). Constatant un grand nombre d’automutilation et de blessures à la main des soldats pour quitter le front (pages 33 et 35), il fustige rapidement le service de santé entre anarchie médicale et débauche (page 34), voyant 180 médecins en réserve à Gray, au comportement écœurant (page 37). Volontiers colporteur d’espionnite, une usine allemande de chaux à Ceintrey, devient une base arrière allemande (page 38). Réaliste, il indique à plusieurs reprises dans son récit la réalité des ordres donnés d’en haut. En avril 1916, il note : « les généraux n’ont tien à mettre sur leur rapport quotidien, alors le même refrain revient chaque jour : faire des prisonniers. On envoie des patrouilles sans succès, cela se passe généralement à aller pêcher du poisson dans la Seille à coups de grenades. Le lendemain, on fait un rapport et on recommence » (page 66). Il relève l’ineptie des travaux commandés selon les unités successives (page 67) mais, arrivé à Verdun, la réalité change : « C’est une lutte d’extermination, l’homme contre le canon. Aucune tactique, la ruée totale » (page 77), « on vit dans le sang, dans la folie » (page 85), pour déféquer, « il faut faire dans une gamelle ou dans une pelle, et jeter cela par-dessus notre trou » (page 84) et « à la 24ème compagnie, deux hommes se suicident » (page 86). Il n’est pas étonnant qu’il reporte le rêve des soldats de la bonne blessure : « On en vient à souhaiter, la mort non, mais la blessure de chacun pour être partis plus vite. (…) L’un abandonne une main, l’autre fait cadeau de son bras, pourvu que ce soit le gauche, un autre va jusqu’à la jambe. » « Quelle vie ! de faire à chaque instant l’abandon d’un membre pour avoir la possibilité de revenir » (pages 201 et 202).
Verdun quittée, le calme revient. Desagneaux évoque dans son secteur (Bois-le-Prêtre) des fraternisations et des échanges de cigarettes (page 95) et voit revenir des notes idiotes comme des inventions inutiles comme les gargarisme contre la diphtérie (page 101). Il note en avril 17 une augmentation de la désertion (page 102) et de l’alcoolisme (pages 102, 121 et 130)et donc une augmentation des conseils de guerre le 3 avril 17. C’est le départ des mutineries qu’il constate et pour lesquelles il est très prolixe puisqu’il y consacre 36 pages (pages 129 à 155).
Bien qu’officier, il n’est pas tendre avec sa hiérarchie amont. Sur une note de colonel, il commente : « la première ligne doit être attractive et non répulsive », toutefois, on ne le voit jamais au front (page 118). Et Pétain, qui a rassemblé ses officiers : c’est une « brute, triple brute (…) [il] ne s’est pas montré un grand chef, tout au moins pas humain » page 151). Plus loin, il accuse un colonel peureux, qui organise toutes les batailles pour sa seule protection ! (page 247) et voit un officier saoul pour l’attaque (page 258). Proposé pour la légion d’honneur, il apprend même, le 10 août 1918, « qu’à la division on ne peut avoir cette récompense que si l’on a été mutilé ! » (page 263). Son amertume grandit ainsi avec l’exercice du commandement sous le feu, tellement différent du « badernisme » (page 275) et devant les pertes que son unité subit en 4 mois (pages 269 et 270). Desagneaux grogne ! Il râle contre la paperasserie inutile (page 192), les citations aux hommes… de l’arrière (page 160), le gâchis, suite à un ordre d’allègement des sacs (page 191), contre les embusqués (page 213) une attaque sans morts … à refaire ! (page 255) ou contre le gendarme qui chasse le braconnier, mais pas sur le front. ! (page 282).
Outre sa mauvaise humeur permanente, nombreuses sont ses descriptions aussi justes que dantesques : une corvée de soupe effroyable sous les obus (page 204), un PC devant le Kemmel (page 208), l’illustration d’une attaque, minute par minute (page 215 ou 234). Ponctuée de tableaux horribles, il décrit horrifié différents visages de morts mutilés (page 248), le résultat dantesque pour les occupants d’une automitrailleuse prise sous des balles anti-chars (page 261) ou, horreur de l’horreur, un homme cadavre vivant (page 267).
L’ouvrage présente au final un intérêt testimonial formidable, rehaussé d’une présentation originale insérant le communiqué officiel ou l’article de presse dans sa situation chronologique, démontrant le fossé entre la réalité et le quotidien du soldat. Sont insérées également en marge des photos, connues ou inédites, malheureusement trop petites et tronquées toutefois.
Yann Prouillet, CRID14-18, janvier 2012.
Coudray, Honoré (1889-1967)
1. Le témoin
Honoré Coudray, fils d’Auguste-François Coudray, douanier, et d’Honorine Planche, est né à Saint-Michel-de-Maurienne, en Savoie, le 8 octobre 1889. Il passe son certificat d’études avant d’apprendre l’ébénisterie chez un de ses oncles. Homme cultivé, il a très tôt un goût pour la littérature qu’il conservera jusqu’à la fin de sa vie, écrivant même des contes pour ses petits-enfants. Il exercera le métier d’assureur et terminera sa carrière comme cadre moyen d’une compagnie à Grenoble. Marié une première fois en 1919 à Adèle Biard, il se remarie après 8 années de veuvage à Marthe Brion, qui lui survivra jusqu’en 1985. Il aura quatre enfants et c’est l’un d’eux, Aimé, qui publie ses souvenirs. Honoré Coudray meurt le 14 février 1967 à La Tronche (Isère).
2. Le témoignage
Coudray, Honoré, Mémoires d’un troupier. Un cavalier du 9ème Hussards chez les chasseurs alpins du 11e BCA, Bordeaux, Aimé Coudray, 1986, 228 pages.
Affecté au 9e régiment de hussard à l’été 1914, c’est pourtant au titre d’éclaireur monté et d’agent de liaison que le « troupier » Honoré Coudray, 25 ans, va faire la guerre pendant toute sa durée au 11e BCA. Dès lors, il écrit sa campagne avec continuité et décrit les secteurs qu’il parcours en tous sens : les Vosges principalement, mais aussi la Somme, la Champagne, l’Italie puis la ligne Hindenbourg. L’Armistice ne met pas fin à sa relation et ce n’est que le 29 mars 1919 qu’il abandonne le joug de 5 années de guerre qu’il a traversées par miracles renouvelés chaque jour.
Alors que le tocsin sonne aux églises de Grenoble, Honoré Coudray rejoint le 9e régiment de Hussards. Il arrive dans les Vosges avec Dormeur, son cheval, le 7 août 1914 et est affecté au 11e BCA. Il participe à la bataille des frontières du côté du lac Blanc puis à la retraite vers Taintrux et le Kemberg. Le reflux allemand vers sa frontière le ramène à Saint-Jean-d’Ormont, à proximité duquel se cristallise bientôt le front. Il ne le verra pas, transporté dans la Somme puis dans les Flandres et en Artois. Laminé, le 11e revient dans les Vosges au début de janvier 1915. En février, Poincaré et un quarteron de généraux passent les chasseurs en revue, avant l’Alsace où il frôle une nouvelle fois la mort, son cheval blessé sous lui. Il est un temps évacué à l’hôpital de Gérardmer pour bronchite – et gale ! – mais tient ce dur secteur montagneux jusqu’au début de l’été 1916.
Il débarque dans la Somme pour les combats de juillet devant Curlu où, « en peu de jours, 500 hommes étendus sur la terre picarde où ils font des points bleus ». Nul étonnement qu’une nouvelle période de repos vosgienne soit nécessaire. Au mois de novembre il est détaché au 4e groupe de chasseurs alpins (1er, 12e et 51e BCA) et monte à 607, dans la haute vallée de la Fave avant une période d’instruction au camp vosgien d’Hadol, préliminaire à une période d’hiver en Alsace, dans le secteur de Dannemarie. Le printemps 1917 l’amène en Champagne puis dans l’Aisne, dans le secteur de Craonne, où il participe à l’instruction des Américains dans la Meuse.
Au mois de novembre, il apprend son changement de front et embarque pour l’Italie. Il y raconte sobrement sa campagne, faite de peu de combats, et revient, la brèche comblée, sur le front le l’ouest, s’opposer aux attaques allemandes, entre Somme et Artois. Il connaît encore de terribles journées dans la poche de Château-Thierry, aux offensives de Dammard à Rocourt puis dans celle d’Andéchy au nord de Montdidier. L’été 1918 passé, il prend part aux batailles de libération au nord de Saint-Quentin. L’armistice le trouve à Chigny, devant Guise. C’est la fin du cauchemar mais pas de sa situation sous les drapeaux, tant il parcours encore la région parisienne dans l’attente de sa démobilisation : « la levée de l’écrou » ! Et de conclure : « Sur combien de routes avons-nous déjà laissé le sillon de nos fatigues et les fils cassés de notre ardente jeunesse » (page 120).
3. Résumé et analyse
Formidable témoignage, issu d’un hommage filial, riche de continuité dans un poste particulier d’éclaireur monté, emploi rarement évoqué. C’est aussi un trésor d’écriture où l’érudition le dispute au caustique, rehaussée d’un véritable talent descriptif et d’un soupçon de critique politique qui font de ces « Mémoires d’un troupier » l’un des tous premiers témoignages d’intérêt sur la Grande Guerre. En effet, ce livre est une véritable perle éditoriale tant Honoré Coudray passe en permanence sous le souffle de la mort sans aucune égratignure, mais aussi témoigne d’un don d’écriture manifeste, alliant précision descriptive et analyse critique juste et efficace de son environnement. Dès les premières pages, on prend la mesure d’un esprit cultivé et profond. Si le lyrisme et la métaphore l’emportent parfois sur le descriptif, c’est également avec talent. Il porte sur les officiers qui l’entourent le regard acéré d’un bon observateur de la valeur des hommes. Ainsi, plusieurs tableaux ethnologiques d’intérêt sont à lire sur l’Italie et sa population, même si ce chapitre est le moins long de son parcours. Il prend parti, notamment contre les Américains dans une violente diatribe rappelant que leur sacrifice ne fut rien en regard de celui du soldat français (page 215). Sans polémique gratuite, Honoré Coudray est un excellent témoin de son temps. Seule concession, – mais est-elle de l’auteur ou du présentateur ? -, les noms de certains soldats, soit qu’ils aient été mal perçus, soit qu’ils aient été honnis (cas du soldat Jacques Serre, fusillé à Anould le 16 mars 1916), ont été caviardés. Toutefois, les initiales correspondent et il peut être aisé de les rétablir. Honoré Coudray expose son ressort d’écriture : « Je tire aujourd’hui ma révérence à la sombre comédie-dramatique des notes pour moi péniblement recueillies depuis le bruyant soir du 1er août 1914. J’ai écrit avec la parfaite insouciance de la perfection de l’art de s’exprimer, sans aucun souci d’étiquette, ni respect de la plus élémentaire convenance, le protocole n’étant pas mon cheval de bataille. J’ai tracé à brûle-pourpoint, comme j’ai vu, comme j’ai entendu, comme j’ai senti, d’autant plus que je n’ai et n’aurai jamais l’audace ni la pédanterie de livrer le contenu de mes tablettes à la publicité… » (pages 217-218).
Réflexif et descriptif, le livre fourmille de tableaux anecdotiques, telle cette vision de chiens battant du beurre en Flandre (page 36), ou la description de l’état de l’uniforme après 4 mois de guerre (page 38). Volontiers critique, il l’est du Bulletin des Armées de la République en décembre 1914 (page 40) et distille ses réflexions opportunes sur la condition de l’homme-matériel et l’incurie, exemplifiée, de la question de sa mort (page 42). Il s’interroge plus loin sur la force de mémoire du soldat après-guerre : « je doute fort que la plupart de ceux qui en reviendront aient seulement la force du souvenir dans leurs actes et celle d’en imposer la mémoire vivace » (page 66).
Il décrit d’un style badin, faussement naïf, les « commerçantes de toutes essences », « nuées de femmes de tous âges [qui] assaillent les soldats ébahis avec leurs bidons de café et de chocolat. Puis d’autres, moins mercenaires, les emmènent à leur domicile afin de partager le pain et le sel, du moins je le suppose. C’est bien pire qu’un invasion de sauterelles » (pages 59-60). Badin certes mais aussi misogyne sur la femme électrice (page 110). Il est aussi volontiers ironique dans sa vision des Vosges, remarquant à La Bresse la « chose curieuse, dans ce pays où l’on tisse tant de toiles, les lits n’ont pas de draps » ! (page 72). Il l’est moins quand il constate le traitement réservé au soldat et y reviendra souvent dans son témoignage. Pour s’en convaincre, nous reportons le lecteur dans l’utilisation de son témoignage par Nicolas Offenstadt dans Les fusillés de la Grande Guerre et la mémoire collective. (1914-1999) (Odile Jacob, 1999). Dans les Vosges, il rapporte l’exécution du chasseur Jacques Serre qui, ivre, avait bousculé un commandant (page 75) ou l’assassinat d’un soldat soi-disant voleur, meurtre à mettre au débit du commandant P. (Pichot-Duclos) (pages 89 et 96). Plus loin, un gendarme factionnaire jeté dans un canal (page 90) ou gardant les permissionnaires « parqués » (page 91). Les cadres sont aussi l’objet de toute son « attention », même si parfois ils ressemblent à des enfants (page 129).
La presse fait également souvent l’objet de sa colère : Hervé, rédacteur à La Victoire est « un pilier de prison qui a évolué ! Après avoir traîné le drapeau dans le fumier et écrit des saloperies de tous genres » (page 101). Il sert une violente diatribe sur le mensonge journalistique (pages 120 et 166) ou celui du bulletin de la République, suspendu au 12 mars 1918, et dont les « feuilles alimentaient les archives des feuillées, dernier refuge des bourrages de crânes imprimés » (page 166). Il rapporte ce qu’on lit aux tranchées, y compris les images érotiques placardées sur leur paroi (page 151). Il évoque comme une maladie la contagion des vraies comme des fausses nouvelles (page 188). Une réalité toutefois est qu’au 11 novembre 1918, il reste seulement 4 soldats ayant vu le début de la guerre dans le groupe de liaison de Coudray (page 198). Cela déclenche chez lui une analyse désabusée et clairvoyante de l’après-guerre politique du soldat, auquel il faudra rendre le dû politique au soldat de la paix et sa participation aux traités (pages 203 à 205). Par contre, il est peu disert sur les mutineries, et se contente d’en rapporter la rumeur et de tenter une explication du phénomène (pages 127-128).
Souvent préoccupé par la nourriture, il estime nécessaire la maraude alimentaire (page 164). D’ailleurs, sur ce point précis, il déclare que tout homme revêtant l’uniforme devient voleur (cf. l’affaire du vol de volailles de Villers-les-Rigaud) (page 178). Plus anecdotiquement, il fait des repas de corbeaux (page 175), de paon (page 200) ou d’un lapin mangé par les vers, cuisiné en civet quand même pour la partie comestible (page 177). Attentif à l’hygiène, il décrit des Italiens malpropres (page 160) et s’inquiète de la grippe espagnole en mai 1918 et en décrit les symptômes (page 175).
« Mémoires d’un troupier » n’est pas introduit et l’on doit à la quatrième de couverture de connaître l’origine filiale de la transmission de ce journal de guerre. Il est par contre très correctement construit, haussé d’un cahier iconographique central montrant le héros et deux cartes opportunes rappelant les zones d’opérations du 11ème B.C.A. Opportunes sont également les annexes (à partir de la page 220) synoptiques du parcours chrono-géographique d’Honoré Coudray, qui complète l’architecture de l’ouvrage, divisé par années en grandes périodes de combats. Enfin, deux courts index des noms des militaires et des unités cités (pages 227 et 228) sont des ajouts trop rarement rencontrés dans ce type de parution. Enfin, quelques fautes ont été corrigées par un errata de l’éditeur. Une édition au format inadapté et à la typographie médiocre n’entachent pas ce formidable document.
Ultra référentiel et alimentant de première importance l’étude du front des Vosges, cet ouvrage est à lier intimement à celui de Louis Bobier et à rapprocher dans la stylistique du journal de guerre d’Henri Désagneaux (voir leur notice dans le présent dictionnaire).
Noms cités (page) :
Angele (Cpt) (84), Anne (163-164), Basbayon (47), Belmont (Lt) (29-69), Bertrand (Cpt) (111-131-137-140), Bordeaux (Col) (39), Bouvier (11-12-13-42-47), Buyer de (Col) (24), Cassin (Cpt) (42), Ciambelli (Cdt) (194-213), Clerget (174), Collet (Cdt) (24), Coquand (Cpt) (10), Delorme (Sgt-major) (181), Desforges (Cpt) (181), Dhorm (Ss-lt) (149), Doyen (Cpt) (55-99-183), Dumesnil (Lt) (183), Fabri-Fabreques de (Cdt) (100-181), Ferrand (153), Ferret (Col) (39), Forest des (Cpt) (140), Girard (13), Gras (183), Guillot (vétérinaire) (74), Heinrich Louis (107), Jargot (5-9-13à16-21-25-27-29-30-34à36-73-74-77-209), Jarrige (47), Jorraz (13-15-47), Lalande (Cpt) (181), Lancon (Col) (113), Lebrun (Gal) (118-123), Lecomte (Cdt) (93), Levrat (100), Lionne (18), Marade (Cpt) (42), Perrier Auguste (108), Pigeat (Lt) (34-47), Poirat Henri (38-108), Poncet Léon (4-114), d’Armau de Pouydraguin (Gal) (108-144), Quinat (Lt-col) (100-107-113-126-131-174-201), Roch (39), Rousset (Lt) (88), Rousset (Lt-col) (131-144), Ruffier (25-27), Rufflier (145-146), Sabardan (54), Seigle (120), Touchon (82), Vittoz (120), Wendling (136-141).
Liste des communes citées (date – page) :
1914 : Grenoble, Chambéry (2-7 août – 3-4), Epinal, Docelles, Corcieux, Fraize, Plainfaing (7-12 août – 4-8), Orbey, Lac Blanc, col de louspach, Bonhomme, Colroy-la-Grande, col de la Charbonnière, Saint-Blaise-la-Roche (12-24 août – 8-14), Bourg-Bruche, Saales, La Grande Fosse, La Petite-Fosse, Saint-Jean-d’Ormont, Moyenmoutier, Saint-Prayel, Nompatelize, Saint-Michel-sur-Meurthe, La Bourgonce, Les Rouges-Eaux, Bois-de-Champ (25 août – 2 septembre – 14-17), Taintrux, le Kemberg, Vanémont (2-12 septembre – 17-20), La Culotte, Saint-Jean-d’Ormont (12-15 septembre – 20-22), Clermont (Oise), Fournival, La Herelle, Le Cardonnois (Somme), Montdidier, (15-24 septembre – 22-25), Harbonnières, Vauvillers, Cappy, Méricourt, (25 septembre – 11 novembre – 25-32), Calais, Bailleul, Belgique (12 novembre – 14 décembre – 33-40), La Comté, Mingoval, Mont-Saint-Eloi, Caucourt (14-31 décembre – 41-42).
1915 : Acq, Tincques, Chelers, Saint-Pol (1er – 14 janvier – 44), Gérardmer (14 janvier – 18 février – 45-48), Soultzeren, Metzeral (19 février – 25 août – 48-58), Corcieux (26 août – 3 octobre – 59-61), Belfort, Buethwiller (4-16 octobre – 61-63), Gérardmer, Lingekopf, (16 octobre – 19 décembre – 63-67), Vagney, Xoulces, Moosch, Hartmanswillerkopf (20 décembre 1915 – 15 janvier 1916 – 67-72).
1916 : Anould, Fraize (15 janvier – 1er mars – 73-74), Lac Noir, Rudlin (1-16 mars – 74-77), Kruth, Hilsenfirst (17 mars – 27 juin – 77-85), Fouilloy (Somme), Boves, Gentelles, Cachy, Villers-Bretonneux, Vaires-sous-Corbie, Méricourt-sur-Somme, Curlu, Suzanne, Maurepas, Cappy, Eclusier, Cléry, (27 juin – 25 octobre – 86-97), Laveline, Combrimont, 607, la Croix le Prêtre, Beulay, Mandray, (26 octobre 1916 – 24 janvier 1917 – 98-105).
1917 : Hadol, camp d’Arches, Dounoux (Vosges) (25 janvier – 8 mars – 106-111), Belfort, Bourbach-le-Haut, Dannemarie (11-31 mars – 112-116), (Aisne) Corrobert, Courbouin, Verdon, Jaulgonne, Crugny, Aougny, Vincelles, Le Charmel, Artonges (1er avril – 14 mai – 117-125), Vendières, Verdelot, château de Vinet, Brécy, (15 mai – 5 juin – 117-129), Courville, Ventelay, Marceau (Chemin-des-Dames), Pontavert, Craonne (5-24 juin – 129-132), Gondrecourt, Mauvages (9 juillet – 11 septembre – 134-145), Courtisol, Tahure (15 septembre – 3 novembre – 145-153), Italie, Monte Tomba, plateau d’Asiago (7 novembre – 12 avril 1918 – 153-171).
1918 : Amiens, Guignemicourt, Rainneville, Halloy, château d’Hervare, Thiebronne, (15 avril – 1er juin – 171-176), Congis, Villers-les-Rigaud, la Tuilerie, Crouy-sur-Ourcq, château de Brunier, Montigny, Dammard, Mounes, Rassy, Remonvoisin, Sommelans, Grisolles, Rocourt, Lizy-sur-Ourcq (3 juin – 27 juillet – 177-184), Grandvillers, Sommereux, Andechy, Sept-Fours, Réthonvillers Nesle (28 juillet – 3 septembre – 185-187), Lavacquerie (3-26 septembre – 187-189), Pierrepont (Somme) Holnon, Saint-Quentin, Chardon Vert, bois des Cocotiers, ferme Monidée, Fieulaine, Sery-les-Mézières, Ribémont, Lucy, Guise, Froidestrées, Chigny, Malry, Le-Hérie-la-Viéville (27 septembre – 22 novembre – 190-202).
Yann Prouillet, CRID14-18, janvier 2012.
Cornet-Auquier, André (1887-1916)
Hector, Fréderic, Arthur, André Cornet-Auquier est né le 2 juillet 1887 à Nauroy dans l’Aisne, dans une famille protestante – son père est pasteur à Chalon-sur-Saône) dont il cultivera très tôt la foi. Il fait ses études au collège de Chalon et au lycée Ampère de Lyon, où il cultive le goût des arts, de la poésie, de la musique, du chant et des « grandes œuvres de Dieu » de la nature. Il fait des études supérieures à l’université de Dijon et devient professeur en Angleterre, à Glasgow. C’est à Colwyn-Bay au Pays de Galles que la guerre le rappelle en France, le 2 août 1914. Il a fait son service militaire à Dijon et est sous-lieutenant de réserve au 133e régiment d’infanterie de Belley (Ain). Passé capitaine, commandant de compagnie le 12 septembre 1914, il est mortellement blessé dans les Vosges et meurt à l’hôpital de Saint-Dié le 2 mars 1916 à l’âge de 28 ans. Il a été décoré de la croix de guerre et fait chevalier de la Légion d’Honneur.
2. Le témoignage
Cornet-Auquier, André, Un soldat sans peur et sans reproche. Pages dédiées aux jeunes, pour leur servir d’exemple en mémoire de André Cornet-Auquier, capitaine au 133e régiment d’infanterie. Chevalier de la Légion d’Honneur, décoré de la croix de guerre, mort pour la France à l’âge de 28 ans. Extraits de sa correspondance et discours prononcé par le Pasteur H. Gambier dans le Temple de Chalon-sur-Saône à l’occasion du service funèbre commémoratif. Chalon-sur-Saône, imprimerie Générale et Administrative, 1917, 61 pages. Seules les pages 23 à 61 reprennent les extraits de la correspondance de l’officier.
Après une présentation panégyrique familiale dans laquelle la grande piété du capitaine Cornet-Auquier est mise en avant, mais aussi un caractère boute-en-train, un long discours prononcé par le pasteur Gambier dans le temple de Chalon-sur-Saône lors d’un service commémoratif qui s’est tenu le 16 mars 1916, est reproduit. Il glorifie, comme les témoignages succincts qui suivent, une « âme d’élite », pieuse et dévouée.
André Cornet-Auquier, sous-lieutenant au 133e RI, arrive en Alsace le 23 août 1914, quelques jours avant la retraite de la bataille des frontières qui le fixe dans le département des Vosges, au Ban-de-Sapt. Il passera lieutenant, puis capitaine, commandant la 1ère compagnie, et participera avec succès, en 1re ligne, aux affaires de Metzeral (15 juin 1915) et de la Fontenelle (8 juillet 1915) au cours desquels il côtoie sans égratignure la mort, donnant au lecteur, et peut-être à lui-même, un sentiment d’invulnérabilité. Blessé par éclat d’obus au ventre à Denipaire dans la nuit du 29 février au 1er mars 1916, son transport à Saint-Dié n’empêchera pas la mort du héros le lendemain.
3. Résumé et analyse
Les extraits les plus significatifs de ses lettres de guerre permettent de suivre pas à pas l’officier et de voir avec ses yeux la réalité des situations et des tableaux qu’il vit. Courtes ou plus disertes, il n’omet pas d’abord de rassurer sa famille avant de narrer ses combats avec un patriotisme exacerbé et une véritable haine de l’ennemi. Ainsi, dans une lettre datée du 27 octobre 1915, il déclare : « …malgré la forme humaine, ce ne sont pas des hommes qu’on a devant soi » (page 54).
Profondément pieux, il transparaît dans les extraits de la correspondance du capitaine Cornet-Auquier un mélange de piété et d’esprit de sacrifice exacerbé, faisant ainsi singulièrement passer dans son parcours militaire la guerre au second plan. Immédiatement, il teinte son témoignage du moralisme de sa culture ; ainsi, dès le 15 août, il fustige les cafetiers « saligauds qui font entrer nos hommes dans leurs établissements par des portes de derrière, pour les soûler » (page 21). Il constate, à son arrivée en Alsace, un histrionique sentiment francophile (page 22). Nommé commandant de compagnie, il dit son angoisse des fonctions de capitaine ; « la vie de tant d’hommes entre mes mains », à la fois sensible à la mort possible de ses hommes et « indifférent en présence de cadavres » (page 23). Il décrit d’ailleurs plus loin une affectivité décalée par la guerre : insensible à la vision de la décomposition, des blessures, des cadavres, de la mort, il l’est par « des récits émouvants, des paroles patriotiques, une action d’éclat, un élan de pitié » (page 26). Transcendé par la guerre, il dit de la tranchée qu’elle est une « cure contre la neurasthénie » (page 32), fait installer une piscine près de son poste de commandement (page 40) et a même des chats mascottes (page 41). Il est aussi transcendé par la victoire quand, le 16 juin 1915, « après la conquête de trois lignes de tranchées ennemies. Au moment où j’ai eu la sensation de la victoire, j’ai pleuré : la détente nerveuse » (page 43), trouve sa « crasse glorieuse » et les officiers prisonniers « arrogants à gifler » (page 45). Parfois plus prosaïque, il décrit le contenu des « petits paquets du soldat » (page 25), aime le côtoiement de femmes dorloteuses (page 28) ou les roses que lui envoie au front sa mère (page 40). Il souffre pourtant de cette carence affective : « rien, rien, rien pour le cœur » (page 56).
Mais l’ouvrage apparaît surtout sous un jour hagiographique, maladroit et hors de propos par ailleurs, et son intérêt documentaire devient alors trop ténu pour en faire un ouvrage de référence sur la guerre dans les Vosges. Certes, quelques descriptions et relations intéressantes permettent de le faire contribuer à l’étude de la Grande Guerre sur ce front et notamment à la vision de la bataille de juillet 1915 à la Fontenelle. Mais il convient de faire la part des comptes-rendus de gazette dont il se fait parfois rapporteur. Au final, outre quelques relations en rapport avec les évènements peu décrits par ailleurs de la guerre de tranchées dans les Vosges, peu d’enseignements sont à titrer des 40 pages d’extraits de lettres reproduites dans cette plaquette familiale et qui ne valent que par le front secondaire évoqué. Les correspondances incomplètes, et c’est par cela même que pêche cet ouvrage, d’André Cornet-Auquier présentent donc un intérêt documentaire limité. L’ouvrage, de présentation et de typographie médiocres, est illustré d’un portrait de l’officier.
Parcours géographique suivi par l’auteur (date) (page) :
Colwynbay (Angleterre) (3 août 1914) (21) – Chalon-sur-Saône (4 août) – Belley (6 – 15 août) – Alsace (23 août) – Vosges (4 septembre – 17 octobre) (23–25) – Ban-de-Sapt – Gemainfaing – la Fontenelle (17 octobre 1914 – 14 juin 1915) (25-41) – Metzeral (4 juin – 2 juillet) (42-47) – la Fontenelle – Denipaire (3 juillet 1915 – 29 février 1916) (47-61).
Liste des noms cités dans l’ouvrage (page) :
Lt-col Dayet (cdt du 133e RI) (26, sa mort, 34) – Defert, Farjat, Jacquier (29) – Barberot (cdt) (31-32-40-41, sa mort 45, 47) – Defert (ss-lt) (36) – Cornier (cpt) (39-43-45) – Guillemin (lt) (45) – Joffre (50) – Réjol Maurice (ss-lt) (sa mort, 51) – Paulus André (ss-lt) (51).
Yann Prouillet, CRID 14-18, janvier 2012
Une notice Cornet-Auquier figure dans le Témoins de Jean Norton Cru, p. 507-509.
Pousse, Adelphe (1878–1921)
1. Le témoin
Adelphe Pousse est né le 24 février 1878 à Le Mée dans l’Eure-et-Loir. Il a fait ses études au séminaire de Saint-Cheron (Eure-et-Loir), où il entre en octobre 1891, et son service militaire dans l’infanterie en 1901-1902. Il est ordonné prêtre à son retour, en 1902 et chargé de la paroisse de Flacey (Eure-et-Loir) jusqu’en 1911, avant d’être nommé curé de Villiers-le-Morhier, petite commune de Beauce, dans le département d’Eure-et-Loir. A la mobilisation générale, il a 36 ans et il doit rejoindre la 4e section d’infirmiers du groupe de brancardiers divisionnaires (GBD) de la 85e division territoriale qui comprend les 25e, 26e, 27e et 28e RIT et rejoint Le Mans. Devant l’inaction de son emploi au front, il est affecté sur sa demande au 27e RIT le 20 mars 1915 et devient infirmier, sans formation apparemment, le 1er août suivant. En raison des pertes, il change d’unité le 28 novembre 1915 et est affecté comme soldat à la 17e compagnie du 209e RI d’Agen, affection combattante qu’il ne conservera que 90 jours pour être renommé infirmier dans cette compagnie. Ce n’est qu’au sortir des premières lignes de l’enfer de Verdun, le 16 juin 1916, qu’il pourra exercer les fonctions complémentaires d’aumônier. En effet, « le commandement de la deuxième armée française, en charge de la défense, compte aussi sur l’influence des prêtres pour maintenir le plus haut possible les capacités de résistance des troupes défendant la cité » (page 13) selon Jean-Pierre Verney, préfacier. Epuisé par un âge incompatible avec « sa » guerre, il est évacué le 18 juillet 1918 et stoppe son journal le 23 août suivant, de son lit d’hôpital pour un grave problème aux yeux. C’est affaibli qu’il rentre à Villiers-le-Morhier en mars 1919. Nommé curé de Champhol (Eure-et-Loir) au mois de novembre suivant, il y meurt le 17 mai 1921.
Pousse, Adelphe, Une soutane sous la mitraille. Carnets de la Grande Guerre d’un curé de campagne. Adelphe Pousse (1878-1921). Jaignes, La Chasse au Snark, 2000, 203 pages.
Le préfacier nous informe en exergue que le texte publié a été « réécrit par l’abbé Pousse, au retour de l’hôpital militaire, d’après le carnet qu’il a tenu » (page 18) du début d’août 1914 au 23 août 1918. Ses premières lignes sont : « J’étais bien loin de penser, en août 1914, quand à Sin-le-Noble près de Douai, sur la table d’un estaminet, devant une chope de bière, je commençai à écrire le récit des événements dont je devais être le témoin durant la guerre que, pendant 47 mois, je les noterai fidèlement au jour le jour » (page 19). Adelphe Pousse quitte ainsi Villiers-le-Morhier « plein d’enthousiasme » (page 19) pour le G.B.D. Singulièrement tenu loin du front, dans la région de Rouen, il ne sait rien des jours tragiques d’août et de septembre 1914. Ainsi, il ne connaîtra le baptême du feu que le 26 septembre dans le secteur de Bapaume. Le 20 mars de l’année suivante, il est affecté sur sa demande à l’aumônerie militaire du 1er bataillon du 27e RIT Il est nommé infirmier le 1er août. Là, son apprentissage de la tranchée est douloureux et mélancolique.
Le 28 novembre 1915, les classes 1889 et 1888 passent dans la réserve de l’armée d’active. Adelphe Pousse est contre toute attente versé à la 17e compagnie du 209e RI Sa situation administrative est en opposition avec la loi de 1905 qui lui arroge, en sa qualité de prêtre, le droit d’être intégré dans une formation sanitaire de l’armée. Cette situation ne sera que provisoire puisqu’il réintègre le 27e RIT, 18e compagnie, trois mois plus tard.
Milieu mars 1916, le régiment quitte le Nord pour la région de Verdun. Adelphe Pousse échoue au terrible réduit d’Avocourt, sur la rive droite de la Meuse. « A partir de ce moment, son écriture s’enfle et prend de l’ampleur » (page 11). Il y connaît les bombardements incessants, la boue, les poux, des épreuves terribles pour l’homme de foi. Le 16 juin 1916, il est nommé infirmier- aumônier au fort de Regret mais la mort de l’aumônier de l’ouvrage de Froideterre va lui laisser la place le samedi 21 juillet. Dès lors, une vie nouvelle, près des hommes, s’ouvre au martyr. Elle sera sa dernière affectation car les murs de Froideterre vont se révéler une prison, sûre certes mais insalubre, saturée d’une atmosphère délétère. Là, son corps va s’essouffler puis s’épuiser lentement et le 18 juillet 1918, il est évacué vers l’arrière. Il arrive à l’hôpital temporaire 63 de Lyon le 25 juillet et termine la guerre sans revoir le front.
3. Résumé et analyse
Cet ouvrage présente le carnet de guerre atypique et remarquable d’un prêtre ballotté dans la guerre. Affecté à un groupe de brancardiers divisionnaires, il est tenu singulièrement éloigné des batailles d’août-septembre 1914 qui menacent Paris et la Marne et qui saignent pourtant à blanc les armées belligérantes. Son récit en prend la teinte d’une balade touristique commentée. Octobre ne lui trouve toujours pas d’activité combattante utile pour sa charge de brancardier ou son ministère religieux. Il souffre de cet éloignement : « n’ayant aucun journal, nous ne connaissons absolument rien » du front (page 37) et quand il lit les récits de son calvaire, c’est pour éreinter quelque peu la version « enjolivée » d’un article sur la prise de Vaux ou Douaumont dans la « Revue des Deux Mondes » du 1er décembre 1917 (page 159). 1915 aligne les jours monotones dans la tranchée et seule une affectation dans un régiment de réserve génère en lui un moment d’énervement qui ne trouble pas l’ennui qu’il connaît aux tranchées. 1916 sera pour lui l’année de la révélation, qui voit son affectation comme aumônier-prêtre au fort de Regret. Il nous offre dès lors un témoignage remarquable relatant la vie quotidienne dans les forts et ouvrages de la citadelle de Verdun et notamment celui de Froideterre. Vision rehaussée de très belles descriptions panoramiques du front à plusieurs époques de la bataille de Verdun. Il complète sa vision extérieure par une excellente et dantesque vision relatant la vie quotidienne dans les forts et ouvrages de la citadelle verdunoise.
Pousse, volontiers chercheur de solitude, dévoile ses états d’âme, dit son dégoût pour les embusqués, pour le confort des officiers, les parlementaires gueulards et s’épanche sur sa vie de reclus. Seules les lettres reçues sont sa bouée de sauvetage dans cet océan d’enfer (page 74). Comme souvent chez les autres soldats, Adelphe Pousse reste muet sur ses permissions comme il n’évoque pas non plus les mutineries de 1917. Il évoque seulement le refus d’une poignée de main à un commandant par des hommes mutés (page 169) sans que cet évènement soit rattachable à ce paradigme. Il écrit dans un style souvent parlé, peu fouillé, par phrases hachées, économes. Il témoigne ainsi excellemment comme un journaliste de la foi.
De très nombreux éléments référentiels sont à retirer de ce témoignage dans le cadre d’une étude des prêtres engagés dans la Grande Guerre mais surtout de la vision et de la vie dans les forts de Verdun. Ainsi, on trouve un bref rappel sur les territoriaux (page 7), sur le service de santé (page 8) et la levée par l’église des sanctions pour les prêtres soldats qui portent les armes et font couler le sang (page 9). Pousse décrit un Nord aux filles « précoces », aux femmes replètes (page 22), où « les enfants fument de bonne heure » (page 42), où les gens parlent un « patois incompréhensible » et où il fustige l’insalubrité générale (page 45). Il en profite pour faire du tourisme minier (page 22), braconne le corbeau (page 40) et relate le sauvetage par le génie de soldats englués dans une boue (page 42) qui avale les souliers des hommes (page 47). Il relate l’abattage par les soldats français d’un poilu se rendant aux Allemands (pages 54 et 55) mais aussi les blessés suppliant l’achèvement (page 81), une confusion des uniformes français et allemands et l’horreur du champ de bataille (pages 82 et 132). Car il participe à l’horrible tâche d’identification, notamment de territoriaux du 106ème R.A.T. surpris et assassinés par les Allemands au cours d’une avancée (page 83). Plus loin, il est révulsé par l’insalubrité du réduit d’Avocourt à cause de la souillure des cadavres et des déjections (page 91). D’ailleurs, le fort de Regret sera consigné suite à un cas de méningite cérébro-spinale (page 131). Proche du service sanitaire et de la mort, il relate le suicide au mousqueton d’un sapeur (page 108), remarque le signalement des tombes par une bouteille (page 51) et l’absence de cercueil dans les inhumations (page 55) quand elle est possible (cf. page 174 quand il décrit une collecte d’ossements). Il déplore le gaspillage récurrent constaté dans les usines bombardées, où le matériel n’a pas été sauvegardé (page 68). Peu empreint de bourrage de crâne, son témoignage relate toutefois le cas singulier d’une maison occupée à la fois par des Allemands et des Français, à des étages différents (pages 69 et 75). Bien entendu, prêtre, il éreinte à plusieurs reprises l’amoralité du soldat, ses chansons dégoûtantes ; « comme si on ne pourrait être soldat sans dire des cochonneries » (page 70). Il s’inquiète en effet du délitement moral du poilu (page 171) et, s’appliquant cette crainte à lui-même, se demande après-guerre : « A quoi serons-nous bons quand nous rentrerons chez nous ? » (page 170). Paradoxalement, il rapporte qu’un soldat a écourté sa permission de 24 heures car « il s’ennuyait chez lui ! » (page 177). Témoin de l’anecdote et du quotidien, il note qu’à Bar-le-Duc, des gosses viennent vendre du café aux permissionnaires (page 98), il s’émeut de la mort du chat mascotte du fort de Regret (page 102), il voit des prisonniers allemands coupant les blés à proximité des forts (page 108), des artilleurs à barbe jaune du fait de la manipulation de la dynamite (page 118) mais l’horreur est permanente et revient, lancinante, dans son récit, telle sa relation du dégagement de Thiaumont, dont l’intérieur n’est qu’une bouille humaine (page 143).
L’ouvrage est introduit par Jean-Pierre Verney qui expose en préface le résumé du parcours du « curé de campagne » Adelphe Pousse. Ce préambule lui permet de replacer opportunément son parcours dans l’arme territoriale, dans le service de santé de 1914 et selon ses caractéristiques d’homme d’Eglise. Ce préambule posé, Jean-Pierre Verney laisse la place à un témoignage dense, exceptionnel, mais fâcheusement servi par une présentation minimaliste, de trop nombreuses coquilles, notamment dans la toponymie, non vérifiée par le présentateur, qui s’ajoutent à une qualité d’édition médiocre. On note le manque, dans le texte original, de plusieurs pages du récit, correspondantes au mois d’août 1917 mais la qualité du témoignage justifiait cette parution malgré cette lacune dans le récit d’Adelphe Pousse ; la question de l’opportunité de publier un texte non intégral s’en trouve toutefois résolue. L’ouvrage est peu illustré et présente une carte de l’ensemble fortifié de Verdun.
Index des localités, dates (et pages) du parcours suivi par l’auteur :
1914 : Villiers-le-Morhier, le Mans, 8 août (19), le Mans, Palaiseau, Choisy-le-Roi, Wissous, Montdidier, Peronne, Cambrai, Douai, 14-18 août (20-21), Sin-le-Noble, 19 août (21), Sin-le-Noble, Cambrai, 22 août (22), Marquion, 25 août (24), Fontaine-Notre-Dame, Vis-en-Artois, 27 août (25), Hénin-sur-Cojeul, Beaumetz-lès-Loges, 27 août (25), Doullens, Frohen-le-Grand, Abbeville, 26 août (26), Bray-lès-Mareuil, Picquigny, Perrières, Bovelle, Pissy, Fluy, Quévauvillers, Sainte-Segrée, Poix, 30 août (27), Courcelles, Saint-Valery-sur-Vielle, Beaufresene, Ronchois, Morcy, Saint-Martin, 4 septembre (28), la Table de Pierre, Rouen, Darnétal, Boos, 4-11 septembre (28), la Seine, Igoville, Grainville, Frileuse, Nogent-le-Sec, 13 septembre (29), Amécourt, Puiseux-en-Bray, 14 septembre (30), Saint-Aubin, la-Chapelle-aux-Pots, Hodenc-en-Bray, la Place, Milly-en-Thérain, Courroy, 14 septembre (29), Beauvais, Crevecœur, Crocq, Saint-Fuscien, Juvignies, Rougemaison, Bonneuil, Gouy-lès-Groseillers, 16 septembre (30), Longeau, Camon, Aubigny, Cagny, 19-20 septembre (30), Saint-Gratien, 22 septembre (31), Achiet-le-Petit, Achiet-le-Grand, 25 septembre (32), Bapaume, Miraumont, Beaucourt, Serres, 27 septembre, (33), Hébuterne, ferme de Beauregard, Puisieux, 27 septembre-3 octobre (34), Bucquoy, Essart-lès-Bucquoy, Hannescamps, Bienvillers-au-Bois, Pommier, 3-9 octobre (36), Humbercamps, Gaudiempré 9-22 octobre (37), Mondicourt, Grenat, Saulty, Barly, Hauteville, Lattre, Hermainville, Aubigny-en-Artois, Mingoval, Villers-Chatel, Savy-Berlette, 24 octobre (38), Caucourt, Estrées-Cauchy, novembre-décembre (39), Mesnil-Boucher, château de la Haye, Gouy-Servins, Mingoval, 19 décembre (42).
1915 : Bois de Bouvigny, Notre-Dame de Lorette, 10 mars (47), Estrées-Cauchy, 15 mars (47), Mareuil, 20 mars (48), Saint-Aubin, Anzin, Ecurie, Etrun, café de Madagascar, 14 avril (49), Roclincourt, Sainte-Catherine, 21 avril-2 mai (50), Duisans, Agnez-lès-Duisans, Montenscourt, Wanquetin, Basseux, Beaumetz-lès-Loges, Bavincourt, Bellécourt, 3-17 mai (54), Beaumetz-lès-Loges, Doullens, 18 mai-8 juin (55), Agny, 9 juin-4 juillet (55), Wanquetin, 5 juillet (57), Arras, Achicourt, Ronville, 5 juillet-28 octobre (58-65), Agny 29 octobre-29 novembre (65-67), Sain-Laurent-Blangy, 30 novembre-31 décembre (74).
1916 à 1918 : Blangy, Warlus, janvier-février (75), Humeroeuil, 5 février (76), Saint-Pol, Romillys-sur-Seine, Bar-sur-Aube, Pont-Saint-Vincent, Méréville, Burthécourt, 10 mars (79), Saint-Nicolas-de-Port, Dombasle-sur-Meurthe 10-22 mars (80), Tréveray, Nantois, Longueaux, 22-29 mars (81), Dombasle-en-Argonne, réduit, bois d’Avocourt, bois de Fé près de Brabant-en-Argonne (cantonnement) 29 mars – 16 juin (81), Verdun, Fort de Regret, ouvrage de Froideterre, 17 juin 1916-18 juillet 1918 (95-187), Belrupt, Bevaux, Souilly, Bar-le-Duc, Dijon, Saint-Jean-de-Losne, Chalon-sur-Saône, Lyon, 18-29 juillet (187-190).
Yann Prouillet, CRID 14-18, janvier 2012
Schlund, Pierre (1890–1984)
Pierre Schlund est né le 8 février 1890 à Buhl dans le Haut-Rhin, de parents, industriels alsaciens d’origine bretonne, ayant une usine à Guebwiller et farouchement francophiles. D’un milieu bourgeois – il fréquente Bartholdi, des militaires français et de grands industriels – il fait ses études primaires au collège de la ville, ainsi qu’à Metz afin de préparer un avenir destiné à « l’industrie textile et plus particulièrement à la construction de machines pour cette industrie » (page 17). Etudiant, il poursuit ses études en Angleterre mais doit avant cela accomplir son service militaire. Il choisit de se porter volontaire dans l’armée du Kayser afin de n’accomplir qu’un an, au lieu de trois, et, bachelier dispose du choix de son unité ; il intègre le 113e régiment d’infanterie badois de Fribourg et est inscrit d’office au peloton des officiers de réserve. Bon soldat, il est même gratifié du titre de tireur d’élite de sa compagnie mais, Alsacien, fiché, il ne peut dépasser le grade de sergent. Son temps effectué, il est renvoyé à la vie civile à l’automne 1912. Ayant achevé des stages dans l’industrie alsacienne, il poursuit son cursus à Bradford en Angleterre et obtient son diplôme d’ingénieur. En juillet 1914, après un voyage d’études auprès des industries linières d’Ulster, dans une Irlande du Nord elle-même en pleine tourmente, il revient en Alsace alors que les bruits de guerre se font plus précis.
Après-guerre, Pierre Schlund épouse à Aubenas Marie-Louise Gendre, le 8 septembre 1921, avec laquelle il aura cinq enfants. Il décède en mars 1984 à Morschwiller-le-Bas où il s’était retiré après une vie militaire et industrielle particulièrement bien remplie.
Schlund, Pierre, Souvenirs d’un Alsacien, 1914-18 – 1939-45, Montréal, Mille-et-une-vies, 2011, 257 pages.
Mandé par son père de ne pas rentrer en Alsace et de se constituer « prisonnier des Français » avant même la déclaration de guerre, il décide à la mobilisation de rejoindre sa caserne allemande pour y faire ce qu’il qualifie être « son devoir ». Le 28 juillet 1914, il est incorporé au 170e IR d’Offenburg et entre en guerre en Alsace, à Mulhouse. Là, le 10 août, au premier engagement avec les troupes françaises, près d’Illzach, il met son plan à exécution et déserte à la première occasion. Il se rend alors aux premiers soldats français rencontrés qui ne sont autres que ceux du 35ème R.I., le régiment commandé par son cousin, le chef d’escadrons Leyrault. Débute alors l’incroyable parcours de guerre d’un Alsacien, déserteur assumé qui va successivement au cours de la campagne occuper les fonction d’infirmier à Roanne, participer à la mise sur pied du camp d’Alsaciens-Lorrains de Saint-Rambert-sur-Loire, être interprète, intégrer le dépôt du 6e RAC puis enfin pouvoir se porter volontaire dans l’armée française, au 1er zouaves d’Alger. Il y apprend à être un soldat français mais, grâce à un piston au 2e bureau, il parvient à être affecté, au printemps 1918, à une unité spéciale appelée le « Centre d’Interrogatoire Spécial des prisonniers de guerre (C.I.S.). Par l’infiltration des groupes de prisonniers, dans les hôpitaux ou les camps au plus près du front, en uniformes allemands, que ce centre improvise, il parvient à collecter de multiples renseignements auprès des prisonniers de guerre allemands, gagnant leur confiance en se faisant passer pour un des leurs. Obtenant ainsi des renseignements de première importance, il y gagne ses galons de sous-lieutenant et une citation, et collabore ainsi de manière singulière à la victoire. L’Armistice survenu, après une courte mission d’interrogatoire des prisonniers français de retour d’Allemagne, il se voit confier une mission au Service Industriel d’Alsace, avec la mission notamment de faire rapatrier le matériel industriel volé par l’ancien occupant en France. A la fin de 1919, il quitte enfin l’uniforme et se voit confier la direction de la cuivrerie Vogt &.Cie, à Niederbruck, dans la vallée de Masevaux.
La suite de ses souvenirs rapporte cet entre-deux-guerres industriel, les affres de l’autre guerre, sous le joug nazi, dans laquelle Pierre Schlund parvient à conserver une activité manufacturière continue en pays annexé puis, après la victoire, son action prépondérante dans la reprise industrielle et l’occupation économique d’une Allemagne vaincue, divisée par les quatre grands vainqueurs.
3. Résumé et analyse
Les souvenirs de Pierre Schlund sont ceux, plus rares, d’un alsacien issu d’une famille industrielle francophile, voire française : « mon père, désireux d’annihiler chez moi l’influence allemande, ne cessa de m’inculquer la nostalgie de la patrie perdue » (pages 15-16). Il fait toutefois son service militaire allemand avec le souhait assumé de s’ « instruire au mieux dans l’art militaire avec la secrète arrière-pensée que cet acquis pourrait bien, qui sait ?, (…) servir plus tard du bon côté » (page 23). C’est le 6 août 1914, lors d’une revue par le général Deimling, qui ordonne « Chargez vos fusils ! Nous entrons en pays ennemi » qu’il confirme son dessein d’avant-guerre : « Je compris ce qu’il me restait à faire ! » (page 31). Il prend donc la décision, mûrement réfléchie malgré des risques multiples, de déserter, ce qu’il fait au premier engagement.
Le témoignage de Pierre Schlund est ainsi en cela le contre témoignage de Dominique Richert (in Cahiers d’un survivant. Un soldat dans l’Europe en guerre. 1914-1918. Strasbourg, La Nuée Bleue, 1994) qui ne parvint à ce même dessein qu’en juillet 1918, après avoir passé la quasi-totalité de sa campagne sur le front russe et ayant subi cet exil du fait d’un trop grand nombre de désertion des soldats alsaciens, dont Schlund, au début de la campagne. Hélas le témoignage de Pierre Schlund, bien que d’un parcours de guerre considérablement plus riche et diversifié que Richert, ne s’érige pas au niveau du plébéien dans l’intérêt narratif et descriptif. En effet, à plusieurs reprises, Schlund, qui regroupe ses souvenirs sur une période allant de 1896 à 1947, occulte les phases d’intérêt de son parcours de guerre par de trop nombreux et inappropriés « il serait trop long de s’étendre ici sur… » (page 70) ou telles situations « mériteraient d’être relaté[e]s » (page 90). Dès lors, son rôle en captivité à Saint-Ramber, son apprentissage d’ancien sous-officier allemand comme soldat français, ses informations sur le Service industriel de récupération économique et surtout son emploi singulier au sein d’une C.I.S. sur laquelle peu de choses ont été écrites par ailleurs ne sont pas malheureusement pas décrits au-delà de l’anecdote. Ses souvenirs sont également peu datés, nuisant ainsi à la précision du suivi du parcours du témoin.
Plusieurs éléments d’intérêt sont toutefois présents dans l’ouvrage tels : les conditions de réalisation du service militaire allemand pour un Alsacien (page 21), l’implantation et l’usage de la TSF avant-guerre (page 25), la séparation obligatoire des prisonniers allemands et alsaciens en camp (page 40) et le fait qu’ils aient été vêtus d’uniformes bleus de la police anglaise (page 48), l’affaire des graves altercations avec les prisonniers chinois à Fraisses (près de Saint-Ramber) faisant de nombreux morts dont 17 Chinois (page 49), la répartition des 12 000 prisonniers alsaciens à Saint-Ramber : la moitié « était répartie dans divers détachements dans toute la métropole et l’autre moitié servait au front et dans les colonies d’Extrême-Orient – sans oublier tous les mobilisés dans les usines de guerre » (page 51), le « Centre d’Interrogatoire Spécial des prisonniers de guerre » (C.I.S.), son étendue et ses méthodes (pages 70, 74 et 75) et le fait que les prisonniers allemands ne discutent pas près des clôtures barbelées, réputées être munies de micros (page 79).
Ecrits en 1974, ces souvenirs sont rédigés pour le lecteur (page 73) et agrémentés pour la partie deuxième guerre mondiale, du carnet de la sœur du témoin, Marie-Odile Schlund. Quelques très rares erreurs de retranscription (Saint-Blaise-la-Roche (Bas-Rhin) est confondu avec Saint-Blaise, hameau de Moyenmoutier, (Vosges), page 44) sont compensées de notes opportunes rendant la présentation de qualité. L’ouvrage est illustré de nombreuses photographies de famille d’une qualité de reproduction hélas très médiocre.
Yann Prouillet, CRID 14-18, janvier 2012
Clergeau, René (1886-1920)
René-Louis-Paul Clergeau, né le 20 octobre 1886 à Sainte-Lheurine en Charente Inférieure, aujourd’hui Charente Maritime. Il est issu d’une famille d’instituteurs. Son père, Adolphe, et sa mère, Louise berthe Lebrun exerçant tous deux cette profession, comme lui-même. La guerre déclarée, il est affecté au 206e RI de Saintes, régiment dans lequel il est chargé du ravitaillement. Le 8 août 1911, il épouse à Saintes Augusta Lacan, elle même institutrice (puis professeure d’anglais, de français et de mathématique, et qui s’éteindra le 2 avril 1977), avec laquelle il a un fils né le 6 avril 1918. René Clergeau décède le 9 mars 1920 des suites des gazages reçus en 1918.
Clergeau, René, Les cahiers de René Clergeau, 1914-1919. La Grande Guerre au jour le jour… Villebois, La Plume du Temps, collection Histoire, 2002, 337 p.
René Clergeau, instituteur charentais affecté au 206e RI et chargé du ravitaillement, a reproduit dans 6 carnets de guerre, écrits au crayon de papier, parfois en style télégraphique, de format 110×170 mm, qu’il appelle affectueusement ses « chers petits compagnons », sa campagne contre l’Allemagne, du 12 août 1914 au 24 février 1919. Il dit dans l’introduction de ceux-ci : « Ce carnet est pour ma femme, pour mon fils, pour moi si je reviens » et nous renseigne sur sa volonté de transmettre : « J’ai donc écrit au jour le jour, tout simplement les évènements survenus durant la campagne, soit dans mon régiment, soit à moi personnellement. Je ne cherche pas à faire le plus petit étalage sensationnel de faits plus ou moins authentiques n’ayant qu’un but, celui de donner un semblant de valeur à leur acteur. (…) D’ailleurs, je ne fais point un roman mais un simple recueil qui devra aider pour ma mémoire dans l’avenir » (page 8).
Principalement affecté en Lorraine, il subit de plein fouet la bataille de Verdun dans le secteur d’Avocourt et renforce parfois d’autres secteurs en ébullition, notamment au cours de la deuxième bataille de la Marne. Caporal puis caporal-fourrier, il traverse toute la guerre sans aucune blessure – sauf une égratignure de ronce et une grippe espagnole peu active – mais il décède toutefois des suites des gazages de 1918.
3. Résumé et analyse
Formidable document d’une continuité et d’un intérêt descriptif remarquables. Instituteur, son esprit est vif et clair et sa plume, parfois sans concession. René Clergeau nous donne à lire un carnet de guerre référentiel dans la littérature testimoniale. De nombreux éléments peuvent être dégagés de son étude et sa longue affectation en Lorraine, ainsi que la vision du choc de Verdun sont autant de tableaux d’intérêt. Tout y est ; description du front, organisation du régiment, noms de lieux et de personnes, le texte ne manque pas d’informations utiles à l’Historien même si les notes s’espacent pour l’année 1918, étant regroupées mensuellement par le scripteur. Certes, René Clergeau se fait promoteur d’un certain bourrage de crâne dans les premières pages mais il ajuste ses tableaux au fil du temps et livre parfois ses sentiments, vindicatifs contre la presse ou l’arrière. Sa vision, même sommaire, des mutineries est également d’intérêt mais il est singulier de constater le laconisme du 11 novembre 1918 où René Clergeau ne semble faire montre d’aucun sentiment particulier à cette date pourtant mémorable. Cette note révèle l’attrait d’une étude psychologique pouvant être effectuée sur ce témoignage. Est-il un héros du front ? Le témoin se décrit comme un « poilu de derrière la tranchée » type de combattant auquel il rend hommage (page 160). Mais non combattant, il n’est pas un « non souffrant » et, à Culmont, le 16 février 1916, il déclare : « Mes yeux sont encore malades mais cette fois ce sont seulement les paupières, intérieurement. Si je dis cela à ma chère femme, elle va s’inquiéter et je sais d’avance quelle fâcheuse répercussion cela produirait sur sa santé, la sachant impressionnable et prête à s’alarmer. Me faire voir au major, c’est me faire évacuer, ma femme l’apprendra et se frappera encore bien plus. Evacué, je peux suivre un traitement court et rester dans la zone des armées, je pourrais revenir à mon régiment mais si le traitement est long et qu’on me fasse filer dans un hôpital de l’intérieur, c’est ensuite le dépôt et le départ pour un régiment quelconque où je ne connaîtrais personne. Tout cela m’ennuie bien et cependant je ne peux écrire cela à ma chère femme, je préfère lui mentir un peu plutôt que de l’inquiéter » (page 128). Ainsi sont résumés plusieurs raisons répondant aux questions de l’autocensure et du pourquoi ils ont tenus.
Certes il rapporte au début de la campagne qu’ « on a vu dans leurs tranchées, des hommes debout morts, se soutenant mutuellement tellement ils sont nombreux » (page 12), il souscrit à une espionnite qu’il voit durable (pages 14, 30, 96, 123 et 244), constate l’inexplosion des obus allemands, n’explosant pas dans une proportion de 20/50 (pages 12, 49 et 67) ou rapporte les ruses allemandes (pages 23 et 69), comme les puits volontairement empoisonnés par les Allemands avec leurs propres cadavres (page 40). Il dit rencontrer d’ailleurs deux agents secrets et recueillir leurs confidences (page 42). Il rapporte la lecture de l’ordre Stenger d’assassiner les prisonniers français le 20 décembre 1914, à Champenoux (page 43) ou les martyrologes, tel celui de l’instituteur d’Hoéville, revenu de captivité le 22 février 1915 (page 53). Il rapporte également des combats au corps à corps épiques et sanglants mais surréalistes, venant d’un non-combattant, et bien entendu, « les Allemands ont employé dit-on » des balles explosives et dum-dum (page 70).
Il n’est pas tendre dans son appréciation de la population locale Meurthe-et-Mosellane, qu’il trouve grossière et sale, en un tableau peu reluisant (pages 22 et 23) et décrira de même plus loin les Auvergnats ! (page 57). Son tableau d’après bataille de la récupération du matériel abandonné, souillé est intéressante (page 24) et il confirme l’utilisation du vin en remplacement d’une eau insalubre (page 26). Il renseigne à plusieurs reprises sur les pratiques mortuaires (pages 26 et 32). Il décrit l’engagement d’un enfant de troupe (page 34 mais aussi pages 78 et 99 pour savoir ce qu’il est devenu). Le 10 mars 1915, il voit des condors qu’il prend pour des Taube (page 57) ! Il rencontre également des soldats devenus fous (pages 69 ou 188) et évoque un tir ami sur un homme perdu et tué (page 100). Il évoque également des déserteurs (page 127) mais fait aussi un éloge des soldats sobres (les Martiniquais) (page 187) ! A Verdun, le 8 septembre 1916, il rapporte horrifié une attaque de Sénégalais décapiteurs « sans s’occuper d’autre chose que leur zigouillage » (page 197) qui lui fait hiérarchiser l’horreur : « la guerre du fusil est terrible, le pilonnage de l’artillerie est épouvantable mais ce massacre au couteau, ce travail de boucher est monstrueux. Quelle affreuse chose que ce corps à corps au couteau ! Non, ce n’est plus la guerre, c’est… je ne peux pas le dire » (page 198).
Côtoyant plus souvent que le poilu la gent féminine, il voit à Velaine-sous-Amance quelques jeunes filles « malades », terme militaire pour syphilitiques, et qui « trouvent quand même quelques imbéciles pour s’occuper d’elles » (page 75). Comme pour la population, la vue de ces adolescentes enceintes, ces filles malpropres, aux sales mœurs (pages 82 et 84) voire dépravées et malades (page 165) apparaît récurrente. Il évoque aussi les « légitimes » telle cette veuve deux fois ayant épousé deux frères morts successivement (page 238) ou ces femmes (dont la sienne) rejoignant presque simultanément leur mari en cantonnement parisien de repos (page 242). Il parle aussi des occupées, évoquant les relations consenties de femmes avec l’occupant allemand à Berlencourt (page 255) et a même un mot sur les femmes belges (page 264) pour lesquelles il a plus de dilection.
Comme beaucoup, il se prononce parfois sur la durée prévue de la guerre ; ainsi Clergeau pense au 22 novembre 1915 que la guerre ne peut matériellement durer plus de 2 ans (page 112).
Soldat de l’arrière, il avoue avoir acheté « pour 20 sous, une belle fusée de 130 en cuivre et une bague de 105 » pour faire faire un coupe-papier en artisanat de tranchée (page 114) dont il évoque les dangers (pages 180 et 181). Il parle de la guerre psychologique, arguant que des cadavres allemands sont laissés sciemment sur le terrain pour démoraliser l’ennemi (page 136). De sa durée aussi, criant son amertume quant au sentiment du peuple envers le soldat le 1er avril 1917 (page 176), contre les journalistes quand ils évoquent le moral du poilu à cette période (page 194 ) ou contre ceux de l’arrière « que la guerre ne touche pas » (page 222). Les mutineries sont proches, et les mouvements collectifs qu’il décrit au théâtre aux armées du camp de Bois l’Evêque, près de Toul, où la Marseillaise est sifflée en présence des officiers supérieurs, ne sont pas équivoques (page 230). Dans ce camp, il précise que la mutinerie du 17 juin 1917 est partie d’un non-paiement du prêt par les officiers de peur s’enivrement des hommes (page 231). Il n’y prend pas part et précise que « tout cela est noté sans commentaire » (page 231) mais il constate les cas, y compris des trains aux portes arrachées par les permissionnaires (page 235).
A Hoéville, le 22 février il relate l’affaire de l’évasion et de la re-capture au front d’un prisonnier de guerre allemand en bleu horizon (page 212). Devant un « essai de vaccin », il suppute le poilu cobaye médical (page 217). Il peste contre les Américains et les Anglais, plus au café qu’au front (pages 244 et 257), évoque les effets physiologiques de l’ypérite (page 262) ou l’omniprésence du gaz à Esnes, qui gâte jusqu’aux vivres (page 269). Enfin sa vision de la cote 304 et du Mort-Homme en mars 1918 est impressionnante (page 269).
Il en ressort un ouvrage formidablement intéressant sur le plan du contenu mais souffrant d’une présentation médiocre, à l’instar de la reproduction iconographique, qui font leur cette observation d’Egger, historien de la littérature : « … car des milliers d’écrits nouveaux qui se publient chaque année, il n’y a jamais qu’un petit nombre d’œuvres qui méritent d’être distinguées par leur valeur scientifique ou littéraire, et celles-là ne trouvent pas toujours des éditeurs dignes d’elles » (in Egger, Emile, Histoire du livres depuis ses origines jusqu’à nos jours, Paris, Hetzel, ca. 1880, page 236).
Yann Prouillet, CRID14-18, décembre 2011