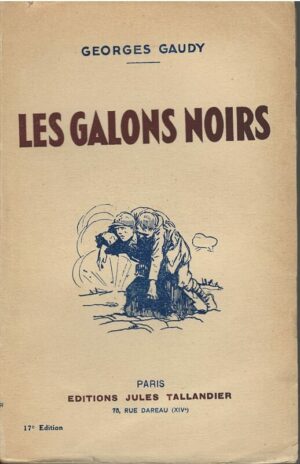Les Mémoires d’un poilu d’Aunis
1. Le témoin
Rémy Marchand vit dans une famille de cultivateurs à Boutrit, près de Surgères (Charente-Maritime) lorsqu’il est incorporé (classe 15) en septembre 1915 au 57e RI. Il part pour le front en février 1916 dans l’Aisne, est déployé à Verdun, dans la Somme, puis en Alsace et dans l’Oise. Blessé à Saconin (Aisne) en mai 1918, il revient en ligne en septembre, puis participe à l’offensive au sud de Saint Quentin. Après l’Armistice, il passe par Mulhouse puis participe à l’occupation en Allemagne.
2. Le témoignage
Les Mémoires d’un poilu d’Aunis – Un si long cauchemar, de Rémy Marchand, a été publié aux éditions L’Harmattan (2009, 239 pages). Sa fille Suzanne précise en introduction que son père avait ramené de la guerre des calepins de poche, et qu’il les avait retranscrits sur des cahiers verts les soirs d’hiver. Elle ajoute également qu’il avait rendu de nombreuses visites aux voisins des environs qui avaient perdu un proche à la guerre : « Rémy, si bon et compatissant, nous a aidés à faire le deuil de ceux que nous aimons » ont témoigné ces voisins.
3. Analyse
Ces mémoires d’un soldat paysan charentais, qui en fait sont plutôt des carnets, décrivent l’itinéraire d’un combattant de 1915 à 1918, il note les faits du quotidien, insistant davantage lorsqu’un incident vient briser la monotonie des jours. Il passe rapidement sur ses classes au camp de Souge, évoque sa joie d’endosser l’uniforme militaire (septembre 1915) puis l’ambiance festive et avinée lorsque son train s’ébranle vers le front (février 1916, p. 17) : « Vive le 57ème, vive l’armée ! ».
Rémy Marchand raconte son engagement à Verdun en mai 1916, il est en ligne devant le fort de Vaux, travaillant la nuit à relier entre eux des trous d’obus. Réfugié dans le fort pendant la journée, il insiste sur la violence du bombardement et surtout sur la soif. Il participe à un transport de 80 blessés brancardés dans l’obscurité de Vaux à Tavannes ; ils se perdent « dans la nuit noire », tombant constamment dans des trous d’obus, c’est pour lui l’épreuve la plus dure qu’il ait connue à Verdun. Peut-être y a-t-il ici l’influence de lectures postérieures, car il évoque le commandant Raynal organisant la défense du fort. Il émet aussi une appréciation positive sur sa hiérarchie (p. 36) : «Le colonel et le commandant avaient les larmes aux yeux en voyant les hommes tomber si nombreux.»
Après retrait et temps de repos, il est en ligne en Argonne au Four de Paris. Son régiment fait ensuite à l’automne 1916 (Marne) de nombreux exercices destinés à la formation des officiers (nouveautés tactiques, gaz, canon de 37 mm, p. 53) : « On nous fait faire beaucoup de chemin pour apprendre à nos officiers à commander. » En décembre 1916, les hommes du 57e alternent marches et repos autour de Paris, ils font plus de 250 km de marche, il dit n’avoir jamais su pourquoi. Une note ultérieure (p. 56 note 1) explique pourtant : « J’ai su depuis que nous étions dans la banlieue parisienne comme troupe de secours : on craignait une émeute dans la capitale. »
À partir de janvier 1917, il raconte qu’il a noué des relations avec des « pays » à l’arrière, ce qui lui permet de se faire connaître au train de combat comme capable de conduire les voitures et de soigner les chevaux. Pendant toute la guerre, il sera ainsi une sorte de « titulaire remplaçant », s’occupant des chevaux des officiers en permission, ou prenant temporairement la place de conducteurs absents, ce sont pour lui des postes recherchés car ils lui permettent d’éviter la 1ère ligne et les gardes (p. 75) : « Me voilà en selle sur la route, au milieu de la file de voitures, fouet en main, pipe aux dents. »
Il n’attaque pas avec son unité le 16 avril, étant en ligne en soutien, et fait sa première attaque le 5 mai devant Craonnelle ; c’est une action locale, ils font 14 prisonniers mais ont 18 tués à la compagnie. À l’été 1917, en Alsace devant Altkirch, il effectue divers remplacements (agent de liaison, ordonnance d’un capitaine), continuant à aller souvent visiter les conducteurs (p. 102) « pour avoir la possibilité de venir remplacer ceux qui partent en permission, ce qui m’évite à chaque fois 15 jours de tranchée. » Il apprécie l’Alsace, la vue sur Altkirch, surtout le dimanche où on aperçoit les civils aller à la messe sans qu’un coup de canon soit tiré, et il trouve les Alsaciennes très gentilles, tout en déplorant (p. 108) « qu’elles ne parlent pas beaucoup notre langue. »
En mars 1918, son unité est alertée pour aider les Anglais en repli à Noyon, il y décrit le pillage d’un dépôt anglais abandonné, le problème étant l’incompréhension des étiquettes des conserves : c’est lourd, et cela vaut il le coup ? Pour le rapport poids-valeur, ce sont les boîtes de 500 cigarettes qui étaient les plus intéressantes. Ils manquent d’être encerclés dans Noyon, puis il décrit les combats au Mont Renaud (57e RI, à croiser avec G. Gaudy), avec les attaques allemandes (trois charges d’infanterie en une journée), c’est très sanglant pour les assaillants, avec aussi des pertes sérieuses pour les défenseurs. Après un répit à l’arrière, il est affecté au fusil mitrailleur avec deux camarades (p. 147) : «Cela ne me sourit guère parce qu’en cas d’attaque, il est bien rare que l’équipe d’un fusil mitrailleur (…) ne soit pas atteinte. Cette arme étant redoutée de l’ennemi, on est plus tôt repéré que les autres camarades. » Il raconte une attaque allemande d’infanterie à découvert, avec lance-flamme, en intitulant son sous-chapitre « Une attaque vue de 100 mètres ». Les Allemands sont fusillés en masse, les porteurs de pétrole brûlent avec leur liquide, et les survivants refluent en désordre, on retrouve fréquemment à cette période (mars à mai 1918) le récit de ces assauts allemands compacts très meurtriers pour eux, une fois la ligne de résistance anglaise et française établie (p. 148) : « Si la distance à parcourir par l’ennemi avait été plus grande, nous avions le temps d’en abattre les trois quarts au moins. » Les pertes pour le 57e sont lourdes dans ce secteur de Noyon, et R. Marchand fini par être blessé légèrement de deux balles, à l’assaut de la ferme de Saconin le 30 mai 1918.
Soigné à l’ambulance, il est évacué à la Salpetrière à Paris, raconte la souffrance quotidienne du pansement, et est surtout préoccupé par son manque d’argent car il ne lui reste plus que 2 francs (p. 164) : « une pièce de quarante sous pour faire le garçon à Paris, c’est peu ! » En juin et juillet, il est en convalescence à Menton, il se promène beaucoup, décrit tout ce qu’il voit, et est autorisé à faire une promenade en Italie au-delà de la frontière : on est loin ici des proscriptions à la frontière pyrénéennes, à cause de la crainte des désertions.
Réintégré au 57e en septembre 1918, il retrouve un remplacement de cuistot et il se plaît dans cette fonction, c’est l’occasion de décrire une journée de travail à la roulante, avec les horaires, les préparations, les feux sous les différents contenants, ce sont deux pages (p. 197 et 198) très utiles pour voir comment fonctionne dans le détail une cuisine au front. Malheureusement pour lui, il doit quitter son filon fin octobre pour attaquer, car il est le plus jeune et célibataire. Il est «très ému : la perspective d’une attaque n’a rien de bien gai. » Il réussit à s’en sortir, mais dans son unité très touchée, le moral est mauvais et tout le monde a le cafard. En permission le 4 novembre, il apprend l’Armistice en Charente par les cloches, alors qu’il est à la chasse. À Mulhouse en décembre 1918, il décrit l’Alsace libérée, et la roulante est bien vue, car ils donnent les restes à « une foule de femmes et de gosses de la ville. » Pour l’aspect pittoresque du dimanche mulhousien, il explique dans une salle de danse le « faites passer la monnaie » du bal alsacien (p. 225) : « Chaque séance dure quelques minutes seulement. À mesure que la musique s’arrête, 5 ou 6 garçons de salle en livrée comme des laquais, ramènent tous les couples à la caisse au moyen d’une longue corde, qui ramène ainsi tout le monde. Chaque couple remet un billet pris à l’avance ou 0.25 fr. » Après une longue station dans le sud de l’Alsace, puis en Allemagne du Sud, il est démobilisé en septembre 1919.
Donc un récit assez factuel, souvent monotone, mais un tableau utile de Verdun ou de Noyon, et surtout de la guerre de mouvement à partir de mars 1918, avec le rôle central et meurtrier des mitrailleuses dans ces combats d’infanterie en mouvement. Intéressante et originale est aussi la description de la stratégie personnelle de l’auteur comme remplaçant conducteur, ordonnance ou cuistot, ce qui lui permet d’améliorer grandement son quotidien de poilu du rang.
Vincent Suard, septembre 2024