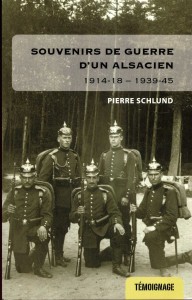Écrits de la Grande Guerre
1. Les témoins
Jean Well (1896-1917) et son frère Charles (1891) ont grandi dans une famille d’artisans ébénistes de Paris. Jean, classe 1916, est incorporé au camp de Mailly en 1915 au 156e RI. Passé au 35e RI en 1916, il est tué lors de l’offensive du 16 avril 1917. Charles a rejoint l’artillerie en 1912, il sera démobilisé en 1919 avec le grade de maréchal des logis. Michel Mantz, beau-frère des deux précédents, est infirmier en Serbie en 1915.
2. Les témoignages
Les éditions Le Lavoir Saint-Martin ont publié en 2014 « Jean, Charles et Michel, écrits de la Grande Guerre » (155 pages). Ce recueil de lettres et d’un extrait de journal est préfacé par Manon Pignot, et la mise en forme et l’introduction ont été réalisées par Frédéric Vassord, petit-neveu des frères Well.
3. Analyse
Ce petit volume présente un ensemble assez hétéroclite, avec quelques lettres et cartes postales, un fragment du journal de marche de 1915, et des documents officiels, ainsi que des lettres de camarades à l’occasion de la mort de Jean. Frédéric Vassord a eu la volonté, par fidélité mémorielle, de rassembler ces éléments épars.
Logique du corpus.
Les documents sont centralisés autour la grand-mère de F. Vassord, Marie Well, dite Gaby ; elle est mariée en 1917 à Prosper Mantz, qui travaille dans une usine d’aviation à Paris, et c’est à lui que sont adressées les lettres de Jean et Charles, frères de Gaby et amis de Prosper. La grand-mère a raconté la guerre et le deuil à son petit-fils à la fin des années 50, quand celui-ci avait une dizaine d’année. Il a été frappé enfant par le grand portrait de Jean, en pied et en uniforme, à côté du lit, dans la chambre de la grand-mère. Cette famille est française d’origine luxembourgeoise, et Prosper Mantz et son frère Michel ont encore la nationalité luxembourgeoise, ce qui leur avait semble-t-il permis d’éviter l’infanterie.
Jean Well (20 lettres) p. 27 à p. 95
C’est lui qui est le plus présent dans cette évocation ; il s’adresse à son ami Prosper, fiancé de sa sœur, et les quelques lettres permettent de formuler quatre remarques ;
– C’est d’abord un jeune (classe 16) très peu enthousiaste pour l’uniforme, il dit souffrir de son état de soldat (13 juin 1915, p. 30) : «J’en ai assez, ne le dit pas chez nous, mais fais le comprendre à ma chère soeurette, elle elle comprendra, elle verra que réellement si j’écris « chez nous ça va » c’est que je ne puis faire autrement. (…) mais au feu je n’y serai pas longtemps ; j’aurai vite fait de me faire évacuer, plutôt une balle dans le bras que de crever pour eux (…) chez nous jamais un mot je compte sur toi Jean
Ps Rencar à ba ta clan Jeudi je déserte Si c’était vrai
Avec cette lettre je ne signe pas, car des fois… + rien au père
Et une suggestion ajoutée : NDLR « calligraphie incontrôlée et inhabituelle, ne peut-on faire l’hypothèse d’un état d’ébriété ? »
– Il envoie de nombreux messages d’affection à sa sœur, il était très tendre avec elle, et celle-ci témoignera n’avoir jamais pu se faire à cette disparition.
– c’est une langue jeune et parisienne ; souvent les restitutions de dialogue en argot vieillissent mal et ont un caractère artificiel, mais ici la langue ouvrière du XXe arrondissement est fluide (p.39) : « [permission] J’irai pour quatre jours, et alors comme je veux arriver en lousdé, n’en cause pas. Tu peux le dire à Gaby en lui recommandant de ne pas l’ouvrir : tu lui diras que j’ai reçu le colis avec les chlapps ; enfin arrange toi pour ne pas qu’elle jaspine. »
– enfin on trouve pour le décès un ensemble classique de plusieurs lettres : un camarade explique qu’il faut garder espoir (« blessé légèrement »), un autre narre une mort paisible (« il s’est endormi pour ne pas se réveiller »), ou encore explique comment retrouver la tombe, ce qui prendra un certain temps après-guerre. En fait blessé grièvement le 16 avril par éclat au ventre, il meurt le 17 à l’ambulance.
Charles Well (3 lettres) p. 97 à 108
On peut mentionner, dans un de ses 3 courriers, que Charles, artilleur en s’adressant à ses parents, évoque son jeune frère (décembre 1914, p. 102) : «mon lieutenant m’a dit que sans doute la classe 16, celle à Jean, serait appeler dans quelques mois pour faire ses classes, mais, écoute bien maman, jamais cette classe n’irait à la guerre. Tu vois le môme Jean avait l’air de me dire que çà lui plairait assez cette vie là s’il avait été là tu parles d’une engueulade que je lui aurais servi ; c’est vrai lui et les autres ne peuvent pas savoir ; »
Michel Mantz (journal de marche), du 23 sept. au 11 nov. 1915, p. 116 à 140
On sait par une carte que Michel, le frère de Prosper, est infirmier en poste à l’hôpital de Zajétchar (Serbie) en mai 1915. L’essentiel du journal décrit à l’automne 1915 le retrait et la fuite devant la poussée autro-allemande, c’est-à-dire ici le retrait progressif du personnel et du matériel hospitalier vers le sud du pays et le Monténegro vers l’Albanie. Si le son du canon est omniprésent, le récit évoque d’abord un mouvement en assez bon ordre (mais les civils serbes souffrent bien davantage), la situation se dégradant dans la deuxième partie de la retraite (marches difficiles, faim) avec la pression bulgare qui précipite les menaces.
On peut évoquer le roi de Serbie (23 octobre, p. 128) : « j’ai vu le roi en automobile », mais il ne s’agit pas encore de la voiture du célèbre cliché de l’Illustration du 9 novembre, avec Pierre 1er dans un char tiré par 4 bœufs faméliques (Wiki « Le roi Pierre la tragédie serbe » [non libre de droits]). La direction de l’hôpital fait le projet d’abandonner les infirmières françaises, protégées par leur statut (p. 128, 23 octobre) « Le directeur nous dit qu’il nous faudra porter nos bagages sur le dos (…). Il dit à Jo, Marthe, Isabelle, Léontine et Clotilde qu’elle doivent rester et attendre les Allemands car il ne peut se charger d’elles. Elles me remettent des lettres pour leurs parents. (…) » Mais celles-ci ne l’ont pas entendu de cette oreille, car après une journée de marche, « je vois les 5 françaises que j’ai quitté hier, elles m’expliquent qu’aussitôt après notre départ elles ont été trouvé le commandant de la place et ont obtenu une voiture à bœufs ; elles ont marché toute la nuit. » Certains repos d’étapes sont parfois un peu plus longs et permettent une ébauche de tourisme, basé sur des connaissances anthropologiques assez sommaires : (1er nov. 1915, p. 134) « Le matin nous nous promenons dans la ville [Vouchiterm], nous voyons un pope en haut d’un minaret qui lève les bras au ciel et chante une prière, ensuite nous allons au hammam avec le pope, mais il nous faut nous déchausser et aussitôt entrer le turc met sa tête par terre et fait sa prière car nous sommes des impies qui pénétrons chez lui, nous nous sommes bien amusés. » Le journal prend fin le 11 novembre 1915 lorsqu’ils passent la frontière. Quelques documents évoquent ensuite l’hospitalisation de Michel Mantz dans l’Indre, probablement d’une maladie pulmonaire, dont il meurt en 1918 (pas de date certaine – récit de la grand-mère).
Donc un recueil modeste, mais qui montre qu’une fois réunies, ces bribes disparates peuvent produire, si fugace soient-elles, un témoignage très ponctuel mais pas vain.
Vincent Suard, février 2025