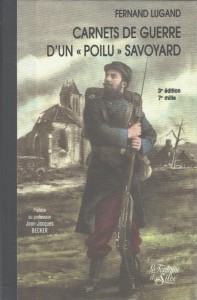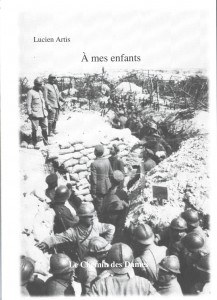1. le témoin
Jean Gabriel Castelain est né à Santes (Nord) en 1890. Il grandit à Haubourdin, un faubourg de Lille, dans une famille catholique très pratiquante. Il a deux frères et deux sœurs : Emile, religieux et brancardier, est blessé grièvement en 1914, et Paul, classe 17, fait la guerre au 8e BCP à partir de 1916. Une sœur meurt de la grippe espagnole en 1918. Gabriel adolescent suit l’enseignement du petit séminaire d’Haubourdin, qui accueille aussi des élèves sans vocation ecclésiastique. Il fait son service militaire de 1911 à juin 1914 (loi des trois ans) puis se marie avec Suzanne le 21 juin 1914. Mobilisé comme sergent au 110e Régiment d’infanterie de Dunkerque, il combat en Belgique, devant Reims, puis sur l’Aisne (Bois de la Miette – ferme du Choléra) à l’automne 1914. Transféré en Champagne en décembre 1914, il est tué lors de la première grande offensive devant le Mesnil-les-Hurlus le 18 février 1915. Il est enterré au cimetière du village, mais les lieux seront totalement bouleversés par la seconde offensive de septembre 1915 : en 1917, son jeune frère Paul ne parviendra pas à retrouver sa tombe.
2. le témoignage
Les carnets furent rendus à sa veuve par l’autorité militaire en 1919. L’association « La Mémoire de Ronchin » a publié en février 2016 un livret (68 pages, ISBN 802 750 778 00010) reproduisant le « Journal de guerre 1914/1915 de Jean Gabriel Castelain ». Cette publication est la copie fidèle des calepins rédigés au jour le jour au crayon, dans la tranchée ou à l’arrière. Une double page présente une photographie de deux pages des carnets originaux en regard de leur transcription et montre le souci de véracité de la reproduction, la seule modification étant des italiques non présentes dans l’original. L’iconographie a été ajoutée par l’association.
3. analyse
Le journal relate les faits de guerre, mais son originalité tient d’abord à ce qu’il traduit des sentiments, des émotions. La rédaction sert un propos intime, un dialogue avec soi-même qui semble aussi destiné à être montré à sa femme après la campagne : « A la pensée que petite Suze lira bientôt ces quelques pages, véritable roman d’un cauchemar vécu, je me sens vaillant, Dieu est là c’est tangible. » (p. 29).
Les combats
Le premier domaine est celui de l’affrontement avec les « alboches », qui ne deviennent les « boches » qu’en octobre. Lors de la bataille de Charleroi, le spectacle des réfugiés fuyant les combats provoque compassion et colère (27 août) : « Que c’est triste : une jeune femme, chassée de la frontière par les alboches, tient dans ses bras une petite mioche qui se meurt. Derrière elles suivent un moussaillon de sept ans et une petite fille de huit ans, ils sont perdus et ne savent où aller, la mère est en haillons (…) quels bandits que ces alboches ! » p.13. La bataille de Guise (29 août) est un traumatisme (« la journée la plus terrible de ma vie ») ; l’affrontement dure toute la journée : «L’officier que je venais de tuer devant moi d’un coup bien ajusté m’avait rendu tout drôle. Que c’est donc terrible. » p. 17. Après la retraite et le combat d’arrêt du 6 septembre, c’est le recul allemand et la description classique du champ de bataille de la Marne qui se découvre aux combattants : «Je suis témoin d’un spectacle horrible, des cadavres par dizaines sont étendus partout, dans les bois, dans les fossés, ruisselant de sang, des têtes déchiquetées, des ventres ouverts, je regardai cela sans trop de haut-le-cœur, la guerre vous endurcit son homme. » p. 21. La reprise de contact à Pontavert devant l’Aisne est violente et l’ennemi ne veut pas déloger : (27 octobre) «par ordre du général, le 110e va être cité à l’ordre du jour : nous avons perdu 1128 hommes du 15 septembre au 15 octobre. Horrible chose que la guerre ! » p. 42. A partir de novembre les considérations personnelles dominent, mais le combat revient par épisodes, 1er février 1915 : «le caporal de demi-section qui avait remplacé celui blessé vendredi dernier tombe, tué d’une balle ou d’un éclat d’obus au cœur. Il dit « je suis blessé » et tombe raide mort près de moi. La mort plane autour de nous à toute seconde depuis le début de la guerre. C’est une compagne terrible, cruelle, ignoble, qui veut de nous à chaque pas (…) Sales boches, il faudra payer un jour toutes vos infamies et vos atrocités. » La dernière description est un tir trop court de préparation de 75 en vue d’un assaut. C’est l’épisode le plus dramatique du recueil (12 février au Mesnil-les-Hurlus) « Ah ! je comprends maintenant quelle doit être la terreur de ceux d’en face pour ces engins effroyables ! (…) un obus ennemi a, paraît-il, coupé le téléphone ; notre capitaine fait lancer plus de 20 fusées rouges pour avertir, rien n’y fait, un brouillard nous sépare. (…) Ils me regardent de côté, les yeux hagards, en répétant, fous d’horreur et de terreur « trop court, Sergent, trop court. » (…) L’horrible tragédie se déroule toujours. J’ai fait depuis quelques minutes le sacrifice de ma vie. A mes voisins immédiats, je crie « c’est le moment de bien mourir mes enfants, pensons à Dieu.» Un mourant me répond « Ah ! Quel malheur, mon Dieu, quel malheur. » Il a 3 enfants. (…) Le capitaine est à l’entrée de la tranchée. Il a les yeux humides et hagards. Fou du spectacle que j’ai vu, je passe, en allant je ne sais où (…) le capitaine me fait brutalement « Ah ! Combien ? Castelain, combien ? » Mon Capitaine, j’ai marché sur tous, mais tous ne doivent pas être morts.» p. 64. L’épisode fait une quinzaine de tués à la demi-section (il y a neuf survivants).
La chère femme
G. Castelain, 24 ans, est très épris de son épouse, et n’a eu qu’un mois de vie maritale jusqu’à la mobilisation. Son journal est jalonné de témoignages d’affection pour « sa petite Suze ». Cette intimité est en permanence reliée à un patronage religieux, à l’évocation d’une protection divine. (6 octobre 1914, courrier) « Quelle confiance quelle résignation, j’ai pu lire entre les lignes ! Oh merci mon Dieu, c’est ce qui m’a fait le plus plaisir ! (…) Ma confiance est sans bornes. Dieu est avec nous. » p. 34. Les dimanches sont importants car les époux se retrouvent réunis dans la communauté de la prière (6 septembre) «Il est dimanche 6 heures « Suze prie pour son Gaby » quel réconfort ! » p. 21 ou « Là-bas ils sont en prières et nous ici assis au soleil sur les bords de l’Aisne paisible (…) nous unissons notre prière à celles ferventes de là-bas, le doux nid familial où il nous tarde toujours de rentrer ! Que c’est réconfortant mon Dieu cette union de prière ! » p. 34
Le déchirement de l’occupation
Le soldat nordiste en campagne prend aussi progressivement conscience de l’envahissement des deux tiers du département (chute de Lille le 12 octobre) : aux tracas du front s’ajoute bientôt une autre inquiétude : (17 octobre) «On parle de l’arrivée des boches près de Lille. Serait-ce possible ? » p. 39. Le journal illustre ce tourment, sans aucunes nouvelles des proches : (22 octobre) « Les nouvelles sur Haubourdin et Lille nous arrivent. Que Dieu nous aide dans cette grande épreuve. Plus de lettres, comme c’est dur aussi, puis l’incertitude. Que c’est angoissant ! » 23 octobre : «le bruit court que Lille a souffert de l’invasion. (…) Ah, combien dure est l’épreuve ! » p. 40. Des communications postales avec des proches à Armentières le rassurent un peu, mais en 1915 les rumeurs et l’absence totale de nouvelles minent le moral du sergent : (19 janvier 1915) «Un nouveau bruit court encore sur la libération de Lille. J’écris une carte à Haubourdin à ma bien-aimée petite femme dont le cœur doit souffrir tant et dont l’idée de cette souffrance me poursuit nuit et jour, augmentant mon chagrin. »
Un croyant au combat
Ce témoignage d’un fervent catholique, dont le frère aîné est rédemptoriste, relève d’une conception d’une religion protectrice : 17 août « Dieu me garde, la bonne Vierge et Saint-Joseph sont là. Courage. ». La foi permet de tenir (à Pontavert) : « Quel épouvantable spectacle que ces morts, que ces hurlements de blessés dans la nuit. (…). Quel réconfort aussi d’avoir la foi en ces horribles moments !… » Le terme «Fiat !» (résignation et résolution) scande les carnets et apporte un calme moral, « fiat donc et patience » p. 29. Les centres d’intérêt sont religieux (après la messe de Minuit à son frère) : « J’écris à Emile une lettre de 6 pages lui donnant les détails de la belle cérémonie. ».
Pour lui la guerre a ramené les soldats vers Dieu, il s’en réjouit : (2 octobre) «Il est bon de remarquer combien le revirement dans la foi est profond. Les sorties d’églises ressemblent maintenant à des sorties de cinéma et ces derniers sont fermés. Alors la constatation est bonne et cela me réjouit fort. C’est sans nul doute ce que Dieu veut à tout prix et il a employé de grands moyens terribles. » p. 33. Ce mouvement touche surtout des croyants auparavant discrets sur leurs convictions : «beaucoup de ceux que l’on ne voyait jamais parler de Dieu, n’ont plus peur maintenant d’afficher leur foi et la plupart ont leur chapelet en main.» p.49. Le retour vers l’autel ne semble toutefois pas général : (28 octobre) «Que Dieu nous aide, nous en avons tous besoin ! Ah ! Qu’ils sont donc malheureux ceux qui n’ont pas la foi ! J’en entends, malgré tout, blasphémer : les malheureux, ce n’est guère le moment ! » p. 42. Pas d’évocation de croisade, mais la seule évocation positive des Allemands détestés est celle de la Toussaint dans la tranchée (1er novembre) «on s’attend à une attaque et à voir surgir des têtes. Non, des chants latins d’une musique douce comme la nôtre, parfois dans les paroles. C’est la Toussaint. Ils ne l’oublient pas, eux au moins. » p.43.
L’auteur est persuadé d’être personnellement protégé, ce qui lui apporte un grand réconfort moral : 28 novembre «La meilleure preuve que je suis protégé miraculeusement, la voici : je viens à l’instant d’échapper à une mort certaine, une fois de plus parmi toutes les autres fois. Je causais tranquillement au Caporal Cavrois (…) une balle boche avec le dzz habituel vient lui traverser la main et écorner ma pipe (…) Pour moi, quelles actions de grâces, n’ai-je pas immédiatement fait monter au ciel ! » p. 51. Le raisonnement poussé à l’extrême déroute un peu le statisticien contemporain: (11 décembre) «Une simple constatation éloquente entre toutes. Je reste à la compagnie le seul sergent réserviste parmi ceux partis de Dunkerque. N’est-ce pas consolant pour moi et encourageant ? » p. 54.
Au total donc un témoignage intéressant sur « ceux de 14 », sur l’expérience nordiste du combat et sur le vécu intime des plus fervents des catholiques flamands français, comme l’illustre encore ce dernier extrait : (1er janvier 1915) « Heureux de se trouver encore vivants, nous nous présentons mutuellement les souhaits de bonne année. Triste journée, quand même où, malgré moi, je me sens bien chagrin. Par la pensée, j’envoie à ma bien-aimée petite Suze mes meilleurs vœux avec mes plus tendres baisers ainsi qu’à mes parents bien-aimés dont de si douloureuses épreuves me séparent. Dieu seul me reste encore présent en moi. Vers lui, montent mon chagrin et toutes mes pensées. Vers lui, je crie ma confiance inébranlable, ma foi au retour cette année sans nul doute. Oh ! Que le découragement viendrait donc vite si Dieu, la bonne Vierge et Saint-Joseph n’étaient là. Chaque jour, là-bas, l’on pense et l’on prie. »
Vincent Suard, juin 2016