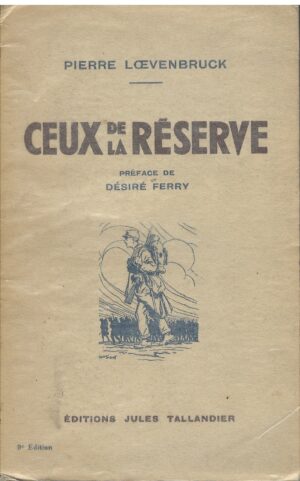Jacques Roujon, Carnet de route (août 1914 – janvier 1915), Paris, librairie Plon, 1916, 319 pages
Résumé de l’ouvrage :
Jacques Roujon, journaliste au Figaro, débute son carnet de guerre alors qu’il rejoint les réservistes de son régiment, le 152ème R.I., à Humes, au nord de Langres. Il y attend, jusqu’au 24 août, d’être affecté, soit dans le régiment d’active, soit dans celui de réserve, le 352ème. Soldat de 2ème classe, il fait partie finalement d’un contingent de renfort qui doit à priori rejoindre l’Alsace, où se trouvent les deux régiments, mais il débarque finalement à Raon-l’Etape, en pleine bataille des frontières, au moment où s’engage la bataille de La Chipotte. Il y participe, manque d’y être capturé et, soufflé par un obus, il est évacué dès le lendemain, montant à Rambervillers dans un train qui évacue les blessés, alors que « seulement » commotionné, il ne l’est finalement pas. Retapé, il revient à Humes avant d’être à nouveau réaffecté, cette fois-ci pour le 352ème (27ème puis 24ème compagnie), stationné au bord de l’Aisne. Il va dès lors occuper, d’après la bataille de La Marne jusqu’au 17 janvier, date de son évacuation pour maladie (hémoptysie), le secteur de Soissons. Il voit alors construire le front à l’ouest du Chemin des Dames, qu’il quitte au plus fort de la bataille de Crouy.
Eléments biographiques :
Jacques François Joseph Roujon est né le 30 octobre 1884 à Paris. Il est le fils de Henry, directeur des Beaux-Arts et membre de l’Académie française (1911), et de Marie Adeline Caroline Louise Reichel. Il fait de brillantes études à Paris, au lycée Janson de Sailly, et obtient deux licences, en droit et en lettres. Il fait son service militaire en 1905 et 1906 et exercera un temps comme avocat, de 1908 à 1910. Il demeure alors 1 rue Armand Gautier. Quand la guerre se déclenche, il est rédacteur au Sénat (depuis 1912 et jusqu’en 1919) et à la rubrique Affaires Etrangères (1920-1922) pour le Figaro, journal dans lequel il publie, en feuilleton, Carnet de route chez Plon en 1916, date à laquelle il revient au journal, manifestement réformé pour problème pulmonaire. Après 15 mois d’hôpital, il est réformé temporaire à partir du 15 janvier 1915 et jusqu’en 1916, il est versé dans le service auxiliaire en août 1916 et ne retournera jamais au front. Après la guerre, il occupe un temps un poste de secrétaire à la commission des chemins de fer de l’Etat, et est chargé de la rubrique Politique étrangère et participe à d’autres périodiques. Il rejoint ensuite plusieurs autres journaux (collaborateur au Temps, rédacteur en chef de l’Ami du Peuple puis au Matin (chef du service Etrangers 1935) – voir sa notice sur Wikipédia et son dossier de Légion d’Honneur sur la base Léonore). Une note de 1923 (dossier de Légion d’Honneur -chevalier 1927) atteste : « Spécialiste des plus avertis en matière de politique extérieure, s’est particulièrement distingué par le patriotisme ardent et la manière brillante avec lesquels il défend la thèse française depuis l’armistice ». Il verse dans le nationalisme puis le régime de Vichy pendant la Deuxième Guerre mondiale. La Libération lui fait quitter un temps la France. Il est alors condamné par contumace à 5 ans d’emprisonnement pour « acte de nature à nuire à la Défense Nationale », c’est-à-dire trahison, mais immédiatement amnistié en application de la loi d’Amnistie du 6 août 1953 (jugement sur la base Léonore). Il publie encore un ouvrage sur Le Duc de Saint-Simon en 1958. Il meurt à Randan (Puy-de-Dôme) le 22 septembre 1971.
Commentaire sur l’ouvrage :
L’ouvrage s’ouvre sur une préface de Robert de Flers, collègue au Figaro, qui érige le poilu en héros non déique ou mythologique. En effet, par sa qualité de journaliste, Jacques Roujon allie dans cet ouvrage la culture littéraire, le vocabulaire et le sens de l’observation qui font de son carnet de guerre une œuvre qui semble de prime abord avoir l’aspect du roman mais qui fait état de son parcours pendant les 5 mois de guerre, denses, qu’il subit, participant à deux phases différentes du conflit : la bataille des frontières à l’Est (combats de la Trouée de Charmes), en août, même s’il n’en voit que deux jours des plus intenses, et la bataille de l’Aisne, entre la bataille de La Marne et les combats de 1915. Dès lors, il manie dans son récit précision des circonstances, des lieux et de la datation. Toutefois, les 15 pages qu’il consacre à la journée du 25, après son débarquement à Raon-l’Etape, dans les Vosges, sont floues ; il est à Rambervillers le 24 et au matin du 25, il repars vers l’est, voit des crêtes et des collines, un clocher qui s’effondre, un village (non dénommé), des routes, des ponts (pages 31 à 46), mais un suivi plus prévis des tableaux qu’il dépeint avant sa commotion n’est pas possible, Roujon alignant des tableaux certainement vécus mais imprécis, quelque part au nord-est de Rambervillers, dans le secteur de Doncières. Il devient bien plus précis lors de sa deuxième affectation qui l’échoue principalement à Bucy-le-Long, au bord de l’Aisne. Ses tableaux sont toutefois vivants, bien décrits, parfois dantesques (comme son évacuation en train sanitaire, pages 47 à 50) et nombre des camarades de son environnement sont décrits de manière précise et dynamique. Si certains tableaux semblent frappants, comme ce soldat mourant debout (page 44), et quelques phrases du style « Il faut se dépêcher d’aller au feu, si l’on veut arriver avant les grands coups » (page 11) ou « Vivement qu’on nous envoie faire la guerre » (page 12), l’ouvrage n’est pas teinté de bourrage de crâne. Dès lors une foultitude d’éléments, de données, de tableaux ou de belles phrases sont à relever de l’analyse. Sa « période » axonaise est référentielle pour la description de la construction du front de l’Aisne, dans le secteur de Soissons, prolongement occidental du Chemin des Dames. Il y dépeint parfois un ennui profond : « Mais on s’ennuie, parce que la guerre d’aujourd’hui est terne, comme la couleur des uniformes » (page 139) ou « Au fond, rien ne ressemble plus à l’armée en temps de paix qu’en temps de guerre » (page 138), qui alterne avec des phases d’hyperviolence. Il est même un temps téléphoniste d’artillerie (page 156). À noter que Roujon, dans son récit, insère 10 pages du carnet de son ami Verrier, qui témoigne de la période du 1er au 17 septembre, complétant ce qu’a manqué Roujon (pages 92 à 101). Jean Norton Cru nous indique qu’en fait, Verrier est en fait Paul Verdier, chef de bureau au sous-secrétariat aux Beaux-Arts. Le doute introduit, il serait donc opportun de vérifier chacun des patronymes cités, y compris sur les morts annoncés. La notice de Roujon par Cru est lisible pages 237 à 239 de Témoins. Au final, malgré seulement cinq mois de guerre, Carnet de route de Jacques Roujon est bien un ouvrage référentiel.
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Mise à part pour le combat devant Rambervillers le 24 août, le suivi du parcours de l’auteur est aisé à la lecture ; il n’est donc pas repris dans la présente analyse.
Page 1 : Vue de la gare de l’Est le 11 août 1914
3 : Durée de la guerre (vap 24, 89, 116 et 260)
8 : Fumier et purin (vap 9, 10, 18, 58 et 107)
11 : « Il faut se dépêcher d’aller au feu, si l’on veut arriver avant les grands coups »
: Nom des journaux locaux haut-marnais : Le Petit Haut-Marnais et Le Spectateur
15 : Sachet de petits vivres : café, sucre, potages concentrés (vap 196 la revue, 8 jours par biscuit manquant dans la Légion)
19 : Vérification scrupuleuse du contenu du sac
26 : Fleurs au fusil et vue du départ de la colonne de Humes
29 : Exode des Vosgiens
31 : Vue d’une distribution « de café, de graisse, de pommes de terre et de haricots. Il faut démonter la gamelle, la remplir et la remonter sur le sac »
33 : Spectacle du bombardement : « Nous sommes très excités ; chacun voudrait regarder de tous les côtés à la fois, ravi de prendre part à une vraie bataille à si peu de frais. Personne n’a peur, personne ne prononce de mots héroïques. Rien que des interjections rapides » (vap 288)
34 : « Le clocher dégringole ; j’ai une impression de « chiqué » ; ce clocher devait être en carton pour s’être affaissé si vite »
: Met des fleurs dans son carnet de guerre
: Voit son premier blessé
: Bruit de la bataille : « Il semble que des mains invisibles tapent à grands coups de bâton une quantité considérable de tapis »
36 : Artilleur à cheval : « Il nous jette un regard doux et méprisant des cavaliers pour les fantassins » puis il dit, sur l’infériorité des canons français : « Les Allemands nous canardent à douze kilomètres. Ils tirent avec des 210. C’est très joli de faire la guerre, mais il faudrait avoir des joujoux pour ça »
43 : Balle dans sa musette
44 : Homme mourant debout
45 : Boîte de tisons
: « Un myope sans lunette a une psychologie de noyé »
56 : Le 3 août : « Je prends un vrai bain, dans une vraie baignoire. Sensation inouïe ! J’ai pris beaucoup de bains jadis, mais machinalement, sans y penser. Aujourd’hui, je savoure cette jouissance »
65 : Boîtes de conserve : langues, foies gras, jambonneaux, corned-beef appelées des Rimailhos à cause de leur calibre
67 : Garde de police de convoi, pour empêcher les soldats de sortir de la gare
69 : Vue de prisonnier allemand
74 : Nanteuil-le-Haudouin pillé par les Allemands
78 : Blessés allemands et français : « Pas de disputes, vainqueurs et vaincus son également las »
97 : Lanterne sourde
99 : Chevaux brûlés au pétrole
: Route jonchée de bouteilles cassées
104 : 19 septembre, première fois qu’il creuse une tranchée. Il dit « Il paraît que les Allemands en font et que c’est utile »
: Tableau épique du vaguemestre (vap 112 sur le courrier et 120 sur les colis)
108 : Traversée casse-gueule d’une champ de betterave
110 : Sculpte des animaux fantastiques dans des betteraves
118 : Fait des capuchons avec des sacs de pommes de terre
120 : Vue de Maxime Girard, du Figaro
125 : Sur le petit poste : « Prendre le petit poste, la nuit, dans un secteur inconnu, c’est une sensation neuve. Pour la première fois, on a l’impression de faire la guerre, la guerre telle qu’on l’imaginait, la guerre « des histoires »
128 : Fils de fer garnis avec des boîtes de conserve
132 : Soldat mort par accident de tir, vue de son enterrement
137 : Revue de cheveux
138 : Utilise « grande guerre ». Bulletin des Armées n’arrivant pas au front
149 : Fusil rendu inopérant par la boue
151 : Bruit du 155 allemand « qui semble le frou-frou d’une gigantesque robe de soie » (vap 214 : « Le sifflement des obus qui sont presque à bout de course rappelle le cri d’un chien hurlant à la lune ») et (vap 175, bruit de la fusillade : « bruit d’étoffe qu’on déchire, et n’arrête plus » ou 274 : « La fusillade, entendue à distance, ressemble au bruit que fait un chariot en roulant sur des pavés »)
152 : Tir organisé depuis le sol sur un avion
: Tombes d’anglais, mesures qu’il prend pour les orner
168 : Tayon et Ratayon, ancêtre dans le Soissonnais
187 : Balle arrêtée par un portefeuille
190 : Prix d’un paquet de tabac de cantine : 7,5 centimes
192 : Trantran pour traintrain
200 : Reçoit un « sac de couchage en toile cirée doublée de flanelle. C’est un événement qui compte dans la vie d’un soldat »
: « Tout le revers de la colline est envahi par des feuillées »
201 : Superstition d’un soldat qui dit : « Je sais bien que je serai tué »
204 : Aspect bigarré des soldats le 21 novembre 1914, air de romanichels (vap 205 et 225)
205 : Sur l’adaptation comme soldat : « Sous la fantaisie des accoutrements, nous restons des soldats. Nous le sommes tous devenus sans effort de volonté. L’adaptation aux misères du métier s’est faite insensiblement… »
211 : Soldat braconnier
212 : Description d’un contenu de sac et poids
216 : Grotte bergerie
217 : Poule tuée par un shrapnell
224 : « Une troupe qui ne sait pas faire du maniement d’armes, c’est un troupeau »
236 : Pose de Ribard
238 : « Pour s’abriter, on creuse de petites cases assez semblables à celles où l’on déposait les morts dans les catacombes »
: Sur le tirs inutiles : « Pendant la nuit, sur un secteur d’un kilomètre, il se tire en moyenne un millier de coups de fusil qui ne tuent ni ne blessent personne. Cette fusillade a simplement pour but d’empêcher des patrouilles de circuler entre les lignes » (vap 255 « La compagnie a brûlé trente mille cartouches environ et peut-être n’a-t-elle pas tué un seul Boche »)
240 : Tableau intéressant d’une visite médicale
244 : « Les heures de sommeil, c’est autant de pris sur la guerre »
246 : « Depuis quelques jours, nous reprenons goût aux caractères d’imprimerie. Qu’on nous envoie des livres, n’importe lesquels, pourvu qu’ils soient bons à tuer le temps. Tout ce qui sort un peu le pauvre soldat de la vie purement animale est le bienvenu »
247 : Rue bombardée jonchée de soufre
249 : Vue de soldats du train de combat
253 : Phare de tranchée
: Homme blessé criblé de balles des deux camps
Yann Prouillet, 30 août 2025
Le Roux, Hugues (1860-1925) – Le Roux, Robert (1887-1914)
Hugues Le Roux, Au champ d’honneur et Te souviens-tu…, Paris, Plon, 1916 et 1920, 297 et 289 pages
Résumé de l’ouvrage :
Hugues Le Roux, journaliste parisien ayant ses entrées dans les ministères, évoque l’entrée en guerre de son fils, Robert, sous-lieutenant au 356ème R.I. de Toul, dès le 1er août 1914, la mobilisation décidée. Par de courtes descriptions et l’appui de quelques lettres échangées entre son fils et sa fiancée, Hélène, il suit son parcourt et les premiers combats que le fils connaît dans la bataille des frontières et du Grand Couronné qui défend la ville de Nancy. Le 26 septembre, il reçoit un avis de blessure qui semble peu grave mais qui contient la mention d’une paralysie des jambes. Le père obtient l’autorisation de rejoindre son fils à l’hôpital Gama de Toul où, très gravement blessé, il est sur son lit de souffrance. Dès lors, l’ayant rejoint, il recueille les circonstances de sa blessure héroïque puis assiste à son agonie et à sa mort, qui survient le 18 octobre à 3 heures du matin. Il l’enterre alors dans un cimetière de la ville. Son second ouvrage, placé à la suite dans l’édition présentement étudié, est un hommage, Robert Le Roux étant le fil dans ses voyages divers, sur le front comme autour de la terre, entre novembre 1914 et juin 1919.
Eléments biographiques :
Robert Charles Henri Le Roux, est un journaliste parisien connu sous le pseudonyme d’Hugues Le Roux. Il est né le 23 novembre 1860 au Havre (Seine-Maritime), de Charles Clovis et de Henriette Gourgaud. Il collabore avec plusieurs grand journaux parisiens (Le Matin, Le Journal, Le Figaro ou Le Temps mais aussi la Revue politique et littéraire) et est également auteur de près d’une quarantaine d’ouvrages entre 1885 et 1920. Dans son dernier livre, Te souviens-tu…, il raconte d’ailleurs comment il trouve l’un de ceux-ci, Ô mon passé…, sur une étagère dans un local de la gare à Haparanda, en Suède. Grand voyageur, il dit, page 91 de Tu te souviens… « …le Celte que je suis ne se sent tout à fait chez lui qu’en mer ». Il a deux fils, Guy et Robert, et une fille, Marie-Rose, qui a 18 ans en 1914. Ceux-ci semblent avoir été miraculés lors d’une attaque de croup lorsqu’ils étaient jeunes. Avant la guerre, il a la douleur de perdre son épouse, puis son premier fils. Un paragraphe nous renseigne aussi sur le « poids » de la guerre sur toute la famille : « Dans le Midi, mon beau-frère, le professeur à la Faculté de chirurgie, est placé d’office à la tête d’un hôpital de la Croix-Rouge. Mon second beau-frère, le père de Charles, reprend son uniforme de médecin-major. Mes deux sœurs ont revêtu l’une et l’autre la robe de l’infirmière. Ma chère fille, Marie-Rose, ma nièce Alice, entrent comme assistantes dans des hôpitaux normands que leur tante administre en qualité de Présidente de l’Union des Femmes de France. Moi je suis accrédité auprès du Ministre de la Guerre. J’ai charge de recueillir à son cabinet et puis de commenter, ces nouvelles que, chaque jour, le Grand Quartier Général, assisté du Gouvernement, met au point vers minuit. À l’heure tardive où je viens chercher cette manne qui, demain, nourrira les cœurs d’espoir ou d’inquiétude, la porte du ministère est gardée comme un accès de forteresse » (pages 25 et 26). Il fait après-guerre une carrière politique, conseiller général puis sénateur (1920). Il meurt à son domicile, 58 rue de Vaugirard à Paris, le 14 novembre 1925. Au Champ d’honneur évoque la vie et la mort du dernier fils qui lui reste, Robert Charles Henri, né le 15 août 1887 à Sèvres, en Seine-et-Oise. Licencié es-sciences, il a fait des études d’ingénieur-chimiste dans une école du Luxembourg. Il parle plusieurs langues, ayant voyagé en Allemagne, où il passe une année, et en Angleterre. Peu avant la déclaration de guerre, il se fiance avec Hélène Aigner, jeune artiste-peintre, née en 1891, membre du Salon des artistes français depuis 1912, puis rejoint son corps à la mobilisation. Il dirige une section de la 19ème compagnie du 356ème R.I. de Toul, partie de la 145ème Brigade de la 73ème division du XXème Corps. L’ouvrage ne mentionne aucun toponyme précis mais le JMO précise les conditions des combats de Lironville, dans lesquels il est gravement blessé et un temps laissé paralysé sur le terrain avant d’être enfin relevé et envoyé à l’hôpital de Toul. Il meurt finalement le 18 octobre 1914.
Commentaire sur l’ouvrage :
L’ouvrage, composite, d’Hugues Le Roux, débute par une série de tableaux dont le premier se situe le 1er août 1914 à Paris. Le père indique la mobilisation de Robert, comme sous-lieutenant, en partance pour l’Est (Toul), puis son départ, dès le 2. Il s’adresse alors à lui, narre ses activités liées à l’écriture des communiqués pour son journal, avant de recevoir l’annonce des premiers morts de son entourage, qu’il cache à son fils, déjà au combat. A partir du 21 septembre (page 49) ; il publie des « fragments » de lettres échangés entre les deux promis, entre le 2 août et le 20 septembre 1914 (page 79). C’est dans cette partie de l’ouvrage que se trouvent des éléments utiles à l’étude du témoignage de Charles Le Roux. Sur sa mobilisation, et avant même son premier engagement, il fait ré-aiguiser son sabre mais dit « mes bonshommes sont ma meilleure arme » (page 57). Mobilisé dans un régiment de réserve, il dit : « Ne croyez pas qu’on nous juge inutilisables. Nous sommes prêts. On nous garde pour nous porter au point où nous serons le plus utiles quand aura lieu ce choc dans lequel nous vaincrons… » (page 58). Il tient au comportement irréprochable de ses hommes, réprime le pillage ou le simple vol, et dit : « Je suis très sévère sur ce point-là. Je veux qu’ils se comportent poliment » (page 62), (il y revient page 74, au grand étonnement même de propriétaires lorrains de fruits). Volontaire et patriote, il puise sa force dans l’amour de la Patrie et de sa fiancée ; le 30 août, il déclare : « Je me donnerai corps et âme pour mon pays et pour vous ; vous ne faites qu’un dans mon cœur. Mais lorsque j’aurai fait tout ce que je dois, je tâcherai de revenir » (page 67). Il avance même le 17 septembre, à l’endroit de l’ennemi : « Mais pour les rosser il va falloir les rattraper chez eux » (77). Ce avant qu’Hugues Le Roux reçoive lui-même la lettre terrible dans laquelle son fils annonce sa blessure. Il dit « Mon cher papa, j’ai : 1° le bras traversé, et ce n’est rien, 2° la poitrine traversée de droite à gauche, avec plaie à la moelle : c’est plus ennuyeux, car cela paralyse mes jambes… » (page 81). Dès lors, Hugues Le Roux, grâce à ses contacts avec les ministères, parvient à obtenir rapidement du Gouverneur de Paris, Joseph Galliéni en personne, l’autorisation de se rendre à Toul au chevet de son fils. Il le trouve gravement blessé mais ayant pleine conscience. Il recueille alors les circonstances dans lesquelles il a été blessé (sans toutefois en donner les précisions toponymiques). Hélène et sa mère le rejoignent pour voir une dernière fois le mourant, que le père assiste jusqu’à son dernier souffle, le 18 octobre, à 3 heures du matin. Ayant acheté un cercueil, il inhume son fils dans le cimetière de la ville puis rentre à Paris, dès le 20 octobre, devant une ultime réflexion sur la belle terre de France qui défile devant lui sur le chemin de son retour. Ayant perdu le dernier de ses fils, et donc sans descendance, l’ouvrage s’achève sur un éditorial et un projet de Loi, en juillet 1916, visant à faire perdurer le nom des morts dont la lignée s’éteint avec le dernier fils. Robert Le Roux fera, sur son lit de mort, ce constat désabusé : « Ma guerre, çà été une demi-heure et trois cents mètres » (page 158). Au final, l’ouvrage apparaît globalement double, ayant l’apparence d’un témoignage, composite car contenant des lettres échangées ou reçues, s’étalant du 1er août au 20 octobre 1914, mais qui en fait forme une biographie militaire sommaire et un recueil daté de réflexions, souvent poignantes, d’un père orphelin de ses fils. L’ouvrage rappelle, dans la démarche mémorielle, celui de Roger Allier, enquêtant sur la mort de son fils dans les Vosges, à Saint-Dié, à l’été 1914. Au Champ d’honneur, publié en 1916, est en fait le premier volet d’un diptyque à croiser avec le livre Te souviens-tu…, publié aux mêmes éditions quatre ans plus tard, deux ans plus tôt (1920). Ce second volume, prolongeant l’hommage à son fils, est quant à lui un livre de réflexion psychologique faisant état de ses voyages, multiples, autour du monde, entre novembre 1914 et la signature du traité de Versailles en juin 1919. Leur relation, localisée et datée, est prétexte à se souvenir de son fils et à penser qu’il l’accompagne dans chacune de ses stations. Il est en effet mandé, tout au long de la guerre, de parcourir les pays soit pour exercer une mission péri-diplomatique, soit pour faire acte de propagandisme, soit pour recueillir des fonds ; notamment pour la Croix Rouge, aux Etats-Unis. Il annonce avoir recueilli 10 millions de dollars dans cette action. Il dit, au Japon, en septembre 1915 : « On m’envoie ici, mon Enfant, pour que je m’efforce à lire dans l’âme indéchiffrable de nos Alliés, à deviner jusqu’où il leur plaira de collaborer avec nous » (page 100). C’est parfois l’occasion d’en décrire, par des tableaux simples, ambiance et caractéristiques, parfois anthropologiques. Il revient sur la mort de son fils et sur ce qui survient dans les 5 années qui suivent. Par exemple il dit recevoir, en mars 1916, un diplôme de chancellerie attestant de la blessure à mort de son fils dans les combats de Lironville (page 142) puis un autre, en 1918 ; en hommage de la Nation, dont il fait une poignante et sobre description (pages 237 à 242). Après son tour du monde, il effectue un court pèlerinage sur les terres lorraines, en 1916, parcourant les « Pays-de-Sans-Femmes » (page 150). Il visite un fort, monte en avion avec « Pivolo », surnom de l’as Georges Pelletier-Doisy (page 215), espérant avoir tué à la mitrailleuse des boches pris pour cible depuis le ciel. Aussi, la fin de son récit itinérant bascule parfois dans le bourrage de crâne et l’invraisemblance des témoignages par procuration. Mais de belles lignes psychologiques d’un père qui ne se remet pas de la mort de son fils peuvent être toutefois relevées.
Renseignements tirés de l’ouvrage Au Champ d’honneur :
Page 15 : Vue de la mobilisation à Paris
45 : « À cette heure, toutes lumières éteintes ou voilées, la lune triomphante fait de Paris un grand mausolée »
65 : Description de la chambre d’une enfant lorraine, concluant « … ce qui fait l’âme de Jeanne d’Arc… »
68 : Comment il fait matriculer ses effets et complète (p. 75) « …le propre de la guerre est de modifier les uniformes »
77 : Wigwam = tipi
: Pain grillé à la pointe de la baïonnette
103 : Sur les blessés graves : « Ils savent encore qu’ils vivent, parce qu’ils souffrent »
153 : Vue poignante de l’intérieur d’un ambulance
204 : L’autorité militaire de Toul autorise l’ouverture de magasins pendant quelques heures
205 : Fait un oreiller mortuaire en cousant deux mouchoirs bourrés de coton
212 : Cité à l’ordre de l’armée
254 : Colonel Dehay, commandant le 356ème R.I., décousant les rubans de ses croix pour les donner à Hugues Le Roux
272 : « On voit sur le pommeau [de son épée] de petites éraflures en cercle. C’est la marque des dents de sa fiancée. À Paris, au moment du départ, il lui a demandé de mordre dans cet acier. Elle y a laissé une trace que ses lèvres à lui ont effleurée bien des fois »
Renseignements tirés de l’ouvrage Te souviens-tu :
Parcours suivi dans l’ouvrage :
1915 : Dans l’Atlantique – New-York, mars – Harvard, avril – Potomac, mai – Washington, Far West, San Francisco, Océan Pacifique, août – Polynésie, septembre – Yokohama, septembre – Tokyo, octobre – Miyajima, Pékin, novembre – De Pékin à Petrograd, décembre 1915 – janvier 1916.
1916 : Haparanda, février – Paris, mars – Lorraine, Verdun, Montreuil-sur-Mer, avril – Paris, juin
1917 : Somme (à la N69), été – Camp de Mailly, octobre
1918 : A bord de La Lorraine, avril – Washington, West Virginia, mai – Paris, juin à novembre
1919 : Saint-Germain-en-Laye, 23 juin
Page 46 : Evoque en mars 1915 le torpillage du Lusitania (qui aura lieu le 7 mai suivant)
59 : « Et les morts sont bien morts quand nul ne parle d’eux » (Victor Hugo)
105 : Fait dire une messe à Tokyo le 18 octobre 1915
108 : « Si aujourd’hui, je suis venu dans ce temple rendre visite à ta mémoire, c’est que je souffre trop de ne plus te rencontrer nulle part »
128 : Soldat russe crachant par terre sur le passage de l’Impératrice en janvier 1916
132 : Perd des cadeaux dans le naufrage du paquebot Ville-de-la-Ciotat (le 24 décembre 1915)
138 : Il se questionne sur sa foi
142 : Mur-mausolée pour son fils dans son appartement parisien
218 : Nommé « Oncle de la 69 », N69 à l’été 1917
246 : Récolte d’argent jeté dans un drap aux Etats-Unis
277 : Comment il apprend l’Armistice à Paris
284 : Coup de canon Place du Carrousel à Paris pour la signature du 23 juin 1919
Yann Prouillet, 24 août 2025
Dieterlen, Jacques (1893-1959)
Dieterlen, Jacques, Le Bois le Prêtre (octobre 1914 – avril 1915), Hachette, collection Mémoires et récits de guerre, 1917, 280 pages
Résumé de l’ouvrage :
L’auteur, de manière impersonnelle, brosse de nombreux tableaux-hommages aux « Loups du Bois le Prêtre ». Après un panorama des lieux de mort, du Quart-en-Réserve à la Croix des Carmes, à l’ambulance du Gros Chêne et leurs cagnas de boue jaune ; il nous fait suivre la vie du front, faite de petits postes, de patrouilles, de guerre souterraine, d’attaques et de relèves. Dès lors, officiers et soldats de toutes armes, blessés et prisonniers, nous sont dépeints en situation dans leurs peines et leurs sacrifice, toujours héroïques, pour les magnifier.
Eléments biographiques :
Jacques Dieterlen naît à Cannes, dans les Alpes-Maritimes, le 28 novembre 1893, d’une famille d’origine alsacienne. Il est le fils de Christophe et de Suzanne Amélie Thierry. La guerre le surprend alors qu’il fait son service au 168ème R.I. de Toul, entré comme 2ème classe le 29 novembre 1913. Jean Norton Cru avance dans « Témoins » (page 292), relativement à sa présence au front, qu’elle fut courte. Il dit : « Parti comme caporal dès les premiers jours d’août 1914, la brigade active de Toul fut amenée au Bois le Prêtre, devant Pont-à-Mousson, sur la rive gauche de la Moselle. Elle y resta jusque vers le 2 juillet 1915. Mais déjà, avant cette date, Dieterlen, qui avait été promu sergent, avait été blessé et évacué. Sa blessure lui fit perdre le bras droit. À l’armistice, il retourna au pays natal de sa famille, se fixa à Strasbourg [il y habite 1 rue de la Douane] où il fit ses études de droit et s’occupa de presse et de littérature ». Plus précisément, il passe en effet caporal le 1er avril 1914 et sergent le 16 novembre suivant. Le 19 du même mois, il est affecté au 169ème RI, de Toul également, et est en effet, le 10 avril, blessé gravement au Bois le Prêtre par un éclat d’obus (ou une balle explosive en fonction des sources, notamment son dossier de Légion d’Honneur) qui lui fracture l’épaule droite, occasionnant sa désarticulation et son amputation. Il est cité à l’ordre de ce régiment le 20 avril 1915 avec ce motif : « Très belle conduite à la prise d’un petit poste ennemi, a montré une courageuse activité dans l’organisation de la position conquise », citation complétée le 26 août suivant avec le complément : « son lieutenant lui demandant si sa blessure était grave, a répondu « ce n’est rien si la section peut se maintenir dans la tranchée » ». Il est décoré de la croix de guerre, de la médaille militaire (le 15 septembre 1915) et de la Légion d’Honneur (15 septembre 1932). La guerre achevée, il épouse, le 30 août 1920, à Reims, Germaine Ida Madeleine Reiterhart, et s’installe en Alsace où il devient rédacteur en chef du Journal de Schlestadt (Sélestat). Ayant obtenu son baccalauréat en Droit à Strasbourg en juin 1921, il fera une carrière comme auteur de plusieurs ouvrages, mais également comme initiateur de deux revues ; une sur la navigation sur le Rhin et une sur le ski, dont il est un spécialiste. En 1946, il publie un roman, Honeck, chez Flammarion, dans une collection qu’il dirige chez cet éditeur, intitulée La Vie en montagne. Cette fiction, qui évoque les deux guerres mondiales, s’inspire pour la partie Grande Guerre de sa fonction de directeur, à partir de 1917, du Foyer du soldat du Collet, à proximité du col de la Schlucht, dans les Hautes Vosges. Henriette Mirabeau-Thorens Mirabaud-Thorens, Henriette (1881-1943) – Témoignages de 1914-1918) le rencontre et le décrit à plusieurs reprises dans son ouvrage. Le 9 septembre 1917, elle dit : « C’est le jeune Dieterlen qui dirige le Foyer du Soldat du Collet. Il a perdu un bras à la guerre. Il a parfois de la peine à tenir ses chasseurs, qui n’ont pas froid aux yeux : « Mais c’est grâce à ma manche vide que je leur en impose », nous dit-il. Il a écrit un livre admirable sur le Bois-le-Prêtre » (page 288 de En marge de la guerre). Elle en reparle (pages 301, 309 et 318), rapportant les anecdotes que raconte à l’envi Dieterlen sur son poste au Collet et sa vision des poilus. Sa famille dirigeant un hôtel, [c’est pour cela qu’il rencontre Henriette Mirabeau-Thorens, qui le cite dans ses livres], il se retire pendant la Deuxième Guerre mondiale à Gérardmer (Vosges) pour y administrer Le Grand Hôtel. Il est également connu comme artiste peintre et illustrateur. Il meurt dans cette ville le 24 novembre 1959.
Commentaire sur l’ouvrage :
Rien ne manque dans cette suite de longs alignements pénibles de tableaux romancés, animés d’homériques héros toujours tragiques, qui meurent tous d’une balle glorieusement reçue en pleine tête, et de boches barbares et pleutres dans le plus pur esprit du bourrage de crâne le plus grossier, ajoutant aux images d’Epinal pochées à l’invraisemblance l’honneur étalé et la souffrance jusqu’au sadisme. Ce livre surréaliste ne vaut que pour cette démonstration. Norton-Cru décrit parfaitement le sentiment de l’historien à la lecture de ce pensum : « Rien n’est plus navrant alors que de voir un combattant, un mutilé, s’exprimer dans le ton de ces artistes de bravoure qui déchainaient la fureur des poilus. Tout le livre de Dieterlen dépeint une bravoure exagérée ; livresque, non-humaine ; ses soldats sont des surhommes et ils s’expriment dans un style à scandaliser les vrais poilus » (page 293). Cela commence en effet dès la page 10, quand un soldat dit qu’il a aiguisé sa Rosalie ! La baïonnette est souvent citée, comme un instrument de prédilection qu’il associe à l’attaque du soldat, à « l’usage de cette fine petite aiguille d’acier qu’il faudra enfoncer dans des poitrines humaines, puis retirer, puis enfoncer à nouveau… » (page 240). Suivent des pages sirupeuses d’hommes « emportés par cette fièvre héroïque » (page 25), voire cette « ivresse héroïque » (page 114), d’horreur superfétatoire, comme ces morceaux de corps partout, servant d’indicateurs (page 32), cette fosse commune surréaliste en plein milieu de la tranchée (page 38), cette scène qui rappelle furieusement le Debout les Morts de Péricard quand Dieterlen décrit : « …on eut dit que les morts eux-mêmes se réveillaient à la vie pour prendre part à la lutte » (page 41) ou ces blessés affreusement mutilés se jouant de la douleur par des bons mots (page 195). Les soldats, surhommes mythologiques, sont héroïques, même sans arme, comme ce soldat du génie qui capture une mitrailleuse à l’aide d’une simple cisaille (page 114). Ces héros auxquels Dieterlen pense rendre hommage, il ne leur applique pourtant qu’outrance bien peu réaliste dans les conditions de la guerre, ce par des phrases comme « il n’y avait rien qu’il ne surmontât, il n’y avait pas de mitrailleuses qui pût l’empêcher » (page 176). Dans cette avalanche de morts, ne bénéficiant généralement que de très peu de respect, ceux-ci, français comme allemands, sont utilisés comme barrages (page 77), comme banc (page 91) ou comme parapet. Les têtes sont jetées hors de la tranchée (page 202) ou tel soldat s’endort sur le cadavre d’un ennemi (page 231). Par ses outrances sur ce point, Dieterlen méconnait la réalité de la mort au front et de son traitement, ami comme ennemi, surtout pour l’année 1915.
Ces multiples tableaux, le plus souvent mal écrit en termes de dialogues surréalistes qu’aucun poilu n’aurait tenu parce que verbalisant l’inutile à formuler, forment une superposition interminable de héros, les mettant parfois dans des situations stupides comme ce brancardier qui revient avec 10 baïonnettes des morts (page 170). L’allemand est bien entendu soit stupide, soit barbare. La tentative de négociation faite pour récupérer un blessé s’achève par l’achèvement ce celui-ci à la grenade (pages 186 à 189). Ainsi, le « Teuton », le « Fritz » ou le « Boche » ne peut être que mort ou prisonnier, mais Dieterlen avance même « Mais il ne fallait pas qu’il y en eût trop ! » (page 214), d’autant qu’amadoués et renseignés sur la réalité de la guerre ; « Dans la suite, ils devinrent moins naïfs et se rendaient plus facilement » (page 217). D’autres pleutres demandent même aux français d’assassiner leurs officiers (page 228). Quant aux bleus des classes 14 et 15, ils meurent insouciants et naïfs (page 198). Tout l’ouvrage n’est donc une longue suite de verbiage sans précision ni technicité, au-delà du moindre intérêt. À peine Dieterlen s’interroge-t-il sur le « syndrome du survivant » dans la grande boucherie, concluant pour toute analyse seulement que « la mort est lâche » ! (page 203). Dieterlen, qui dédie l’ouvrage « À la gloire de tous les Héros obscurs morts au Bois Le Prêtre. À toux ceux qui leur sont chers », s’essaye ainsi à rendre hommage aux différentes armes ; soldats et officiers, brancardiers, agents de liaison, hommes du génie (chapitre plus surréaliste encore d’inepties, d’insavoir et d’outrances), blessés et prisonniers, etc., mais avec une injustesse qui classe ce Le Bois le Prêtre dans l’un des pires ouvrages de la pourtant intéressante collection bleue des « mémoires et récits de guerre » d’Hachette. Enfin, au relevé des rares dates avancées dans le livre (voir infra), celui-ci n’étale de fait sa narration que sur une période, entre l’arrivée et la relève, au printemps 1915, soit entre la mi-mars et le 10 avril, alors qu’il avance en sous-titre la période Octobre 1914 – avril 1915. Cela correspond manifestement à la courte expérience qu’il a pourtant bien eu lui-même du Bois Le Prêtre.
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Eléments de datation relevés dans l’ouvrage
Page 14 : 2 avril 1915 (169ème R.I.)
25 et 27 septembre 1914 (combats de Mamey) (avant l’arrivée de la division)
142 : 10 avril 1915
159 : 31 mars 1915
190 : Une nuit d’hiver 1914
204 : Un matin de la fin mars 1915
218 : Le jour de Pâques 1915 (4 avril 1915)
224 : Un jour de l’hiver 1914-1915
233 : Premiers jours du printemps 1915 (rappel : printemps = 21 mars)
245 : Avril 1915
Relevé des toponymes cités dans l’ouvrage (page)
Mamey (2 à 5) – Fey-en-Haye (5, 14, 28, 80, 101, 225) – Régniéville-en-Haye (13) – Thiaucourt (13) – Vilcey-sur-Trey (14) – Hauts de Meuse (100) – Fontaine du Père Hilarion (133) – Auberge Saint-Pierre (134) – Route de Norroy (134) – Maidières (148) – Montauville (164, 192, 193, 269, 273, 277, 278) – Pont-à-Mousson (193) – Ravin des Cuisines (274, 277) – Poste de secours de Clos-Bois (275) – Croix des Carmes (277)
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Page 65 : Artisanat de tranchée
90 : Il tire sur un geai
92 : Coup de fusil ayant « le bruit d’un caillou jetée sur de la glace »
Yann Prouillet, 21 août 2025
Loevenbruck, Pierre (1891-1972)
Pierre Lœvenbruck, Ceux de la réserve, Paris, Tallandier, 1931, 223 pages
Résumé de l’ouvrage :
Pierre Lœvenbruck, lorrain de Pont-à-Mousson, est sergent à la 7ème compagnie du 69ème R.I. de Nancy et de Toul depuis deux ans déjà quand il commence son journal le 30 juillet 1914, alors qu’il rentre de manœuvres sur le Mont d’Amance, au nord de Nancy. Il y apprend la mobilisation prochaine de l’armée française et se demande s’il va l’être lui-même dans le régiment d’active (69ème). Affecté finalement à la 1ère section (puis à la 4ème) de la 23ème compagnie du 269ème RI, il décrit dès lors, à 23 heures le jour-même, la mise sur le pied de guerre de son unité, formée des réservistes meurthe-et-mosellans de toutes origines sociales. Il doit alors les habiller et les transformer en soldats avant que l’unité ne quitte les casernes pour les premiers combats. Suit une description, débutant dès la nuit, à la limite du surréalisme, d’une mise en état effective de guerre jusqu’à la marche à la frontière, vers le nord, le samedi 8 août. Rêvant d’entrer rapidement victorieux dans Metz, en Lorraine allemande, Lœvenbruck passe la frontière, le 19 août, à Ajoncourt, dont les poteaux ont été mis à terre et fait une courte incursion en territoire du Reich. La Seille est en effet bien vite repassée sans combats dès le 22, après un baptême du feu qui le met en face de la réalité de la guerre. Son premier mort, les visions d’exode des paysans lorrains, la canonnade, tout cela n’altère pas encore l’ « âme de conquérant » des réservistes. Pourtant, la défaite qui se joue en Moselle ramène la guerre devant Nancy. Débute alors la bataille du Grand Couronné qui va hacher le régiment au nord de la ville pour la protéger de l’invasion. Dès lors, le sergent évoque, dans le détail, les journées épiques autant que mortifères, jusqu’à la victoire, très temporaire, qui s’est jouée sur La Marne, le 17 septembre. Le 29, le régiment doit participer à la phase suivante de la guerre, qui l’amène devant Douai, dans le Nord, où se joue la Course à la mer. Les combats n’y sont pas moins violents, et le 3 octobre, peinant à réaliser la surprise de la situation, il est fait prisonnier à Billy-Montigny par un houzard du 7ème Kavallerie Korps. Son épopée s’arrête alors qu’il découvre l’inscription « Kriegsgefangenen Lager Parchim » sur la porte d’entrée du camp de prisonnier, qu’il franchit le 8 octobre 1914.
Eléments biographiques :
Marie, Joseph, Pierre Lœvenbruck, (parfois orthographié Lœwenbruck) est né le 2 avril 1891 à Pont-à-Mousson, en Meurthe-et-Moselle. Son père, Louis Henri, né à Thionville, est négociant et sa mère, Marie, Joseph, Claudine Noël est sans profession. Il a une sœur et un jeune frère, âgé de 13 ans quand il entre en guerre. Il obtient son baccalauréat général et débute son service militaire dans la foulée, en 1912. Fait rapidement prisonnier, il cumulera 7 années de services militaires et 9 années de services civils, dont trois ans et demi à l’étranger. Il racontera chez le même éditeur, également en 1931, son « expérience » de captivé dans un ouvrage intitulé Bouches inutiles, Quarante mois de captivité en Allemagne. Il épouse à Berne, en Suisse, Marie Antonia Kressig, le 6 février 1920. Outre une petite carrière littéraire, il exercera la fonction de Consul de France (de 2ème classe) en 1934, attaché à l’administration centrale, puis sera promu à la veille de la 2ème Guerre mondiale, en août 1939. Convaincu de « participer en France à une résistance active en dehors de ses tâches professionnelles » (cf. son dossier de Légion d’Honneur, Base Léonore), il est alors mis en sursis par le Gouvernement de Vichy (en mars 1942). La Libération intervenue, il est rétabli dans ses fonctions en mai 1944 et confirmé en décembre suivant puis nommé Consul Général (de 2ème classe) en avril 1945, « en reconnaissance des services rendus ». Il est fait chevalier de la Légion d’Honneur le 9 avril 1930 et officier le 14 août 1946. Il décède le 4 décembre 1972 à son domicile, 116 rue de la Convention, dans le 15ème arrondissement à Paris.
Commentaire sur l’ouvrage :
Désiré Ferry, président de l’Union nationale des Officiers de Réserve de France, introduit l’ouvrage en vantant les mérites d’un journal de guerre, genre loin d’avoir épuisé la curiosité des lecteurs, celui-ci issu de « ceux de la réserve », nous renseignant sur l’origine de ce carnet. Il dit : « Le réserviste prenait des notes selon sa fantaisie, au hasard des cantonnements. C’était tantôt un journal de route, tantôt un recueil d’impression. C’était pour lui-même, « quand il serait vieux », qu’il consignait ses souvenirs » (page IV). En effet, sous l’apparence d’un carnet de route qui couvre, quasi jour par jour, la période du 30 juillet au 8 octobre 1914, Ceux de la réserve est bien un livre de souvenirs. Mais ceux-ci, relatés simplement, et rapportant la vision exacte et bien décrite des grandes phases qui ont marqué sa courte expérience de guerre : La mobilisation et l’entrée en guerre d’un régiment de Réserve, la marche à la frontière (mosellane), la bataille du Grande Couronné, et la Course à la Mer. Pierre Lœvenbruck confirme cette architecture en la précisant : La mobilisation – La victoire en chantant – Le Grand-Couronné – Un secteur de tout repos – La course à la mer et À travers l’Allemagne. A l’échelle d’un régiment (le 69ème et son régiment de réserve, le 269ème), l’ouvrage revêt donc un indéniable intérêt local, montrant la mise en état de guerre des classes d’âge meurthe-et-mosellanes autour de Nancy et de Toul, Lœvenbruck étant né à Pont-à-Mousson et terminant son service militaire puisque depuis deux ans déjà sous l’uniforme. Il est sergent lorsque la guerre le surprend en pleine manœuvre autour de Nancy. Pour ses camarades et certainement pour lui également, le 30 juillet 1914, la guerre, d’abord, n’est pas possible. L’habillement en cours des civils transformés en militaires, le fourrier dit encore, le lendemain : « Je m’en fous. Je suis peinard, ici, où je dois assurer l’habillement des réservoirs pendant vingt-cinq jours. Aussi, la fête sera finie quand je serai en état de rejoindre » (page 18). Plus loin encore, le 4 août, il rapporte même : « … nous ne devons pas combattre mais simplement suivre – et de loin – les troupes de l’active dans leur avance en pays ennemi. D’ailleurs, attaqués par les Français d’un côté, par les Russes et les Serbes de l’autre, les Allemands ne tiendront pas longtemps ; c’est l’évidence même ! et dans six semaines, deux mois, nous reviendront à Nancy en vainqueurs » (pages 42 et 43). Le mythe de la guerre courte est tenace ; il tient encore, le 18 août, quand Lœvenbruck avance, alors qu’il découvre un numéro de l’Est Républicain, daté du 16 : « On y raconte des histoires admirables sur la famine qui menace l’Allemagne, sur le « mordant » de notre cavalerie (2ème édition) et le « cran » de nos chasseurs. Chacun sait que les autres troupes n’existent pas. Tout ce bourrage de crâne qui nous enchante, nous paraît naturel et il n’est pas un de nous qui ne soit persuadé que dans quinze jours, mettons trois semaines pour les plus exigeants, la guerre ne soit terminée » (page 74). Mythe qui existe d’ailleurs également chez les Allemands, qui le déclarent eux-aussi au prisonnier Lœvenbruck début octobre (page 208). Sur la famine allemande, il y reviendra après sa capture et sa « traversée de l’Allemagne » comme prisonnier, en glosant, le 3 octobre : « … quant à la famine qui, d’après nos journaux règne dans leurs rangs… je souhaiterais aux rédacteurs de ces articles de manger aussi bien qu’eux ! » (page 211). Lœvenbruck livre donc une particulière intéressante « vue de l’intérieur » de la réception de la mobilisation, de l’engagement en masse des réserves qu’il faut équiper de pied en cap et mettre en état de guerre, tant psychologique que, 22 jours plus tard, confronté à la violence d’une guerre qui révèle son vrai visage, abattant les fantasmes d’une victoire facile et rapide. Il en dresse un tableau impressionnant : « Près de la caserne A. R. [de Toul], les terrains de manœuvres, qui servaient naguère à l’artillerie, sont littéralement couverts de civils endormis : on y voit toutes les classes de la société, des bourgeois, des jeunes gens, des vieux, des ouvriers, des paysans en blouse, quelques prêtres en soutane, combien sont-ils qui attendent qu’on veuille les recevoir dans les casernes où il doivent être habillés ? Deux mille, trois mille peut-être, arrivés dans la nuit et que les postes de garde ont eu la cruauté de laisser dehors » (pages 34 et 35). L’ouvrage, qui n’est pas teinté de bourrage de crâne, – page 110, il dit à propos de l’espionnite : « je ne crois guère à ces histoire de roman-feuilleton » – rapporte ce qui fut une certaine réalité voulant que certains, affectés dans la réserve, virent dans cette affection un éloignement de la gloire. Il dit, lorsqu’il apprend, manifestement déçu et inquiet, son affectation effective : « Que sera le 269ème de réserve ? Un tas d’inconnus, de nouveau chefs, de nouveaux collègues et, pendant que nous ferons l’exercice dans un fort de Toul, le 69ème entrera dans Metz ou dans Strasbourg » (page 17) ! Dès les premières marches vers la frontière, Lœvenbruck s’épanche sur les difficultés que ses 22 ans éprouvent à se faire obéir d’une telle diversité sociale. Il dit : « Les débuts furent durs, très durs, pénibles pour tous, pour nos officiers comme pour nous, gradés de l’active ; pour ces hommes arrachés à leur famille, à leurs travaux, à leurs douces habitudes, le changement était trop brutal, la discipline depuis trop longtemps oubliée ; partis de chez eux en chantant, ils s’apercevaient soudain que la rigolade était finie ; que le sac était lourd, que la route était longue, que les godillots mal graissés les blessaient, tandis que l’équipement leur sciait les épaules, et, naturellement c’est nous qu’ils en rendaient responsables, et parmi nous ceux qui étaient le plus près d’eux, ces « sous-officiers » abhorrés et détestés… jusqu’au jour où, petit à petit, ils s’aperçurent qu’au lieu d’être des ennemis, des tortionnaires, nous étions leurs amis, que notre souci était toujours de chercher pour eux le meilleur abri contre les rafales d’artillerie ou le cantonnement le plus confortable à l’étape, et alors, peu à peu, mais très vite, leur attitude à tous, et je dis tous sans exception, même et surtout Monier et Grégori, changea radicalement » (page 51). Mais cette « découverte » du feu qui tue n’est pas immédiate. D’abord après une rapide marche à la frontière au nord de Nancy, il franchit sans combat ni résistance la Seille, rivière formant la frontière entre la Moselle et la Meurthe-et-Moselle, à proximité de Delme, et n’entend le son que loin derrière les collines qui lui font face, en direction de Morhange. Il se sait pas encore que depuis plusieurs jours, les français sont déjà morts en masse en Belgique et en Moselle et que cette journée du 22 août sera la plus meurtrière de toute la Grande Guerre. Il découvre petit à petit lui-aussi les « caractéristiques » de la « vraie » guerre. Apprenant par l’épreuve les « vertus » de s’enterrer, il confie, le 10 août : «… nous tous qui allions devenir les remueurs de terre que l’on sait, on ne nous avait fait exécuter qu’une seule fois, pendant mes deux années de service militaire, des travaux de campagne avec les outils de parc, c’est-à-dire de vraies pelles et de vraies pioches » (page 62). Sa « découverte » des premiers morts l’impressionne. Le 12 août, il décrit : « Dans une petite prairie, bien verte, gisent des cadavres de chevaux, ceux que montaient les propriétaires des lances, sans doute. C’est la première image de mort qui se présente à nous depuis notre entrée en campagne et soudain, nos rangs si bruyants tout à l’heure, deviennent totalement silencieux » (page 67). Mais le premier mort qu’il découvre n’intervient que le 20 août ; il ajoute « mais nous ne pouvons pas encore nous figurer que pareil sort nous menace » (page 79). Hélas, devant l’exode des populations les villages qui brûlent et les salves d’artillerie qui s’abattent à ses alentours ; la guerre finit par rejoindre le régiment et le baptême du feu est terrible. Le 23, devant la seille, à Moivrons, il décrit le « tintamarre » et le commandant Wurster qui dit : « Arrêtez ! lâches ! Le premier qui recule, je lui brûle la gueule ! » (…) « sa crânerie arrêt[ant] les fuyards » (page 90). La suite est alors, dans les combats du Grand Couronné ou dans ceux de la Course à la Mer, une longue suite de miracles pour le sergent, bousculé à plusieurs reprises par des obus éclatant à proximité (pages 98, 118 ou 189) ou recevant, à au moins cinq reprises (pages 105, 125, 135, 136 ou 182), balles et éclats d’obus qui dans la capote, qui dans la musette et ce qu’elle contient. Certains jours sont terribles de bombardements, comme le 25 août, heureux d’en être sorti entier. Prisonnier, les circonstances et le traitement que Pierre Lœvenbruck décrit sont intéressants. Exhibé à plusieurs reprises à la vindicte allemande (pages 203 et 218), honnête, il dit n’avoir pourtant pas subi de réels mauvais traitements.
Au final, tout l’ouvrage, par sa simplicité, la sobriété de ses tableaux et surtout leur véracité, est résolument l’un des tout meilleurs témoignages rapportant l’entrée en guerre et les premiers combats des civils, réservistes, devenus du jour au lendemain ceux que l’on appellera quelques semaines plus tard les poilus.
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Parcours suivi par l’auteur (date) :
Essey-lès-Nancy (caserne Kléber) : 30 juillet 1914
Nancy : 31 juillet
Toul (caserne A.R.) – Domgermain : 1er août
Velaine-en-Haye : 7 août
Pont de Malzéville – Boudonville : 8 août
Malzéville – Pixerécourt – Bouxières-aux-Dames – Custines – Malleloy : 8 août
Col de Lixières : 10 août
Morey : 11 août
Arraye-et-Han – Ajoncourt – Moivrons – Col de Bratte – Bois de Grémecey : 12-24 août
Villers-les-Moivrons – Faulx – Lay-Saint-Christophe – Agincourt – Lenoncourt – Buissoncourt – Gellenoncourt – Haraucourt – Drouville – Col de la Fenêtre – Réméréville : 25 août – 16 septembre
Valhey – Bathelémont-lès-Beauzémont : 17-27 septembre
Laneuveville-devant-Nancy – Einville – Maixe – Crévic – Dombasle : 28-29 septembre
En train : Nancy (gare de Mon-Désert) – Frouard – Toul – Montereau – Palaiseau – Versailles – Mantes – Vernon – Eu – Montreuil – Berck – Etaples – Saint-Pol-sur-Ternoise – Drocourt : 29 septembre – 1er octobre
Drocourt – Rouvroy – Billy-Montigny : 1er – 3 octobre
Prisonnier : Billy-Montigny – Château de Beaumont – Douai – En train : Valenciennes – Charleroi – Namur – Liège – Verviers – Aix-la-Chapelle – Dusseldorf – Elberfeld – Hanovre – Wittenberge – Parchim : 3-4 octobre.
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Page 18 : Garde-poux, garde magasin
29 : Colonel Granges, commandant du 269ème, « adoré du régiment »
30 : Fusil et drapeau oublié lors d’une marche
35 : Magasin bric-à-brac pour habiller les 250 hommes de la compagnie
38 : Perception des armes
39 : Seulement 3 tailles d’effets
40 : Matriculage personnel des effets
42 : Vue de Toul en état de siège
48 : Couvres képis faits avec des cravates bleues pour masquer la couleur rouge
53 : Gautherot, maire de Pont-à-Mousson
57 : Espionnite (vap 109)
61 : Carapace, « toute la compagnie s’accroupit la tête des uns dans le derrière des autres, de façon à ne plus présenter qu’une croûte de sacs »
68 : Ivrognerie généralisée
70 : Sur la reconnaissance des avions : « La veille [13 août], une note du général a fait savoir à toutes les troupes que lorsque, par erreur, elles tireraient sur un aéroplane français, celui-ci exécuterait en l’air un 8 »
71 : Moustiques
77 : Frontière allemande et poteaux arrachés
: Habitante cachée dans son armoire
78 : Changement de la boîte aux lettres Kaiserliche Briefkaste en fonte d’Ajoncourt par une française
80 : Exode lorrain
81 : Bruit du 75 « semblable à celui d’une cloche de bronze heurtée violemment »
82 : Retraite en pagaïe, impression de débâcle (vap 90, arrêtée par menace par un officier)
88 : Maison pillée dont le propriétaire est soupçonné d’être un espion
94 : Gendarmes serre-file
95 : Mâche de l’herbe pour tromper sa soif
98 : Obus de 77 tombant « comme des gros cailloux »
102 : Vision de charnier, collecte les plaques et les papiers des morts
103 : Allemand blessé
105 : Soldat nommé sergent car il a ramené une mitrailleuse
107 : Obus non éclaté qui « est venu se terrer dans le parapet comme un lapin »
108 : 3 septembre, Sedantag et rituel allemand inutile
120 : Enterrement sur le front, description et croix
121 : Premiers abris (6 septembre)
150 : Annonce au poste de police de Buissoncourt de la Victoire de La Marne
163 : Sacs à grains vides servant de capuchons sous la pluie
169 : Supériorité de la tranchée allemande
170 : Milliers de bouteilles vides dans les abris et les tranchées allemandes abandonnées
171 : Arbre observatoire, doté d’un téléphone
: Première messe (22 septembre)
173 : Vue de tombes, constituées en remplissant les fossés de la route
180 : Vente de souvenirs du front et prix (exorbitants)
188 : Horreur d’un cavalier mort traîné par son cheval
189 : Horreur d’un obus touchant au but sur un homme
193 : Fracture une porte puis une fenêtre d’une maison abandonnée
203 : Intervention d’un officier allemand qui lui empêche d’être maltraité (vap 210)
: Photographié par des soldats allemands avec des kodaks
216 : Inscriptions allemandes sur les trains
220 : Prisonniers servis à la gare de Wittenberge servis par des maîtres d’hôtel en habits !
Yann Prouillet, août 2023
Touchard, Camille (1888-1979)
Touchard, Camille, La guerre de Camille Touchard. Carnets d’un secrétaire d’état-major devenu simple biffin (août 1914 – juillet 1917, Paris, Sutton, collection Histoire intime, 2018, 219 pages
Résumé de l’ouvrage :
Parti de Tours le 3 août 1914, Camille Touchard, né en 1888, est affecté comme secrétaire à l’état-major de la 36ème brigade d’infanterie, de la 18ème D.I. d’Angers du 9ème C.A. de Tours. Il est affecté successivement en Lorraine, fait la batailles des frontières en Belgique et retraite pour participer à la bataille de La Marne dans le secteur de Fère-Champenoise. Après la victoire, il reste en Champagne, à l’est de Reims, puis repart en Belgique, à l’est d’Ypres, jusqu’en mai 1915. Suivent l’Artois, l’Argonne, à nouveau la Champagne, la Picardie, la Somme, avant, tout début 1917, une dissolution de sa brigade qui l’affecte dans une compagnie du 77ème RI. Après une rapide instruction, il arrive au front du Chemin des Dames, où il est blessé de plusieurs éclats d’obus au milieu de juillet 1917, mettant fin au 9ème carnet relatant sa guerre.
Eléments biographiques :
Camille, Auguste, Ferdinand Touchard est né le 26 février 1888 à Moussac, dans la Vienne. Il est l’aîné d’une fratrie composée d’une sœur, Rachel, née en 1893 et d’un petit frère, Abel, né en 1901. Son père, Ernest, qui sera maire de Moussac de 1897 à 1911, est exploitant, propriétaire terrien, et sa mère est mère au foyer. Ce dernier est relativement aisé. Camille obtient le baccalauréat, fait des études de droit, avant d’entrer dans les chemins de fer comme employé à la gare de Nantes, ville où il réside à la déclaration de guerre. Jugé apte au service militaire, il le débute le 8 octobre 1909 et est alors rattaché à la 19ème section de secrétaires d’état-major dépendant du 19ème corps d’armée basé à Alger. Il y fera son service entre le 10 octobre 1909 et le 11 septembre 1911, participant aux opérations de pacification de la zone rebelle algéro-marocaine. Il passe caporal le 19 septembre 1911 et revient à la vie civile le 1er octobre ; c’est donc à ce grade qu’il est mobilisé à la 9ème section de secrétaires d’état-major basé à Tours le 3 août 1914. Il passe sergent le 1er avril 1915. Avec deux autres secrétaires, il est mis à la disposition de la 36ème brigade d’infanterie. Il fait donc toute la guerre dans deux postes dans sa division, secrétaire de brigade et soldat du 77ème R.I., après son versement dû à la dissolution de sa brigade au tout début de janvier 1917. Il tente infructueusement d’entrer dans les chemins de fer militaires et tente plusieurs formations, comme chef de section (« ennuyeux » dit-il), y compris dans les canons de 37, mais finalement, par choix, revient dans le rang, à la 3ème section de la 3ème compagnie du 77ème R.I. Le 8 mars 1918, il intègre le 2ème régiment de tirailleurs indigènes mais ne semble pas être retourné au front. Il est mis en congé illimité le 19 juillet 1919 et reprend alors son travail en qualité de sous-chef de gare à Nantes. Il sera également à la garde Saint-Lazare à Paris en 1927. Il se marie en septembre 1921 avec Marie-Madeleine Dissert et décède en 1979.
Commentaire sur l’ouvrage :
Les 9 carnets de guerre de Camille Touchard présentent l’indéniable avantage d’exemplifier le parcours d’un non-combattant, secrétaire d’état-major de brigade d’infanterie, pendant la période 1914-1916, éclairant rôle et application, riche d’enseignements, dans ce laps de temps. Son rôle consiste, sous la direction de l’officier d’administration, de s’occuper des écritures et de tous les travaux d’importance secondaire d’un état-major de brigade, ce qui forme une charge à l’application finalement très diverse en temps de guerre. Impliquant sérieux et précision, ce caractère se retrouve dans ses écrits, datés et précisément localisés quant au parcours du témoin. Cette précision géographique, scrupuleusement relevée tout au long de son parcours, se révèle à de multiples reprises, par exemple le 29 août 1915, quand il dit « Passons à Canaples (bistrot que je vois pour la troisième fois) » (page 122). Geoffroy Salé, qui introduit et commente le témoignage, fournit dans une longue présentation très précise tous les éléments de nature à contextualiser les carnets de Camille Touchard : Origines familiales et études – parcours militaire avant 1914 – campagne – après-guerre – carnets de guerre et contenu de ce « parcours original », dégageant les nombreux points d’intérêt de ce témoignage. Touchard s’exprime clairement et précisément, quasi journalistiquement, sur ce qu’il parcourt, fait et voit de sa guerre, parfois jusqu’au détail comme le nom du chien de race Dick du château de Neuville. Son premier carnet est d’un style télégraphique se bornant à des phrases courtes et aux toponymes traversés. C’est à partir du second carnet que l’écriture est plus construite et que les descriptions sont plus profondes. À deux reprises, il dit toutefois : « Maintenant, je renonce à écrire ce que je viens de voir » (page 49), et plus loin « Ce que j’ai vu et entendu est indicible » (page 50). Les pages qui concernent les quelques jours consécutifs au retrait des troupes allemandes après La Marne sont spectaculaires. Il connait toutefois une période de lassitude. Le 25 décembre 1914, il dit : « Ne tiens plus mon journal au jour le jour » (page 91). Pis, il l’interrompt de février à avril, complétant cette période en recopiant le JMO, avant finalement de reprendre sa quasi quotidienneté narrative à l’issue. Le 9ème et dernier carnet, correspondant à la période à laquelle il est rentré dans le rang du 77ème, est plus haletant. Il est peu adhérent au bourrage de crâne et s’il le rapporte, c’est en s’en gardant toutefois. Manifestement, Camille Touchard est empathique, y compris à plusieurs reprises envers les soldats allemands prisonniers, parlant leur langue (voir pages 39, 49, 51, 67 ou 75). Il rapporte beaucoup de faits originaux de sa vie quotidienne, qui reviennent parfois au fil des pages. Ainsi, il se plaint de petits vols qu’il subit de la part de soldats, mais il avoue lui-même à plusieurs reprises avoir lui-même « visité » des maisons et « forcé » quelques portes. De même, il apprécie la compagnie des femmes, auxquelles il fait souvent référence, rapportant çà et là quelques « contacts » estimés, évoquant même parfois un « léger badinage ». Il dit même avoir écrit une « lettre à une poule de Rocher », son caporal d’ordinaire (page 82). Il témoigne de temps en temps de sa relation avec les civil(e)s. Le 29 août 1915, il dit, parlant de deux femmes, une mère et une fille, chez qui il loge à Berneville : « J’ai pu les avoir à ma dévotion grâce aux laisser-passer » (page 123). Intéressant pour mesurer le lien entre civils et militaires, il y revient plus loin, disant, alors que son unité quitte Berck, mi-mars 1916 : « Tristes adieux. La population est toute entière dans les rues. Pas une jeune fille ne manque » (page 136). Parfois toutefois, il côtoie des « personnalités » ; le 21 avril 1917, il dit : « Couche chez femme hargneuse » (page 169). Loin d’être un embusqué (il fait d’ailleurs très peu références à ce terme), il se retrouve très souvent très proche des lignes, et en tous cas le plus souvent à portée d’obus (il dit qu’il en a reçu près de 500 le 9 novembre (page 72)), devant déplacer l’état-major au gré des maisons détruites par bombardement. Ainsi, il y échappe parfois de justesse (c’est un obus sous sa fenêtre qui le réveille le 12 novembre 1914 (page 74)), notamment devant Ypres. Il se voit même prisonnier à cette date tellement il est au milieu de la mêlée. Il sera d’ailleurs remercié par ordre du général du 9ème CA en décembre 1915 pour son travail (fac simile page 203). Il a déjà reçu la croix de guerre le 24 juin 1915. Il dit, le 12 juillet suivant : « C’est la première fois que je couche dans un lit depuis onze mois » (page 116). Au final, le témoignage est dense, intéressant, composite et particulièrement éclairant sur un rôle souvent cité par les autres poilus en ligne comme un poste d’embusqué, réalité démystifiée par Camille Touchard qui en fournit une relation remarquable, se posant plus en témoin qu’en narrateur de son propre rôle. Mélange de quotidienneté et vision intérieure d’un état-major, certaines descriptions, comme celle de la préparation d’une attaque, finalement infructueuse, en juin 1915, dans le secteur de Frévin-Capelle (Artois), sont particulièrement intéressantes. En mai 1917, versé dans le régiment dont il tapait les ordres, il devient témoin des mutineries qui s’y allument dans le secteur du Chemin des Dames (pages 175 et suivantes). Geoffroy Salé, à ce sujet, établit quelques notes opportunes, croisant le témoignage avec d’autres du même régiment (comme Allard, Brec, Chamard, Laurentin, Renaud, Retailleau ou Terrier-Santan, cités dans la bibliographie testimoniale (pages 217 et 218)). Camille Touchard porte souvent un regard approprié, jamais gratuitement critique, sur les officiers qu’il côtoie. Toutefois, il distille parfois son avis sur certains, comme le colonel Lefèvre, « dégommé » pour incompétence, ou le capitaine Guillon, qui manifestement n’aime pas son subordonné, sans qu’il sache pourquoi. Il donne même quelques détails techniques d’intérêt au fil du récit. Il pratique également de temps en temps l’artisanat de tranchée, disant faire des bagues (page 125) ou des coupe-papier (page 141). Sur la fin du témoignage de Camille Touchard, et notamment le flou sur les circonstances et la date même de sa blessure, la note n°12 du dernier carnet dit qu’en fonction du document-source, le soldat a été blessé le 17, le 18 ou le 19 juillet 1917.
De rares fautes ou coquilles sont relevées dans cette édition sérieuse et particulièrement bien présentée dans une collection Histoire intime opportune de l’éditeur.
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Parcours global suivi par l’auteur (date) – Etant donnée la précision toponymique de Camille Touchard dans ses innombrables déplacements, rapportant jusqu’aux moindres lieux-dits, lesquels ne peuvent tous être reportés ici, il convient de se reporter à l’index des noms de lieux cités en fin d’ouvrage :
Angers – front de Lorraine : 3-20 août 1914
Ardennes – Belgique – retraite : 24 août – 6 septembre
Bataille de La Marne (secteur de Fère-Champenoise) – début de la guerre de positions (ouest de Reims) : 6 septembre – 21 octobre 1914
Flandre occidentale – secteur d’Ypres : 24 octobre 1914 – 6 mai 1915
Artois : secteur du Mont Saint-Éloi : 10 mai – 5 juin 1915. Secteur de Loos-en-Gohelle : 10 octobre 1915 – 5 janvier 1916. Secteur d’Aix-Noulette : 17 février – 2 mars 1916
Argonne – Verdun : Secteur de Montzéville – Mort-Homme : 29 avril – 11 mai 1916
Champagne : Secteur de Souain-Tahure : 5 juin – 3 septembre 1916
Picardie – Somme : Secteur de Comble : 8 octobre 1916 – 3 janvier 1917
Champagne – instruction au camp de Mailly : 20 janvier – 20 mai 1917
Chemin des Dames – secteur de Craonne : 20 mai – 19 juillet 1917
Composition de l’état-major de la 36ème brigade d’infanterie au 1er décembre 1914
Col. Lestoquoi (ordonnance : Francelle – Poirier)
Cap. de La Taille (ordonnance : Praud) – Audouard (7ème hussards) (ordonnance Lacroix) – du Coulombiers (à partir du 4 avril) (ordonnance : Bouchinet – Pipaud)
Secrétaires : Touchard – Renou – Bernard
Cyclistes : Cerisier – Rouceau
Fourgonnier : Durand
Cuistot des officiers : Caporal Caillaud – de l’ensemble : Guillot
Caporal d’ordinaire : Rocher
Maitre d’hôtel : Plessy
Agents de liaison : du 77ème : Papin – Point – Samson. Du 135ème : Chauveau – Boisard. Du 66ème : Faix. Du 32ème : Allouin. Du 290ème (mi-mars) : non cités
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Page 26 : Soldat assassiné
28 : Passage de la frontière belge, salut du drapeau
: Tire une vache : il la trait
29 : Alboche
34 : Vol entre soldats (son quart, vap 66 éléments de son vélo). Vap 71 lui, qui vole dans une maison et parle à plusieurs reprises de portes forcées (vap 154)
35 : Chignole = vieille voiture
40 : Allemands cachés dans le foin, faits prisonniers
41 : Pillage d’épiceries
: Après la victoire de La Marne « Habitants rangés le long de la route nous regardent passer »
50 : Maison à 12 enfants
: Ramasse un culot d’obus, qu’il présente à son colonel (vap 51 et 54, casques)
51 : Conseil de guerre à Sept-Saulx (vap 58 fusillés, nommés Duverger et Desherbois, du 68ème RI)
56 : Utilise le terme embusqué pour « mettre dans une boîte »
: Joue aux boules
57 : Schnik : Alcool de mauvaise qualité
58 : Espionnite : Arrestation à Wez d’un civil et découverte d’une malle remplie d’effets militaires et de documents sur la TSF (vap 81, 83, civil fou ou espion)
62 : Passe la frontière belge et s’étonne : « Aucun poteau ni drapeau »
64 : Hésite entre un vélo belge et un allemand
67 : Entend les cris des allemands qui attaquent
68 : Obus non explosés fichés dans des peupliers
70 : Altercation avec un homme ivre (vap 70, un anglais, 76, 90 (lui-même), (vap 119)
71 : Colonel d’état-major tirant au fusil sur un allemand
: Bouquet offert à un général suite promotion
72 : Chasse au pigeon (vap 79, soldat chassant à courre avec un lévrier, vap 80, est chasseur lui-même, pêcheur et aussi braconnier)
73 : Trou d’obus rempli de soufre
: Voit un phénomène électrique inexpliqué : « En revenant, phénomène électrique. Eclair nous aveugle et dure très longtemps. Eberlué, perds ma route et au premier pas tombe dans un trou d’obus et renverse la moitié de mon vin et de mon eau-de-vie »
74 : Prisonniers allemands volontaires et patriotes
77 : Promotion express : « Un gosse du 92ème, enfant de quinze ans, s’amène avec deux prisonniers allemands. Est fait 1ère classe »
81 : « En fait de repos, tout le monde est d’avis qu’il vaut mieux être en première ligne, mais ne pas avoir de civils sur le dos »
83 : Soldat blessé par un capitaine
86 : Proclamation aux allemands à se rendre
95 : Charge réduite à 8 grammes du Aasen afin de les lancer plus près
100 : Fait faire un fanion
103 : Puni par un colonel de hussards, mais punition jamais appliquée « N’en ai plus jamais entendu parler »
: Expédie ses effets d’hiver
105 : Frappé sans effet par un shrapnel
109 : Décoration du gourbi (avec des devises latines et grecques !)
114 : Déclaré mort selon les dires d’un ami
127 : Train blindé allemand
128 : Emporte un fusil boche et un obus !
132 : Un soldat vend des clichés au Petit Parisien
138 : Antipathie supposée des Meusiens : « On sent la Meuse où la mentalité des gens n’est pas, dit-on, sympathique aux Français »
143 : Etat des pertes des 135ème et 77ème RI en mai 1916
146 : Ne mange pas : lapin trop cher !
147 : Vue et effet d’une attaque aux gaz : « Les fusées rouges et vertes s’élèvent de partout »
148 : Prix d’un rasoir en septembre 1916 : 3,75 f.
154 : Sort deux enterrés vivants par un obus
155 : Général Lefèvre « dégommé » relevé de son commandement : « Il n’a fait que porter la guigne à notre DI » !
164 : Réaffecté au 77ème RI après une formation
175 : Témoin des mutineries (vap 192 la note sur les mutineries au 77ème RI)
178 : Balle traversant sa capote
179 : Projeté en l’air par une explosion qui ne le blesse pas mais le rend sourd, puis finalement blessé
182 : Avion abattu depuis le sol
190 : Chasse au rat, payée un sou par rat
Yann Prouillet, 11 août 2025
Fribourg, André (1887-1948)
André Fribourg, Croire. Histoire d’un soldat, Paris, Payot, 1918, 255 pages
Résumé de l’ouvrage :
En forme de prélude, intitulé « Aux manœuvres d’Argonne pendant le coup d’Agadir », André Fribourg évoque d’abord trois jours de manœuvres de son régiment, le 106ème R.I. de Châlons-sur-Marne, en septembre 1911, autour de Clermont-en-Argonne. L’ouvrage s’ouvre ensuite sur l’embarquement, à Paris, le 4 août 1914, dans le train qui l’amène sur le front, débarquant la troupe à proximité des Éparges, dans la Meuse, où se déroule la première partie de son récit. Elle s’achève avec sa blessure à la tête, le 10 octobre 1914, par un obus. Après quelques semaines à l’hôpital de Neufchâteau (Vosges) puis de Vitré (Ille-et-Vilaine), il retrouve ses camarade du 106 dans les Flandres, aux alentours de Hondschoote, de Nieuport et de Bergues. En septembre 1915, il est enfin de retour chez lui, diminué car ayant en partie perdu trois de ses sens (odorat, ouïe et vue), vraisemblablement à cause de l’obus qui l’a couché dans cette tranchée des Éparges. Les pages qui concernent ce chapitre sont sensibles, évoquant les horloges éteintes. Il dit l’«… impression funèbre qui se dégage de la maison, et m’affirme que, quoi que je pense ou fasse, une part de moi est bien morte, là-bas, au champ de douleur et de gloire » (page 228). Un an plus tard, en octobre 1916, il reprend son poste d’enseignant et clôture son témoignage dans une phrase explicative de son court titre : « Sachons aimer, souffrir et mourir, c’est-à-dire sachons croire ».
Eléments biographiques :
Georges, André, Alexandre André-Fribourg, dit André Fribourg, est né le 20 novembre 1887 à Bourmont (aujourd’hui Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon) dans le département de la Haute Marne. Après des études brillantes au lycée Henri IV, il est agrégé d’histoire et professeur au collège de Nantua, puis dans des écoles (Turgot et Sainte-Barbe) à Paris, où il demeure. Il a déjà publié deux ouvrages quand la guerre se déclenche. Réformé du fait de sa blessure, il publiera plusieurs autres ouvrages, teintés de propagandisme. Il obtiendra dans sa carrière littéraire trois prix de l’académie française (Thérouanne en 1916, Sobrier-Arnould en 1918 et de Joest en 1939). Croire. Histoire d’un soldat s’ouvre sur une dédicace « À la 1ère compagnie du 106ème régiment d’Infanterie », avec lequel il a fait toute sa courte campagne. Envoyé après-guerre pour différentes missions à l’étranger, il fait également une carrière politique, d’abord comme député de l’Ain (1919 et 1924), puis comme membre du Conseil Supérieur des Colonies et secrétaire de la Commissions de l’Enseignement des Beaux-Arts avant de se retirer de la vie politique en 1936. Il décède à Paris le 27 septembre 1948.
Commentaire sur l’ouvrage :
Après-un avant-propos de l’auteur, l’ouvrage s’ouvre sur la narration « de l’intérieur » d’une manœuvre du régiment pendant quelques jours de septembre 1911 en Argonne. Partant de la caserne à Châlons-sur-Marne (aujourd’hui Châlons-en-Champagne), celui-ci passe par Valmy, Clermont-en-Argonne, Malancourt, Septsarges et Rarécourt. Le but de ce prélude est de démontrer le « dressage » et l’aguerrissement de la troupe par la marche et la manœuvre. Réservistes (dont lui ?), « de tous les types, de toutes les classes ; l’assemblage est divers à souhait : ouvriers, instituteurs, paysans, « intellectuels », gens de la ville et des champs, rien n’y manque » (page 15), aboutissant à « La renaissance morale » (page 28).
Suivent une infinité de tableaux bien écrits, dont la plupart, au moins pour la partie « Lorraine » de l’ouvrage, forment de très belles lignes d’ambiance ou de réflexion :
Le départ – Embarquement (journée du 4 août 1914) : long chapitre qui relate, quasi minute par minute, la séparation et les ressources morales qu’elles impliquent pour le civil transformé en soldat anonyme dans la masse, l’ambiance du train, l’idée qu’il a de la grandeur de l’aventure qu’il s’apprête à vivre (pages 33 à 43).
Au bois des Chevaliers se décompose en la montée au front, d’abord en train puis à pied, ayant débarqué à Villers-Benoitevaux, dans la Meuse, avant l’arrivée dans le secteur des Éparges, si emblématique, même si il ne le cite qu’à la fin du livre (page 241).
Suivent de multiples tableaux qu’il classe ainsi, comme autant de chapitres de sa vie au front de la guerre : L’arrivée (page 61) – En seconde ligne (66) – L’attaque de nuit (68) – En sentinelle (75) – La corvée de cartouches (79) – La tombe (84) – La pluie (86) – La balle (90) – L’insomnie (93) – L’isolement (96) – L’attente (100) – Les « volontaires » (109) – La relève (114) – Le repos (119) – L’angoisse (123) – Le layon (130) et Le poste de secours (141), tous correspondant à sa période sur le front de Lorraine (août – 10 octobre 1914).
La seconde partie de l’ouvrage, intitulée En Flandres, diffère assez notamment de la première ; elle comporte la période de janvier à mai 1915. Toutefois, Jean Norton-Cru dit : « Mais cette deuxième campagne nous semble fictive » page 607 de Témoins, ce qui semble évident puisque le 106ème RI n’est pas en Belgique au cours de cette période, le régiment ne quittant le secteur des Éparges que le 3 août 1915. Pourtant Fribourg avance côtoyer les mêmes personnages cités dans la première partie de son ouvrage, comme Herbin par exemple. Cette partie, plus littéraire, teintée de roman, fait appel aux dialogues et à la procuration de certains tableaux comme Le téléphone, sur le sacrifice des zouaves (pages 159 à 165), ou Le combat sur mer (pages 167 à 171), très lyrique. Le chapitre l’Estaminet (pages 184 à 191) nomme plusieurs de ces établissements dans un village non identifié mais qui pourrait être Groenendijk : Cabaret au Chat, Soleil, Bœuf de Flandre, La Botte de paille, La Belle vue, L’Arc ou L’Hôtel de Ville, ces deux derniers fréquentés par les officiers. La citation de la mort de son ami, qu’il apprend par courrier (page 200), le sergent parisien Camille Aussière, à Zillebecke le 14 décembre 1914, donne une indication sur le 94ème régiment d’infanterie, mais qui ne fait pas partie de la division de Fribourg. Elle ne résout donc pas la question de savoir si cette partie est romancée ou si il a en effet été réaffecté à un autre régiment après sa convalescence consécutive à sa blessure. Sa fiche matricule n’a pas été retrouvée aux archives départementales de la Haute-Marne. Toujours est-il que son récit en Flandres est moins précis que celui sur les Éparges, ne citant par exemple aucun nom de tué. Enfin, les 4 lettres de Jacqueline, émanant manifestement d’une enfant, formant le chapitre avant-dernier Lettres de la marraine est également superflu.
Certains des noms cités permettent toutefois de confirmer la réalité de sa narration : Rigollet (page 74) est bien Auguste, Albert Rigollet, 2ème classe du 106ème R.I., tué Aux Éparges le 29 octobre 1914 ou Thévenier (page 84), Paul Georges Thévenier, 2ème classe au même régiment, tué à Mouilly le 10 octobre de la même année.
Dans le chapitre intitulé Le prisonnier (pages 200 à 203), parlant leur langue, il interroge deux prisonniers allemands, un ouvrier saxon et un paysan.
Peu avant sa blessure, il décrit : « J’écris ces lignes en un coin de grange presque tiède, assis dans le foin » (page 119).
Au final l’ouvrage, composite, revêt un véritable intérêt d’un double ordre ; la partie manifestement testimoniale dans son parcours lorrain [même si Jean Norton-Cru allègue que le seul séjour au front se limite à 10 jours, du 1er au 10 octobre 1914, qui sont en effet les dates clairement énoncées dans le récit] et la qualité d’écriture, décrivant tant le milieu qui entoure Fribourg que ses propres sentiments, parfois profonds. Il réfléchit sur la guerre, qu’il compare à un Dieu sacrificiel (page 144), son rôle à la guerre, comme sentinelle par exemple, parfois jusqu’à la dissertation. Il avance également : « Comme cette guerre élargit la vie, spatialement d’abord, elle m’a fait connaître à fond la Champagne, la Lorraine, la Bretagne, et demain me révèlera les Flandres ; elle me met en contact avec des paysans, des ouvriers bien plus étroitement que le régiment ne l’avait pu faire : la mort, toujours planante, rapproche ; personnellement, elle m’a forcé à me creuser, à me connaître mieux, et la même menace mortelle a déchiré dans mon esprit plus d’une illusion tenace ; historiquement même, grâce à elle, j’ai mieux compris bien des faits du passé illuminé par l’ardeur du présent… Je lui devrai, quoi qu’il arrive, une plus grande connaissance du monde, des hommes, de moi-même » (page 154).
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Parcours suivi par l’auteur (date)
En train : Paris – porte de la Villette – Bondy – (4 août 1914)
Partie Lorraine (pages 47 à 150) : En train : Noisy-le-Roi – forêt de Marly – Mareil – Saint-Germain – Paris – Noisy-le-Sec – Rosny – Nogent – Troyes – Villers[-sur-Meuse]-Benoiteveaux (août 1914)
À pied : Ferme d’Amblonville – Mouilly – Bois des Chevaliers – Bois de la Marche de Lorraine (1er – 10 octobre)
Partie Flandres (pages 153 à 217) : Hondschoote – Nieuport – Lombaertzyde – Westende – Bergues.
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Page 18 : Note sur la tenue réséda et le casque, expérimentés par le 106ème RI en 1911
34 : Belles phrases sur la séparation le 4 août 1914
36 : Contenu de son sac, dont une enveloppe cachetée contenant ses dernières volontés (qu’il retrouve à Paris à son domicile après son retour du front, vap 228)
43 : « Je sais que je vis une aventure énorme, d’une rareté infinie »
54 : Partage du singe, agrémenté
65 : Espionnite du paysan allemand d’Amblonville, ayant repéré les alentours pour l’artillerie dès avant-guerre
79 : Sur sa haine de l’ennemi, en octobre 1914 : « j’ai l’impression de les haïr moins violement qu’au moment de leur ruée d’août »
82 : Sur la fatalité : « Si je me hâte, je recevrai la balle qui allait passer devant moi ; si je m’attarde, je recevrai celle qui serait passée derrière moi »
84 : Description de la tombe de Paul Thévenier, appelée à disparaître avec le temps
86 : « Pluie, boue, froid, insomnie, faim et soif, isolement, balle, obus, voilà nos ennemis rangés par ordre de valeur décroissante »
90 : Dissertation sur les bruits des projectiles en fonction des types : Claquement – Tacquement – Ecrasement – Déchirement – Eclatement – Ronflement, vrombissement – Bourdonnement – Miaulement – Bruissement (fin 93)
93 : Manque de sommeil, caractéristique et évolution (fin 95)
96 : Sur l’isolement jusqu’à l’existence vidée et l’ignorance de la guerre (fin 98). « J’ignore tout de la guerre. J’ignore l’armée à laquelle j’appartiens. J’ignore tout de mon corps, à peu près tout de ma division et de ma brigade, beaucoup de mon régiment, de mon bataillon et même de ma compagnie. Mon groupe est l’escouade ; c’est par escouade que nous occupons et que nous défendons les tranchées. Mais chacun de nous ne vit guère qu’avec une dizaine, une vingtaine de camarades. Dans les gigantesques armées composées de centaines de milliers de soldats qui luttent dans ces bois, l’homme est aussi isolé que jadis quand il marchait en bande autour d’un totem. Notre isolement paraît organisé. On nous a réduits à l’état de cellule guerrière et j’ai l’impression d’une armée émiettée. Nous ne savons rien, pas même le nom du général qui commande notre brigade… » (page 99)
98 : Sur les lettres « seuls liens avec le pays et la famille », il apprend la mort de Péguy en lisant un vieux journal ayant emballé un colis
100 : Théorie des engrenages circulaires, « gigantesques machines à tuer »
101 : Odeur composite de la tranchée : « Odeur de graillon, qui vient des bouthéons mal lavés, odeur de cuir qui sort des équipements, odeur de graisse qui vient des armes, odeur de poudre, odeur de crasse, odeur de dysenterie qui tourmente les hommes vingt fois par jour et les vide jusqu’au sang, odeur de pourriture fade qui sort des grands quartiers de bœuf qu’on nous a livrés par morceaux de trente kilos, à nous qui ne pouvons pas faire de feu, odeur de chevaux crevés, odeur de feuilles vives et mortes et du sol humide, odeur du sang séché et des cadavres jeunes dont la terre est farcie »
126 : Menaces du capitaine (Gérard) : « Je brûle la g… à qui faiblira », (vap 241 sur son suicide avant de remonter au front)
129 : Homme devenu fou
131 : Similitude situationnelle de la scène décrite avec la blessure de Maurice Genevoix (du même régiment)
131 : Boue « pareille à de la crème de riz trop délayée »
135 : Pelle-pioche placée contre la nuque en protection
136 : Sur la réalité de la guerre : « Nous avions espéré des batailles épiques, et nous allons mourir pilés à coups de ferraille, par une main invisible, au fond d’un trou, dans la boue »
137 : Idée de suicide d’un soldat
157 : Tête à caler des roues de corbillard
190 : Sur la nécessité d’avoir des amis au front
198 : Sur sa théorie de la « vie en cercle, toujours identique, monotone, désespérante… Mêmes horizons, mêmes platitudes, mêmes ruines, mêmes tranchées, mêmes réseaux, mêmes clochers, mêmes ruisseaux, mêmes visages, mêmes espoirs, mêmes souffrances, même menace de la mort qui s’approche ou s’éloigne suivant l’heure, mais qu’on devine, toujours, guetteuse, autour de soi ». (…) « Il n’y a pas de bataille, mais seulement « musique de scène » de bataille »
199 : Sur la mort des autres et la culpabilité de sa survivance : « Les pertes sont faibles actuellement dans le secteur, mais ailleurs il n’en va pas de même ; à chaque mort que j’apprends, j’ai comme un étonnement et un remords de vivre et je sens augmenter la dette que je contracte envers ceux qui sont tombés »
Yann Prouillet, 6 août 2025
Leleux, Charles (1876-1943)
Charles Leuleux, Feuilles de route d’un ambulancier. Alsace – Vosges – Marne – Aisne – Artois – Belgique, Paris, Berger-Levrault, 1915, 111 pages
Résumé de l’ouvrage :
Charles Leleux est mobilisé le 9 août 1914 à l’ambulance hippomobile n°6 du 21ème Corps d’Armée (6/21). Il quitte Paris à cette date en direction de l’Est puis à pied, rejoint la ligne d’un front mouvant qui l’amène sur la ligne de contact dans les Vosges, au nord du Donon où son ambulance manque qu’être capturée, à l’instar de celle du docteur Perrin, du 3ème BCP, à Lettenbach. Suit la retraite de la bataille des frontières qui l’échoue, après la bataille de La Marne, dans les premières offensives de Champagne, autour de Suippes. Puis ce sont l’Aisne, l’Artois et la Belgique où Leleux décrit à la fois l’installation de l’ambulance, son action pour les blessés et son environnement, y compris social. Début janvier 1915, il apprend qu’il est muté dans un train sanitaire ; il cesse sa narration de cinq mois de guerre haletants, basée sur la tenue d’un carnet de guerre dont il dit, le 21 décembre 1915 : « Comment tenir un carnet de route à jour, avec de pareilles semaine ? » (page 105), complété du carnet de route du docteur Henri Liégard, l’un des 6 médecins de l’ambulance dirigée par Edouard Laval, autre témoin de la 6/21.
Eléments biographiques :
Chartes Leleux est né le 31 juillet 1876 à Château-Thierry, dans l’Aisne, de Charles Eugène, ouvrier en cheveux, et de Marie Anne Rothfritsch, exerçant la même profession. Ils habitaient 53 rue des Capucins. Il épouse le 29 août 1909 Apolline Marie Alphonsine Raillot à la mairie du 5ème arrondissement de Paris, où il demeure. Il fait ses études au collège Notre-Dame de Rethel, dont il deviendra plus tard vice-président des Anciens Elèves, publiant en 1930 Quand nous étions jeunes… (Souvenirs du Collège Notre-Dame de Rethel). Il fait une carrière d’avocat à la Cour d’Appel de Paris mais c’est comme personnel de formation sanitaire, d’abord comme ambulancier pour l’année 1914, puis dans un train sanitaire, qu’il fait la Grande Guerre. Il fera également une carrière littéraire assez diversifiée, classé par la BNF comme auteur d’ouvrages de vulgarisation scientifique et fondateur de la revue paramédicale « Aristote« . Il meurt en 1943.
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Le parcours décrit par Charles Leleux dans son ouvrage est à confronter avec le Journal des Marches et Opérations de l’ambulance, visible sous la cote DE 2021 ZE 2/264, (consultable ici JMO6/21). Il convient de s’y reporter pour l’ensemble des précisions quant aux rattachements de l’ambulance aux grandes unités, aux déplacements et à l’activité médicale, traitement, entrées, sorties et décès, de l’unité) porte également la mention du docteur Cellier, médecin-Major de 2ème classe qui lui succèdera. Il permet aussi de rétablir en partie les caviardages patronymiques contenus dans le témoignage, notamment lors de la présentation de la composition sociale très hétérogène de l’ambulance faite par Charles Leleux pages 5 et 6. Ainsi, « Ce cavalier, en tête de notre colonne, c’est notre médecin-chef, l’aimable docteur La.. » (page 5). Il s’agit d’Edouard Laval, médecin-major de 2ème classe, médecin-chef jusqu’à fin février 1915, porte-t-il sur le document dont il est le rédacteur. Il n’est donc pas étonnant qu’il se serve de cette rédaction pour rédiger ses propres mémoires, publiées en 1932 sous le titre « Souvenirs d’un médecin-Major, 1914-1917 » Laval Edouard (1871-1965) – Témoignages de 1914-1918 dans la « Collection de mémoires, études et documents pour servir à l’Histoire de la guerre mondiale », collection de référence « concurrente » à celle de la Librairie-Militaire Berger-Levrault « La Guerre – les récits des témoins » dans laquelle est publié l’ouvrage de Charles Leleux et dont la lecture est indissociable, comme celle du livre de François Perrin, « Un toubib sous l’uniforme » Perrin, François (1875-1954) – Témoignages de 1914-1918, notamment pour « l’affaire de Lettenbach ». Ce document renseigne sur sa date de création, le 10 août 1914, à Darnieulles, dans les Vosges, correspondant au début du périple « à pied » de l’ambulance après son débarquement du train. Leleux poursuit en citant l’architecture de l’unité, composée des docteurs M[artial-Lagrange]., H[auser, lequel sera évacué le 23 décembre suivant pour cause de lithiase biliaire], A[lexandre]., R. et L., médecin de réserve, tous parisiens et Ch. Pharmacien-Major, « qui, malgré ses cinquante-trois ans, a voulu, comme ses deux fils, faire campagne ». [Il s’agit du docteur Choay, qui sera évacué pour un érésipèle de la face sur l’hôpital de Châlons-sur-Marne le 29 septembre (page 12 du JMO), qui reviendra à son unité pour être à nouveau évacué le 18 février du fait d’un névralgie faciale gauche avec hémiparésie du même côté (page 24 du JMO)]. Suit le capitaine d’administration B. [le capitaine Bouchu, officier d’administration gestionnaire de la formation. C’est lui qui organisera le décrochage de Lettenbach, auquel rend hommage le docteur Laval puisqu’il évite à la 6/21 la capture par les Allemands, (page 7 du JMO)], secondé par le lieutenant de réserve, l’abbé W. Il précise en effet que plusieurs prêtres sont au nombre des ambulanciers : « deux missionnaires de Paris, deux professeurs de Versailles et trois curés de Seine-et-Oise ». Suivent ensuite : « et comme eux réservistes ou territoriaux -, un avocat à la Cour de Paris, un pharmacien de Montreuil, deux dentistes, un étudiant en médecine, trois élèves pharmaciens, un étudiant en droit, et puis des commerçants, des employés, des ouvriers, en tout une quarantaine. Joignez-y les dix « tringlots » qui, sous la conduite de leur « margis » ; s’occupent des chevaux et conduisent nos six fourgons, et vous aurez le recensement complet de notre effectif » précisant encore : « Tous unis, d’ailleurs, tous fraternisant, sans distinction d’opinion, de culture ou de milieu : voyez ce caporal et ce soldat, qui marchent côte à côte en devisant ; l’un est le vicomte M. de La V., « camelot du Roy » s’il en fut, et l’autre le charpentier J., enragé « cégétiste » de la rue Grange-aux-Belles… Non loin d’eux, le docteur…, qui est protestant, bavarde avec l’abbé L., professeur de grand séminaire, cependant que, déjà hissé sur le siège d’un fourgon – où son obésité, son asthme et ses « ampoules » ne justifient que trop sa présence – notre gros avocat parisien égaie la marche de la colonne par son rire et ses chansons » (page 6). La confrontation de l’ouvrage au JMO donne ainsi confirmations et précisions : Le docteur Rolet est désigné pour rester avec les blessés intransportables car il est le plus jeune des praticiens ; il reste avec les infirmiers Bois, Gaudin et d’Albay.
Pour son récit, Charles Leleux s’appuie sur les écrits d’un des médecins de l’ambulance, le docteur Henri Liégard, chef de clinique aux Quinze-Vingts, qui a vécu le même parcours que lui jusqu’à sa propre évacuation le 15 février 1915 pour kyste au crâne (JMO page 24). Au final, l’ouvrage est un témoignage remarquable, permettant un suivi chronologique et toponymique précis et exact. Il est, à l’instar de son homologue « Souvenirs d’un médecin-Major, 1914-1917 », teinté de patriotisme, nombre de blessés ne souhaitant que guérir et repartir au feu, et de plusieurs épisodes de bourrage de crâne et d’espionnites, plus rapportés et supposé que réels, (cas du téléphone au fil souterrain dans la vallée de la Bruche ou du vieillard enterré vivant à Bréménil). Leleux se lance même dans une avance osée, prêtant ces propos au docteur Laval : « … j’avoue que j’éprouve un sentiment d’admiration profonde devant le stoïcisme de tous ces mutilés. S’ils étaient « civils », je suis sûr qu’ils hurleraient de douleur lorsqu’on les panses… Mais ils sont soldats ! Voyez dans cette salle, pas un cri ! Ce sont des vrais Spartiates… ! » (page 93). La comparaison avec la même date dans la relation d’Édouard Laval confirme les affres de la journée du 5 novembre 1914 dans l’école. Il fait également mention de ces « civils », mais en termes plus sobres ! Il dit : « Ah, combattants mes frères, vous ne vous doutez pas que, dans ces minutes extraordinaires, ceux que vous dénommez non-combattants donneraient beaucoup pour être à votre place, exposés, risquant la mort plus sûrement, soit ! mais ne pensant qu’à brandir leur instinct de protection et à taper sur l’ennemi avec toute la rage qu’on peut avoir au cœur, quand, au milieu des camarades animés de la même ardeur, on défend sa peau… » (page 80 de « Souvenirs d’un médecin-Major, 1914-1917 »). Plus loin, il précise toutefois, contredisant Leleux : « Ce ne sont plus les blessés vaillants des premiers combats de la guerre, mais des êtres mornes, dont les nerfs semblent usés » (page 81 du même ouvrage). La confrontation du carnet de route de Henri Liégard et de Charles Leleux et les souvenirs d’Édouard Laval éclairent profondément le parcours de l’ambulance 6/21 et l’érigent en unité hippomobile la mieux documentée de ce type de formation sanitaire. Leleux est cité (pages 171 et 172) dans Témoins, de Jean Norton-Cru, mais sa notice est étique sur le plan de l’état-civil (sa date de naissance a été laissée en blanc et son année de naissance est erronée) et Cru n’ pas identifié plus précisément l’ambulance.
Parcours suivi par l’auteur (date – période)
En train : Gare de Bercy – La Rapée – Versailles – Vanves – Fontainebleau – Moret – Montereau – Sens – Joigny – Montbard – Dijon – Gray – Jussey – Monthureux – Darnieulles (9-10 août 1914). Débarquement – Gugnécourt – Bruyères – col du Haut-Jacques – La Bolle (11-13 août) – Saint-Dié – La Hollande – Saint-Jean-d’Ormont (14 août) – La Grande-Fosse (15 août) – Saales Bourg-Bruche – Saint-Blaise-la-Roche – Fouday (16 à 18 août) – Rothau – Donon – Raon-sur-Plaine (18 août) – Abreschviller – Saint-Quirin (19-20 août) – Lettenbach (20-21 août) – Cirey-sur-Vezouze – Bréménil – Badonviller – Pexonne – Neufmaisons – Raon-l’Etape – La Haute-Neuveville – col de La Chipotte – Saint-Remy – La Salle – Housseras – Autrey – Sainte-Hélène – Grandvillers – Aydoilles – Dompierre – Destord (22 août – 6 septembre).
En train : Darnieulles – Mirecourt – Pont-Saint-Vincent – Sorcy – Gondrecourt – Joinville – Wassy (6 septembre) – La Neuville-à-Remy – Montier-en-Der – Lentilles (8 septembre) – Chavanges (9 septembre) – Donnement – Brébant – Saint-Ouen – Le Meix Tiercelin – Sompuis – Soudé-Sainte-Croix (12 septembre) – Vitry-la-Ville – Pogny (13 septembre) – Suippes (13-28 septembre) – Saint-Etienne-au-Temple – Saint-Hilaire. En train : Châlons – Epernay – Damery – Dormans – Château-Thierry – La Ferté-sous-Jouarre – Trilport – Meaux – Lagny – Paris – Saint-Denis – Creil – Amiens – Saint-Pol. À pied – Ramecourt (28 septembre – 6 octobre) – Savy-Berlette — Aubigny (6 octobre – 1er novembre) – Cambligneul – Gouy – Hersin – Nœud-les-Mines – Béthune (2 novembre) – Merville – Vieux-Berquin – Outersteen – Bailleul – Belgique (3 novembre) – Locre – Reninghelst – La Clytte (4-12 novembre) – Vlamertinghe (12 – 29 novembre) – Poperinghe (29 novembre – 2 décembre) – Ypres (2 – 29 décembre ) – Elverdinghe – Hersin (janvier 1915).
Table des illustrations publiées dans l’ouvrage
Entre les pages 16 et 17 : Poteau frontière abattu au col de Saales et vue de Saales – 16 août
Entre les pages 32 et 33 : Gorge de Fouday et vue de Rothau – 18 août
Entre les pages 36 et 37 : Blessés sortant d’un ambulance à Saint-Quirin, devant le restaurant Louis Baillet) et Zeppelin LZ22 – 18-22 août
Entre les pages 44 et 45 : Vallon de Saint-Quirin et blessés – 19-20 août
Entre les pages 64 et 65 : Blessés (Suippes) et convois sur les routes des Flandres (18 novembre)
Entre les pages 80 et 81 : Blessé à Ypres (décembre)
Entre les pages 84 et 85 : Halles d’Ypres avant le bombardement
Entre les pages 92 et 93 : Halles d’Ypres après le bombardement (janvier 1915)
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Page 16 : Enterrement des chevaux
31 : Espionnite généralisée « comme ce chef de gare de Saulxures, dans la vallée de la Bruche, qui, au moyen d’un fil souterrain, indiquait aux Allemands l’emplacement de nos batteries » (vap 17 et 48, avortées)
41 : Exactions allemandes, vieillard enterré vivant à Bréménil
45 : Manque général de boisson, même l’eau, empoisonnée (vap 52)
46 : Plan de Paris « soigneusement côté » trouvé sur un officier allemand tué
47 : Etat d’Epinal le 6 septembre
50 : Allemands capturés car endormis dans les maisons
51 : Odeur de la destruction, sentant l’oignon rôti, rappelant l’odeur de Bazeilles (vap 53)
52 : Comparaison patriotique des monceaux de morts français et allemands
54 : « Épaves de l’exode »
: Million de bouteilles de champagne sur le bord des routes
56 : « Sur la crête qui le domine [Souain], les allemands en se repliant ont établi leurs fameuses taupinières, cimentées et blindées comme des forteresses », blockhaus vus dès le 14 septembre 1914
57 : Sur les plaies peu graves car aseptisées par la chaleur (200 °) de la vitesse de la balle
: Vue de l’organisation et du fonctionnement de l’ambulance de Suippes (vap pp 91 et 92 la même description plus précise de l’ambulance de La Clytte, installée dans une école)
60 : Tombe = tranchée sans relève
63 : Vue d’une exécution
65 : Vue du cimetière du parc de l’ambulance de Suippes et identification des tombes
66 : Voit une tranchée, définition sobre : « nous comprenons qu’un fossé est là et que dans ce fossé il y a des hommes »
67 : Parle sans savoir d’un grosse Bertha
71 : Vue d’exode et de paysans endimanchés
74 : Tableau de fraternisation des blessés français et allemands
: Annonce de la prise d’Anvers par un avion allemand
76 : Vue de l’obus qui sort de la bouche du canon
77 : Accouchement au front, (vap 78 enfant portant le prénom des médecins)
79 : Village nègre du bois de Bouvigny
80 : Retour des personnels (Dr Rolet et les ambulanciers d’Albay, Bois et Godin) capturés à Lettenbach, (à rapprocher aux témoignages des docteurs Laval et Perrin)
82 : Sur le poilu : « C’est un gaillard, il a du poil »
88 : Vue de Cipayes
89 : Autobus anglais
93 : Bruit de l’obus, « un bruit de train lancé sur des rails mouillés »
96 : Jeu flamand de la fléchette
101 : Mitrailleuse allemande de prise utilisée comme DCA
105 : Collection de guerre : « .. un éclat d’obus est entré sans crier gare ! Chacun se précipite. C’est à qui l’aura : il n’ a pas que les anglais, en effet, qui ont la manie de la collection… »
108 : Superstition, un de ses ambulanciers utilise le tarot qui annoncent sans cesse « une victoire certaine »
Sur la joie : « … à travers nos misères et nos souffrances, il y a des rayons de lumière, des instants de vraie joie, d’exquises minutes : c’est l’annonce d’un succès de nos poilus, ou de nos amis les Russes ; c’est l’arrivée d’une lettre ; c’est la réception d’un colis, vêtements chauds, vivres, tabac, toutes les douceurs de l’amour ou de l’amitié… »
Yann Prouillet, 03 août 2025
Testes (-)
TESTES, Vies sacrifiées, Paris, Spès, 1926, 176 pages
Résumé de l’ouvrage :
L’auteur, TESTES, qui pourrait être Marie Le Mière, présente un recueil de biographies, ayant valeur de Livre d’Or, 19 contemporains du fondateur de l’Union Catholique des Malades, au premier semestre de 1914, avec pour point de catalyse le sanatorium de Leysin, en Suisse, spécialisé dans le traitement des tuberculeux. Autant de personnages dont la vie, sacrifiée par la maladie, se sont, en entrant dans l’association, rapprochés de Dieu.
Commentaires sur l’ouvrage :
Très peu d’intérêt dans ces biographies de malades qui se sont, à un moment de leur vie brisée par la maladie, tournés vers la religion dans l’U.C.M. Malgré qu’ils soient contemporains de la Grande Guerre, certains n’ont pour la plupart qu’un lien assez ténu avec « l’expérience de guerre ». Aussi très peu d’éléments peuvent être dégagés à la lecture de cet ouvrage qui fait un lien profond entre l’Histoire de l’Union Catholique des Malades et de ses créateurs ainsi que des sanatoriums, dont celui de Leysin. L’ouvrage donne aussi quelques éléments sur l’association protestante des Coccinelles, fondée par les suissesses Adèle Kamm et Louise Dévenoge en 1909 et dont Louis Peyrot s’inspira. L’ouvrage peut toutefois se révéler intéressant dans le cadre d’une étude de parcours des malades et des empêchés dans la Grande Guerre.
Louis Peyrot (fondateur de l’U.C.M. le 4 mars 1914) est né le 11 janvier 1888 à Néris-les-Bains, près de Montluçon (Allier) d’un père docteur. Il est dans cette commune lorsque la guerre se déclenche et les blessés y affluent rapidement. C’est probablement lors de son service militaire, en octobre 1906, au 121ème qu’il commence à développer sa maladie, il sera à jamais écarté de la Grande Guerre à cause de sa tuberculose, qui lui ôtera finalement la vie en août 1916.
Jean Girardot, fondateur de l’U.C.M., qui semble avoir toujours été malade, dit, la guerre déclarée : « Nous sommes des contemplatifs par force » (page 42) avant de distiller, dans un court extrait de journal de maladie en guerre, ses pensées religieuses, se disant, le 24 février 1917, très heureux d’être malade à la maison entourés des siens. Il meurt le 24 juillet suivant.
Thérèse Mias, rémoise, sœur d’un médecin, tombe malade à l’âge de 22 ans, en juin 1915. Elle aussi fréquente Leysin, foyer religieux qui l’invite à entrer dans les ordres, le Tiers-Ordre de Saint-François, qu’elle intègre en mai 1916.
Charles Rheinart, autre fondateur de l’U.C.M., naît le 25 mai 1873 à Charleville dans les Ardennes. Militaire, malade, il se tourne vers la religion avant de décéder le 18 mai 1914.
Marie Louise Geneviève Marcellot, né en 1891, se destine à la religion dès l’âge de 8 ans en entrant dans une église près d’Eurville, en Haute-Marne. Mais au cours d’un voyage en Angleterre et à Rome, elle tombe malade et la guerre la surprend dans son village, à quelques kilomètres au sud-est de Saint-Dizier. Malgré la menace de l’invasion, elle ne le quitte pas et y installe même une ambulance. Se démultipliant, elle dit : « Sans l’avoir choisie, j’ai la meilleure part », ajoutant : « Ici, on a presque la nostalgie du champ de bataille », se morfondant d’un front si proche mais pour tant si lointain, où elle pourrait rencontrer « le grand souffle » de la guerre et « l’élan vivifiant de la bataille » (pages 74 et 75). Deux années de ce « régime » l’affaiblissent à nouveau, l’obligeant elle-aussi à Leysin. Elle rechute en 1921 avant de mourir le 1er juin 1923, dans sa 32ème année, d’une hémoptysie.
Marie-Thérèse Pinot « fit à 11 ans sa première communion sous l’égide de son oncle, l’abbé de Cabanous, curé de Saint-Thomas d’Aquin » (page 84). Elle perd ses parents très tôt et rêve d’embrasser une carrière médicale pour se consacrer aux pauvres. Un de ses frères combat en Argonne, dont elle s’occupe lorsqu’il est évacué pour pieds gelés. Malade, elle rechute en octobre 1915. Elle décède à Boulogne-sur-Seine le 16 janvier 1916.
Madeleine Vernhett, qui a habité Nîmes et Genolhac, dans le Gard, semble mourir en 1919.
Anaïck Petit de la Villéon, appelée familièrement Yeddy, a 14 ans quand elle entre à l’U.C.M. Ayant passé la quasi-totalité de sa vie malade et alitée, elle meurt le 19 mai 1920.
L’abbé Louis Delcroix, qui souffre étant enfant d’Hémoptysie, fait le Grand Séminaire à Lille. Habitant la Belgique lorsque la guerre se déclenche, il raconte en quelques phrases l’arrivée des Allemands à Lille le 4 septembre 1914, échappant de justesse à l’occupation et au bombardement, contrairement à ses deux sœurs, restées dans la ville. Il meurt le 8 mai 1918 au Dorat, en Haute-Vienne.
Albert Lapied, né en 1903, est issu d’une famille d’artisans parisiens de 8 enfants. Son père est imprimeur, l’un de ses frères sera typographe, un autre lithographe. Il perd sa mère en août 1919 et est quant à lui gravement malade, passe de sanatoriums en sanatoriums. Il meurt paisiblement à Paris.
Florence Peyrard est la 15ème de 17 enfants. Née dans une famille pauvre, elle travaille dès l’âge de treize ans dans une des deux usines Sainte-Julie et Sainte-Marthe de tissage de soieries à Saint-Julien-Molin-Molette, dans la Loire. Elle y subit les grèves de 1917 qui lui font perdre son emploi. Elle a 17 ans lorsque ses parents la placent comme domestique à Lyon, puis à Paris, mais elle y attrape la tuberculose. Elle décède en mars 1921.
Mme Philippe habite à Solal, petite commune de Suisse où elle est paysanne. Elle épouse un français qui est mobilisé dès le 3 août alors qu’elle est enceinte d’une petite fille qui naît le 21 septembre 1914. Son mari, cité à l’ordre du jour et déjà croix de guerre, vient en permission à Soral le 3 août 1915, faisant connaissance enfin avec son enfant. Elle ressent les premiers symptômes de sa maladie le 14 septembre suivant. Elle donne à sa fille une petite sœur le 15 juillet 1916. Mais, son état s’aggravant, elle doit elle-aussi intégrer le sanatorium de Leysin et le 2 novembre 1918, elle s’éteint quelques jours avant l’Armistice et le retour de son mari.
Alors qu’il est admissible aux examens de l’école Polytechnique en juin 1910, Louis Teisserenc doit partir pour Leysin, qu’il quitte en 1913 pour entrer à Combo-les-Bains. Il retourne enfin dans sa famille à Lodève en mai 1914 mais finit par s’éteindre le 13 juillet 1915.
L’ouvrage cite encore Anne-Marie de Germiny, dont le frère aîné meut meurt au champ d’honneur, Mme Fagneux, dont le mari et les quatre frères sont au front, Marthe Hortet, Marguerite Ducrest, Georgette Francey, Suzanne Legoux, de Mantes, tombant malade en quêtant pour les orphelins de 1915. Suivent encore Pierre Colin et Pierre Vallot, « qui connurent tous deux la douleur d’être retenus par la maladie loin des champs de gloire, aux jours de la Grande Guerre » (page 157) aux sanas de Durtol, Cambo, Montana ou Leysin.
Henriette Ferté naît quant à elle le 17 juillet 1892 à Acy, près de Soissons, dans l’Aisne, dans une vielle famille de propriétaires terriens. Elle perd son père à l’âge de trois ans et demi et se destine à entrer chez les petites Sœurs de l’Assomption, le 15 octobre 1913. Mais la maladie l’en empêche et, moins d’un an plus tard, elle fuit devant l’invasion allemande, pour s’arrêter dans le Limousin. Elle revient à Acy, où les tranchées de seconde ligne commencent derrière la ferme. Son état s’aggrave en février 1916 et elle entre à Leysin en juillet suivant. Le 27 mai 1918, la famille Ferté doit à nouveau fuir devant l’avancée allemande, exode organisé par Victor, le frère aîné d’Henriette, pour échouer comme réfugiée au château d’Arthé, dans l’Yonne. Son frère tente à plusieurs reprises de rentrer en pleine bataille : « Il a vu les ruines plus nombreuses qu’au premier voyage, écrit-elle le 30 août, et n’a pu demeurer même 24 heures, étant repéré par avion ou enveloppé de ces gaz odieux… La maison tenait toujours, et le jardin, transformé en forêt vierge, embaumait. Un silence désertique sur le village. Pas une âme alentour. Et, seule, la voix du canon pour scander les heures. Les Barbares ont pris nos vieilles cloches, fidèles amies de toujours, qui avaient tant sonné pour nos joies et nos deuils » (page 170). Elle quitte toutefois le manoir d’Arthé le 1er octobre pour renter dans une maison restée miraculeusement debout malgré une guerre si proche, et où elle va vivre les « jours exaltants de la victoire » (page 170). La vie d’après-guerre reprend et Henriette s’installe à Soissons le 13 août 1919. Mais la maladie trouve son chemin et elle finit par s’éteindre le 21 octobre 1920 à midi.
Sur l’U.C.M., la lecture de cet ouvrage peut être complétée par celle de L’apostolat d’un malade : Louis Peyrot et l’Union catholique de malades / Jean-Paul Belin | Gallica
Yann Prouillet, 29 juillet 2025
Saint-Clair-Erskine, Millicent (1867-1955)
Résumé de l’ouvrage :
Duchesse de Sutherland, Six semaines à la guerre. Bruxelles – Namur – Maubeuge. Paries, Librairie militaire Berger-Levrault, 1916, 91 pages
Issue d’une des familles les plus riches d’Angleterre, grande propriétaire terrienne, Millicent Sutherland, crée dans un de ses nombreux châteaux, celui de Dunrobin, une association au profit de ses ouvriers et fonde un hôpital pour les enfants malades de ses terres. Une fois la guerre déclarée, membre de la Croix-Rouge française, elle décide de poursuivre cette œuvre et d’utiliser son statut et son argent pour créer de toutes pièces une ambulance qu’elle emploierait dans une zone de guerre, pensant d’abord à la France. À Paris, elle apprend que la Belgique manque d’ambulance ; elle monte alors une « équipe » composée d’un chirurgien et de 8 infirmières (page 12) et se rend à Bruxelles où elle est redirigée sur Namur. Là, elle s’installe au couvent des sœurs de Notre-Dame, au centre de la ville, à quelques mètres de la confluence entre la Sambre et la Meuse (la photographie de la porte gardée par deux sentinelles, page 53, correspond aujourd’hui au 41 rue du Lombard), qui dispose de 150 lits. C’est là qu’elle est submergée par la vague de l’invasion allemande, de ses cortèges d’exactions et destructions, et qu’elle reçoit jusqu’à 100 blessés. Elle semble alors découvrir l’ampleur et les implications de sa tâche. Le 23 août, elle dit : « Ce dont auparavant, je me fusse crue incapable me semblait alors tout naturel : laver les blessures, enlever les habits et les loques tachés de sang, tenir des cuvettes pleines de sang, calmer les gémissements des soldats, soutenir un blessé recevant l’extrême-onction entouré des religieuses et du prêtre, tant il paraît près de mourir ; tout cela devient un devoir facile à accomplir ». Devant l’affluence, elle complète : « … je comprends soudain qu’elle bénédiction est notre ambulance » et devant la réalité de l’implication de son personnel, elle précise enfin : « Personne ne peut, tant que ces horribles choses ne sont pas réalisées, s’imaginer la valeur des infirmières anglaises entraînées et disciplinées » (page 23). Elle assiste au bombardement et à l’incendie partiel de la ville, rencontre le général von Bülow, dont le quartier général est situé à l’hôtel de Hollande, et décrit « la vie avec les envahisseurs ». Le 4 septembre, elle obtient l’autorisation de se rendre à Mons (à 70 kilomètres à l’ouest de Namur) afin « de voir les Anglais blessés » (page 43). Tous ses blessés finalement évacués, elle se voit contrainte de quitter Namur par ordre du gouverneur allemand. Elle essaye alors de rejoindre la France en pleine bataille de La Marne et finit par rentrer en Angleterre, par Liège et la Hollande, avec son personnel particulièrement dévoué, le 18 septembre 1914, après six semaines rocambolesques dans une Belgique en guerre et occupée. Reconnaissant l’héroïsme de son « équipe », elle dit : « C’est à leur courage et à leur habileté professionnelles que je dédie ce livre » (page 12). L’ouvrage est illustré de 8 photographies intéressantes, dont deux du personnel de l’ambulance au complet (pages II et 81). Elle donne parfois quelques éléments sur les circonstances de ces prises de vues dans le livre, d’une carte de la Belgique et du nord de la France, et de deux fac-simile de ses passeports pour circuler dans la Belgique occupée. Elle dit également nourrir sa narration sur la base d’un carnet de guerre dans lequel elle puise parfois des éléments, comme elle l’annonce le 22 août, quitte à entraîner quelques confusions, notamment sur la date du lendemain, celle de l’afflux des premiers blessés dans son ambulance (pages 23 et 24). Son témoignage semble fiable, d’autant que lorsqu’elle reporte des éléments douteux, comme ces pièces lourdes de siège prépositionnés dans une usine allemande avant la guerre, elle prend soin d’ajouter : « Cette histoire me paraît peu admissible » (page 65).
Eléments biographiques :
Lady Millicent Fanny Saint-Clair-Erskine naît le 20 octobre 1867 à Dysart, ancienne ville royale située dans le comté de Fife en Ecosse. Elle est la fille aînée d’un homme politique écossais, Robert Saint-Clair-Erskine, comte de Rosslyn, et de Blanche Adeliza Fitzroy. Elle a deux sœurs, Sybil Fane et Angela Forbes. Elle a 17 ans, le 20 octobre 1884, quand elle épouse Cromartie Sutherland-Leveson-Gower, lequel hérite de son père du duché de Sutherland. Ce dernier meurt en 1913 après lui avoir donné 4 enfants (Victoria Elizabeth (1885-1888), George (1888-1963), Alastair (1890-1921) et Rosemary (1893-1930)). Bien que noble et mondaine, elle développe une réputation de réformiste sociale ; Elle crée plusieurs associations et une école technique, montant même un hôpital dans l’un de ses châteaux, celui de Dunrobin, « pour les petits malades de ses terres » (page IX). S’impliquant dans la guerre, elle relate son épopée sanitaire entre le 8 août et le 18 septembre 1914 avant de rentrer en Angleterre où elle épouse, le mois suivant, Percy Desmond Fizgerald, major au 11ème régiment de Hussards, devant Lady Millicent Fitzgerald. Elle en divorcera en 1919 pour se marier, en octobre, avec le lieutenant-colonel George Hawes. Homosexuel, elle divorce une nouvelle fois en 1925. Après son épopée belge, elle revient en France et crée, à l’été 1915, l’hôpital militaire de Bourbourg, à quelques kilomètres de Dunkerque. Voyageuse, elle vit un temps en France. Au cours de sa vie, elle écrit 7 ouvrages, romans, nouvelles, pièce de théâtre, dont Six Weeks at the War, en 1915, qu’elle autorisera à traduire en français pour la prestigieuse collection La guerre – les récits des témoins de la Librairie Militaire Berger-Levrault l’année suivante. Elle est aux Etats-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale et revient à Paris en 1945. Elle décède le 20 août 1955 à Orriule, dans les Pyrénées-Atlantiques, après une vie aussi riche qu’extraordinaire.
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Parcours suivi par Millicent Fanny-Saint-Clair-Erskine : Angleterre – Boulogne (8 août 1915) – Paris (9 août) – frontière belge – Bruxelles (17 août) – Charleroi – Moustier -Namur (14 août) – voyage Namur – Binche – Mons (5 septembre) – Voyage en train par Charleroi (9 septembre) – Landelis – Thuin – Erquelinnes – à pied jusqu’à Maubeuge – en voiture depuis Maubeuge – Bavai (Bavay) – Valenciennes (11 septembre) – Tournai – Bruxelles – Namur – Liège – Visé – Eben-Emael – Maestricht (Maastricht) – Utrecht – La Haye – Rotterdam – Fluching (18 septembre)
Page 3 : Potage Maggie
: Londres-Paris, 15 heures le 8 août 1914
: Couvre-feu
: Rue François 1er, siège de la Croix Rouge
: Autorisation par Messimy
6 : Barricades sur les routes belges : «Faites de cars culbutés, d’arbres et de branches destinées à ralentir la marche des automobiles allant à une trop grande vitesse»
7 : Nom des forts de Namur : Suarlée, Emines, Cognelée (au nord), Marchovelette, Maizerat, Andoy (à l’est), Dave, Saint-Héribert (au sud) et Malomme (à l’ouest)
9 : Boy-scouts
11 : Femmes allemandes belliqueuses envers les déplacés
: Confusion entre allemands et britanniques du fait de l’uniforme kaki (vap 69)
17 : Taube appelé « frelon de l’enfer »
21 : Effectif des Sœurs de Notre-Dame : 4 000 pour 41 couvents en Belgique, 72 en Amérique, 19 en Grande-Bretagne, 2 au Congo belge, 2 en Rhodésie et 1 dans l’Etat libre d’Orange
22 : 23 août 45 premiers blessés belges et français. Eclats d’obus rarement mortels s’ils sont pris à temps !
24 : Armes et munitions récupérées par les gendarmes belges
: Homme fou
25 : Entrée en ville des Allemands, soulagement paradoxal signifiant la fin des combats
: « Que pouvait faire ce brave petit peuple contre cette force ? »
: Enterre son revolver
27 : Comment tire le soldat allemand selon elle, le fusil sur la hanche
: Seconde ligne de soldats appelés « surveillants »
29 : L’ami de l’ordre, journal de Namur
31 : Utilisation massive des automobiles sanitaires et problème de l’essence
32 : Enigme de la chute rapide des forts et fuite du général belge Staff
: Vue du général von Bülow, anglophone, qui visite son ambulance
34 : « Les Flamands étaient bien amusants dans leurs efforts pour se faire comprendre de nous »
36 : Allemands sales et tatoués
: Proclamation multiples sur les murs, menaces diverses sur les populations
39 : Rumeurs sur l’utilisation anglaise des balles dum-dum
43 : Vol de livres à la bibliothèque de Louvain incendiée sous prétexte de sauvegarde
50 : Peur d’un officier allemand d’être rasé par un Belge
53 : Réservistes ayant leur arme chez eux, source de répression ou d’exactions allemandes
55 : Inscription sur les trains
56 : Vue et description de trains sanitaires
64 : Vue de tombes
65 : Vue d’inscriptions sur des canons
: Rumeur de canons de siège de 17 cm prépositionnés avant la guerre dans une usine allemande, bourrage de crâne
68 : « Il est vexant de constater comme un grand nombre d’officiers allemands parlent correctement le français, voire l’anglais. Je ne puis me défendre d’une certaine honte du fait qu’une notable proportion de nos soldats et marins ne parlent aucune langue étrangère »
72 : Vue des drapeaux belges dans Bruxelles que les Allemands n’ont pas eu le temps de faire enlever
76 : Vue de Jim Barnes, écrivain voyageur américain (1866-1936), utile pendant le voyage
82 : Vue de préparatif de guerre en Hollande
83 : Sur les espions en Hollande
Yann Prouillet – 25 juillet 2025
Dampierre, Jacques de (1874-1947)
Résumé de l’ouvrage :
Jacques de Dampierrre, Carnets de route de combattants allemands. Paris, Librairie Militaire Berger-Levrault, 1916, 182 pages.
L’ouvrage s’ouvre sous cette justification : « En confiant à un ancien élève de l’Ecole des Chartes [Jacques de Dampierre, archiviste-paléographe] le soin de publier intégralement quelques-uns des carnets de campagne trouvés sur les soldats allemands tués ou pris, le ministère de la Guerre a voulu montrer, une fois de plus, que ni l’armée ni la nation française n’avaient rien à craindre des jugements de l’Histoire. (…) La France a tenu à l’honneur de ne présenter au monde entier, sur ces événements historiques, que des données sobres mais exactes et des documents faciles à contrôler » (page V). Suit une longue introduction qui se veut tant justificative que méthodologique sur les supports analysés, leur rédaction mais surtout pour leur contenu à haute valeur documentaire, prenant toute précaution quant à leur traduction, « aussi rigoureuse que possible » et à la signification, directe ou induite, de leur contenu. L’autre précaution avance : « Après quelque hésitation, l’on s’est déterminé à ne pas imprimer le nom même des signataires de ces carnets, pour des raisons de délicatesse morale que la critique allemande nous reprochera sans doute, mais que les honnêtes gens apprécieront. Parmi ces signataires en effet d’aucuns sont morts, et notre scrupule de publication intégrale, sans aucune coupure, pourra livrer au public des sentiments de famille qui doivent se couvrir de l’anonymat. D’autres sont vivants, et certaines critiques un peu vives des actes de leurs chefs risqueraient de procurer un jour des sévices immérités à ces hommes sincères. Quant à ceux qui ont agi et parlé en véritables criminels, le plus souvent justice est faite et leur nom n’ajouterait rien à l’Histoire » (page IX). De fait, chacun des trois carnets dont la reproduction suit, s’il est correctement identifié quant à l’unité, ne permet pas à priori de retrouver les signataires. La suite de l’introduction donne des informations méthodologique (choix des textes publiés, organisation et terminologie de l’armée allemande, etc.) et les carnets reproduits sont complétés de très nombreuses notes, opportunes, confirmatives du parcours géographique des soldats, explicatives ou reproduisant les expressions dans leur langue d’origine. Toutefois, l’ouvrage reste résolument un outil, construit et d’apparence scientifique, de propagande, présenté par un spécialiste en la matière (voir sa biographie). En dénote une des notes finales, instructives sur l’état d’esprit sociologique du présentateur quant à la mentalité allemande. Il dit, relativement à la gourmandise du fusilier : « … elle est caractéristique d’une âme simple, aux instincts frustes et au tempérament passif. On sait que les animaux voraces sont les plus faciles à dresser ; il se pourrait que, dans l’espèce humaine, des appétits matériels très développés s’accordassent tout particulièrement bien avec les exigences d’un discipline irréfléchie » (page 169).
Pages 1 à 71 : Journal de campagne d’un officier saxon, 8ème compagnie du 178ème d’infanterie ou 13ème saxon qui tenait garnison à Kamenz (40 kilomètres au nord-est de Dresde). Il formait avec le 177ème (ou 12ème saxon) la 64ème brigade de la 32ème division du XIIème corps d’armée. Carnet relié en moleskine noire de 4,5×8,5 cm de 95 feuillets non paginés, dont 60 écrits en caractères romains au crayon de fuchsine. Les planches 2 et 3 reproduisent la couverture et une page de ces carnets. Il comprend la période du 6 août au 25 septembre 1914. Le parcours résumé de l’officier est le suivant :
En Allemagne : Kamenz – Ouren (vallée de l’Our) (6-10 août)
Au Luxembourg : Weisswampach (10 août)
En Belgique : Deyfeld – Wibrin – Achêne – Ferme Salazinne – Lisigne – Sorinnes (et non Dorinnes) – Dinant – Morville – Nismes – Couvin – Brûly (10 – 26 août).
En France : Gué-d’Hossus – Marlemont – Signy-l’Abbaye – Launois-sur-Vence (baptême du feu) – Faux – Rethel – Juniville – Tours-sur-Marne – Jâlons – Villeseneux – Normée – Euvy – (retraite après La Marne) – Châlons-en-Champagne – Saint-Etienne-au-Temple – Mourmelon-le-Petit – Vaudesincourt – Boult – Aménancourt – Pontgivard – La Ville-au-Bois-lès-Pontavert – Juvincourt-et-Damary – Amifontaine (27 août – fin 25 septembre 1914). L’officier meurt le 25 septembre lors d’un assaut français dans une tranchée près de La Ville-au-Bois-lès-Pontavert.
Pages 73 à 146 : Journal de campagne d’un sous-officier de Landwehr de la 9ème compagnie du 46ème régiment de Réserve qui tenait garnison à Posen (aujourd’hui à Poznan) (1er bataillon), Samter (aujourd’hui Szamotuły) (2ème) et Neutomischel (aujourd’hui Nowy Tomyśl) (3ème, son bataillon) tous trois aujourd’hui en Pologne. Il fait partie du Vème corps d’armée de réserve. Il semble parler assez le français pour indiquer qu’il sert d’interprète avec le maire de Meix-le-Tige pour réquisitionner de l’avoine (page 93). Il devient sous-officier et change alors de compagnie (page 105). Le témoignage est composé de deux carnets ; l’un de 8,9 par 14,3 cm de 57 feuillets en caractères gothiques eu crayon noir ou fuchsine. Il contient les dates du 5 août au 13 octobre 1914. Le deuxième mesure 10,2×16,5 cm de 19 pages renseignées du 14 octobre au 22 novembre 1914. Le parcours résumé du sous-officier est le suivant :
En Pologne allemande (11 août) : Neutomischel
Allemagne (11 août) : Saxe – Bavière – Mannheim – Duppenweiler – Neunkirchen – Gauwies.
Luxembourg (19 août) : Bettenbourg – Meudelange – Bretrange – Mamer – Steinfort.
Belgique (22 août) : Arlon – Châtillon – Saint-Léger – Meix-le-Tige – Messancy.
France (30 août) : Longuyon – Romagne-sous-les-Côtes – Gercourt – Consenvoye – Damvillers – Romagne-sous-les-Côtes – Mangiennes – Billy – Haut-Fourneau – Maucourt-sur-Orne – Cote 246 – Ferme de la Gélinerie – Ornes (fin 22 novembre 1914).
Pages 147 à 173 : Journal de campagne d’un Réserviste Saxon de la 6ème compagnie du 179ème I.R. (14ème saxon), 6ème compagnie qui tenait garnison à Wurzsen en Saxe. Il formait avec le 139ème I.R. (11ème saxon) (Dölben) la 47ème brigade d’infanterie de la 24ème division du XIXème Corps d’Armée. Le témoignage est composé d’un petit carnet de 148×75 mm intitulé Merkbuch (carnet de note) de 30 feuillets écrits en crayon noir ou fuchsine renseignés du 4 août au 18 septembre inclus. Le parcours, heureusement aidé par le présentateur car moins précis que les deux précédents témoins, résumé du sous-officier est le suivant :
Allemagne (4 août) : Leisnig (entre Leipzig et Dresde par Döbeln) – Engelsdorf – Apolda – Hersfeld-les-Bains – Elm – Hanau – Francfort-sur-le-Main – Untersalm – Rüdesheim – Coodel – Wolsfeld – Neuerburg
Luxembourg (10 août) : Medernach – Aeselborn
Belgigue (18 août) : Bastogne – Ambly – Forrière – Rochefort – Mont-Gauthier – Bourseigne-Neuve
France (23 août) : Secteur Hargnies – Lametz – Machault – Mourmelon-le-Grand (8 septembre – blessé, prisonnier à Vitry-la-Ville) – Châlons-sur-Marne – Saint-Ouen – Chavanges – Chaumont – Jessains – Clairvaux (hôpital) (fin 19 septembre 1914).
Eléments biographiques sur le présentateur :
Né le 13 octobre 1874 au Louroux-Béconnais (Maine-et-Loire), Michel Marie Jacques, comte de Dampierre dit Jacques I est le fils d’Aymar de Dampierre et d’Isabelle de Lamoricière. De son mariage en 1899 avec Françoise de Fraguier (1875-1959), il aura trois enfants, Henry (1901-1964), Armand (1902-1944) et Jacques-Audoin, dit Jacques II (1905-1996), et 4 petites-filles.
Il entre à l’École des Chartes en 1896 et en sort premier avec une thèse intitulée « Les Antilles françaises avant Colbert. Les sources, les origines », éditée en 1904 dans la collection des mémoires et documents de la Société de l’Ecole des Chartes, sous le titre Essai sur les sources de l’histoire des Antilles françaises (1492-1664). Il participe aux Sources inédites de l’histoire du Maroc, en collaboration avec le lieutenant-colonel de Castries, son père adoptif, et publie les Mémoires de son arrière-grand-oncle, François Barthélémy (1747-1830). Exempté du service militaire, Jacques de Dampierre se met cependant, dès le 2 octobre 1914, à la disposition du gouvernement pour la propagande française à l’étranger. Il signale bientôt au ministère des Affaires étrangères la nécessité d’une action habile en cette matière auprès des pays neutres, alors hésitants. D’octobre à décembre 1914, il dépouille les carnets et autres papiers pris sur les combattants allemands et en tire la documentation utilisée par le ministère des Affaires étrangères pour ses premiers tracts de propagande. Il suggère la formation parallèle du Comité de propagande catholique à l’étranger. En 1915-1916, le marquis de Dampierre poursuit ses travaux et concourt à la documentation de nombreux publicistes étrangers, anglais, hollandais et américains. A la demande des Affaires étrangères, il publie L’Allemagne et le droit des gens, ouvrage qui dénonce les exactions commises par l’armée allemande et qui, traduit en anglais, aura une influence considérable sur l’opinion publique des États-Unis en faveur de la France. Son volume des Carnets de route de combattants allemands est combattu par la propagande allemande. Au printemps 1916, Jacques de Dampierre est chargé d’organiser une association de propagande intellectuelle à l’étranger, le Comité du livre. Il en devient secrétaire général et il est l’un des principaux organisateurs du Congrès du livre, en mars 1917, à Paris. Ayant été particulièrement mêlé aux débuts de l’alliance américaine, c’est à lui qu’échoit, le 4 juillet 1917, l’honneur d’haranguer officiellement en anglais, dans la cour des Invalides, au nom de la France, et en présence des membres du gouvernement français, le général Pershing arrivant à Paris avec les premiers bataillons américains.
Après 1918, le marquis de Dampierre prend une part de plus en plus active aux travaux de l’Union des grandes associations contre la propagande ennemie, du Comité de la Rive gauche du Rhin et de diverses autres organisations de défense des intérêts français auprès des alliés. Il est l’un des rapporteurs du Congrès national français, qui a été institué lors de l’armistice pour soutenir le droit de la France aux « réparations, restitutions et garanties ».
Créateur de la Fondation Richelieu pour l’histoire des activités françaises hors de France, Jacques de Dampierre publie de 1918 à 1930 l’Annuaire général de la France et de l’étranger, publication comparable à l’Almanach du Gotha et au Statesman year book. Il rend compte d’une enquête officielle menée à partir de 1937 dans les Publications officielles des pouvoirs publics, en vue d’établir un Répertoire des publications officielles françaises. Chargé par le ministère de la Production industrielle de soumettre au gouvernement un projet de mesures pour l’organisation scientifique du travail dans les administrations publiques par une coordination des archives, bibliothèques et centres de documentation et de recherche ressortissant aux différents départements ministériels, le marquis de Dampierre préside aussi la Société d’information documentaire et les comités directeurs de l’Agence française de normalisation (AFNOR) et de l’Union française des organismes de documentation (UFOD).
Angevin de naissance, de famille et de vie, Jacques de Dampierre est conseiller général du canton du Louroux-Béconnais, pendant quinze ans conseiller municipal et pendant sept ans maire de la commune de Villemoisan. Membre actif de nombreuses associations angevines, il devient avant 1914 l’un des collaborateurs du banquier angevin Georges Bougère et se fait apprécier, tant à Angers que dans le département de Maine-et-Loire, par de nombreuses conférences, notamment pour la Société de secours aux Blessés militaires, dont la présidente a été sa mère, Isabelle de Lamoricière de Castries, et pour laquelle sa femme, Françoise Fraguier de Dampierre, est, pendant la Première Guerre mondiale, infirmière dans les hôpitaux d’Angers. Jacques de Dampierre s’intéresse également aux petites industries rurales. Membre du Conseil de la Société centrale d’aviculture de France, il fonde la Société des aviculteurs angevins, dont, avant la guerre de 1914-1918, les expositions sont les plus importantes de France, après celles de Paris.
Jacques de Dampierre meurt à Paris le 16 mars 1947. (Notice biographique réalisée par compilation de plusieurs nogénéalogies disponibles sur Internet)
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Nonobstant le caractère volontairement anonyme de la retranscription, très profondément présentée et annotée, ces trois documents apportent une foultitude d’informations sur la mobilisation, la traversée des pays (Allemagne, Luxembourg, Belgique), avec des description anthropologiques (voir pages 115 ou 116) et les combats, mais aussi les exactions et actions militaires qui émaillent les parcours comme les localités occupées.
Page 11 : « Leçon de français aux sous-officiers et autres intéressés »
12 : Pillages ; « notre landwehr s’est comportée comme des vandales » (vap 22)
13 : Note sur les Fusslappen : Les fantassins allemands remplacent la chaussette par un linge carré dont ils s’enveloppent le pied
15 : Coupe-fils sur les véhicules d’états-majors
16 : Ennemi (français) tirant trop haut
20 : Francs-tireurs fusillés (16), comment (vap 22), pertes, incendies
31 : Sur le massacre des civils, incendie des villages, exactions
34 : Coup de feu fantôme
35 : Sur l’utilisation du terrain
37 : Camouflage des turcos
40 : Supériorité de l’artillerie française
43 : Incendie de Rethel et pillage, il y participe (vap 125, 126, 159, scrupule à piller)
50 : Bière Pilsen
57 : Ordre de retraite allemand
58 : Réalité de creusement dans la retraite
61 : Description du camp de Mourmelon
65 : « Les Français sont passés maîtres dans le combat de rues, comme du reste dans tous les genres de combats où il est possible de tirer à couvert »
79 : Sur les pattes d’épaules allemandes camouflées par ordre
81 : « … nous ne sommes tous maintenant rien d’autre que des concessionnaires du meurtre »
82 : Phrase prémonitoire : « Le vaincu s’en retournera avec rien, le vainqueur avec des décombres »
: Sur la différence d’emplacement des tas de fumier (en cour chez les Allemands, devant la maison chez les Français), culture posnanienne
85 : Impression sur le bourrage de crâne (vap 89)
: Note sur les déserteurs posnaniens qui ne veulent pas combattre contre la France, championne des libertés polonaises (vap 100)
87 : Espion français à boule lumineuse (vap 88 fusillé)
88 : Sur les conséquences du chemisage de cuivre des balles françaises : « Les projectiles français ont une surface extérieure cuivrée, ce qui amène souvent dans les blessures de la suppuration ; nos cartouches d’infanterie sont à ce point plus aimables »
92 : Entraînement au tir sur des mannequins avec système de comptage de points (buts)
95 : Tirs amis (vap 136)
99 : Brimades, injures et punitions (vap 120)
101 : Obus aveugles = qui n’éclatent pas, ou pas tout de suite
109 : Pillage
116 : Population meusienne composée de vieilles gens débiles
122 : Biergarten, jardins de bière, équivalent des guinguettes
123 : Cantines roulantes (assez cher) et postes aux Armées, solde par grades
134 : Construction au Haut Fourneau d’une voie ferrée pour transporter les gros « bourdons », Brummer, surnom du 420 mm (42 cm) (batterie de Duzey ?)
165 : Rêve de fine blessure (hôpital)
166 : Blessé, prisonnier, premier contact avec les Français
167 : Récupération de trophées sur les prisonniers allemands : boutons, pattes d’épaules, casques, cocardes
: Miction
Yann Prouillet, 22 juillet 2025