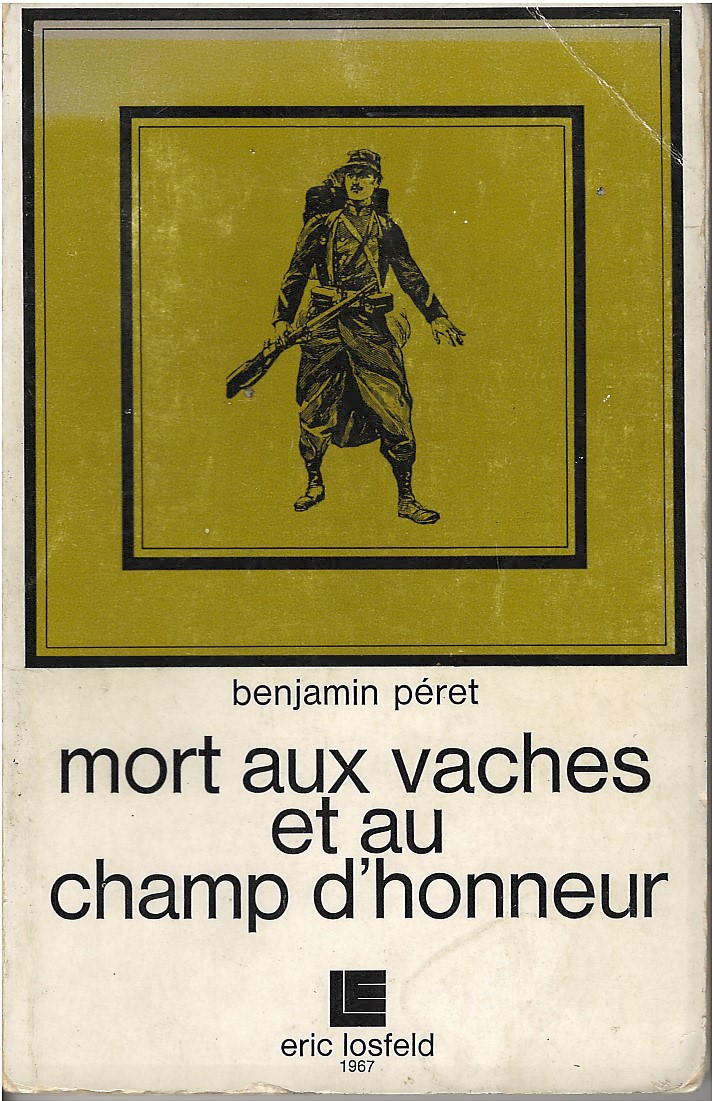Curé de campagne, Paris, La France retrouvée, 281 p.
Résumé de l’ouvrage :
A 93 ans, Alphonse Haensler se penche sur son passé et se souvient de l’ensemble de sa vie et de son parcours religieux, exercé dans les Vosges. Ordonné prêtre le 1er juin 1912, il est mobilisé dans la Grande Guerre comme brancardier divisionnaire à Nancy. Occupé d’abord dans le secteur de Lunéville à la sanitarisation du front, il attrape la paratyphoïde à Bray-sur-Somme, qui l’éloigne de la première ligne. Après sa convalescence, et avouant un certain ennui à l’arrière, il demande à rejoindre le front et est affecté à l’hôpital de Neufchâteau. Il reçoit dans toute leur horreur les blessés du Bois-le-Prêtre ou des Eparges mais en janvier 1916, la Loi Dalbiez l’oblige à se porter volontaire comme brancardier régimentaire au 79e RI où son frère est déjà aumônier. Il connaît l’enfer de Verdun et traverse finalement l’ensemble du conflit en échappant à plusieurs reprises à la mort, nourrissant quelque peu le sentiment d’avoir été protégé, notamment par sa foi. Démobilisé en mars 1919 ; il regagne Thaon-les-Vosges où il avait été affecté comme vicaire juste avant la déclaration de guerre. Sa carrière comme prêtre se poursuit dans différentes petites communes vosgiennes, « vieux pays chrétien », jusqu‘à son entrée en 1968 à la maison de retraite de Docelles.
Eléments biographiques
Le 20 avril 1885 à Mont-lès-Neufchâteau (Vosges), Alphonse Haensler naît dans une famille militaire et paysanne d’origine alsacienne de trois enfants. Son père, dont la famille est de Dambach près de Sélestat, optant, est militaire, affecté à la surveillance du fort de Bourlémont, près de Neufchâteau. Il mourra le 7 novembre 1939. Sa mère, François Clog, épousée en 1884, (morte quant à elle le 14 novembre 1944) est très pieuse. De fait, il cultive très tôt, comme son frère, Eugène, son aîné d’une année (qui mourra le 30 octobre 1930 des suites de gazage au front), une vocation de religieux. Il entre à 15 ans au Petit séminaire de Châtel-sur-Moselle, puis celui d’Autrey, en classe de troisième, en 1902, fait son service militaire en 1905 au 79e RI de Nancy dans un climat particulièrement anticlérical. « L’hostilité était manifeste, les plaisanteries fusaient » (page 74). Il entre en octobre de la même année au Grand séminaire de Saint-Dié et est enfin ordonné prêtre le 1er juin 1912. Le 12, il est un temps vicaire à la basilique du Bois Chenu de Domrémy puis à Thaon-les-Vosges. C’est là que la guerre vient le chercher pour quatre années. Retourné à sa cure en mars 1919, il intègre enfin comme prêtre le petit village de Mortagne en 1927 puis celui d’Housseras en 1930. En pleine Seconde Guerre mondiale, en 1944, il est affecté dans la commune de Bellefontaine puis passe aumônier au couvent des Rouceux, près de Neufchâteau, l’année suivante. En 1948, il est nommé aumônier à l’hôpital d’Epinal. Après une longue vie sacerdotale, il entre à la maison de retraite de Docelles en septembre 1968. Le 2 octobre 1977, il reçoit la Légion d’Honneur et meurt à Saint-Dié-des-Vosges le 20 août 1986 à l’âge de 101 ans.
Commentaires sur l’ouvrage :
La guerre de l’abbé Alphonse Haensler ne représente que 16 pages sur une longue autobiographie de 192 pages. Mais l’intérêt de son témoignage est manifeste : il est particulièrement disert tant sur son métier que sur toutes ses implications, morales comme politiques. En cela le témoignage est précieux car le curé de campagne vosgien n’élude que très peu des sujets qui permettent tant une analyse psychologique que sociologique voire pratique du personnage, qui de plus fait montre d’une fibre politique (il dit page 189 : « Je me sens pleinement socialiste ») marquée, et de sa fonction dans le monde rural sur près d’un siècle, de 1888 à la fin des années 1970. Le 25 juillet 1914, il part en vacances en Alsace avec son frère, alors vicaire à Remiremont. Il y constate la préparation de guerre de l’Allemagne, qui l’impressionne, et rentre pour recevoir, à 2 heures du matin, son ordre de mobilisation. Patriote, il dit : « Nous n’avions qu’une peur : arriver à Nancy après les Allemands » (page 126) mais lucide sur le bellicisme s’appropriant la religion, le « Dieu est avec nous » répondant au « Gott mit uns », il ajoute : « Monstrueuse supercherie, escroquerie sans nom que de s’approprier le Ciel ! » (page 128). La guerre déclarée, il dit : « En tant que prêtre, il n’était pas question de porter les armes. J’avais été rappelé comme brancardier à la 11ème division de Nancy, où j’ai troqué ma soutane contre l’uniforme » (Page 129). Il est immédiatement confronté au vrai visage de la guerre. Il dit « : J’ai découvert l’horreur et l’impuissance, la douleur et la mort » (page 130). Les conditions de vie des premiers mois de guerre et sa fonction de brancardier le font finalement contracter, à Bray-sur-Somme, une paratyphoïde qui manque de le tuer (il réclame même l’extrême onction). Finalement sauvé, il entre en convalescence dans une clinique de Salins-en-Béarn, près de Pau, puis sur Troyes. Honnête, il dit : « J’aurais peut-être pu jouer les planqués jusqu’à la fin de la guerre, mais au bout de quelques mois, j’en avais assez, je m’ennuyais ferme, et par-dessus tout, je ne voulais pas prêter le flanc à la critique. J’ai demandé à être envoyé quelque part et reversé dans l’active » (page 132). Il est donc réaffecté comme infirmier à l’hôpital de Neufchâteau où il reçoit les blessés du Bois-le-Prêtre ou des Eparges. Se succèdent alors tableaux et visions d’horreur, assistant de chirurgien amputant « à tour de bras », s’endurcissant devant l’attitude, protéiforme, des hommes confrontés à la souffrance et à la mort. Le 4 juin 1915, la Loi Dalbiez le menaçant d’être obligé de « prendre le fusil », et entendant « rester fidèle au « Tu ne tueras point » », il demande à partir en première ligne comme brancardier. En mars 1916, il rejoint le front de Verdun et son frère, aumônier au 7-9. Immédiatement il est en pleine fournaise et s’interroge, entre chance et protection divine, lorsqu’un obus n’éclate pas entre eux deux ou quand il échappe aux balles en juin 1917. Voyant se succéder à son endroit ce type de miracle, il en nourrit une conviction qu’avec l’aide du Sacré-Cœur, il bénéficie en effet d’une protection divine. Il dit : « Dans cet enfer quotidien, je priais Dieu, et de toute la guerre, je n’ai jamais eu peur. J’avais le sentiment que Dieu me protégeait, qu’il ne m’arriverait rien » (page 138) ou plus loin, alors qu’une de ses messes est bombardée, il prie en disant « Pas maintenant seigneur » ! (page 141). Non combattant, il reçoit pourtant en juillet 1916 dans la Somme la Médaille militaire après avoir, brandissant le fanion du Sacré-Cœur, entraîné les hommes à l’attaque. L’arrêt des combats le cueille à Hirson, à la frontière belge : « … nous étions tous fous de joie, on s’embrassait comme des gosses, ivres de bonheur. C’en était donc enfin fini des balles, des obus, du cortège des blessés et des morts, du froid, de la boue, de l’horreur. Subitement, le silence s’est installé sur tous les fronts et il a fallu du temps pour s’habituer » (page 141). Il est démobilisé à Nancy en mars 1919. Dans son ministère d’après-guerre, celle-ci reste source d’inspiration : « J’avais mis sur pied une troupe de théâtre dont le répertoire était souvent puisé dans le registre patriotique de la Grande Guerre » (page 144). Sa guerre, courte mais dense, contient peu de précisions et quelques erreurs toponymiques (Arancourt pour Arracourt, page 130 ou place Hirson sur la côte belge, page 141). Le reste du témoignage, rédigé en toutes connaissances de cause, Haensler citant Bernanos et son Journal d’un curé de campagne, conserve un caractère référentiel sur la diversité des sujets touchant à un ministère de prêtre, avant et après la Grande Guerre, sa psychologie et sa matérialité dans le monde politique comme dans son évolution dans une société connaissant elle-même de profonds bouleversements sociologiques. Ce témoignage possède également un indéniable intérêt anthropologique, distillant anecdotes sur les us, coutumes, légendes et quotidienneté, entrant dans le paradigme des Arts et Traditions Populaires, y compris pour le vocabulaire. Il ne manque pas non plus d’humour (notre témoin n’hésitant pas à évoquer qui s’est endormi lors d’une confession !) et décrit même l’économie de son métier. C’est aussi un témoignage autoanalysé de la fonction « politique » du prêtre, entre loi séparative, anticléricalisme, communisme, tant Haensler n’hésite pas à s’aventurer sur le terrain politique quand la nécessite, notamment communale, s’impose. L’ouvrage se termine par une longue analyse chiffrée des prêtres et de l’église dans le temps du témoignage du curé Haensler par Julien Potel, membre de l’association française de Sociologie religieuse et Roger H. Guerrand, chargé de cours à l’EHESS. Cet appendice permet de densifier le témoignage sur des concepts, (hydre du modernisme, du presbytère à l’usine), des chiffres (le diocèse et les inventaires, les curés sacs au dos morts dans la Grande Guerre, le nombre de prêtres en fonctions des époques, la loi de séparation de 1905)) ou des notions (le mythe du bon curé, etc.).
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Page 20 : Réflexion sur la sexualité et son évolution sociétale (vap 163 sur la tentation des jeunes filles, traumatisme du curé d’Uruffe ou par le défroquage de celui d’Housseras)
107 : Nom des différentes prières de la journée
121 : Rétribution des prêtres en 1912, prix des meubles
124 : Est en Alsace fin juillet 1914, vision de l’armée allemande prête à envahir la France, « magnifiquement équipée »
130 : Décrit la réalisation d’une fosse commune : « … pour qu’ils tiennent moins de place, j’ai dû les ranger dans une grande fosse commune de quatre mètres de profondeur, j’y suis descendu les coucher les uns à côté des autres, leur mettre la capote sur la tête et passer à un autre rang »
132 : Horreur des blessés du Bois-le-Prêtre puis des Eparges, dégoût et foi vacillante, puis finit par s’endurcir
133 : Attitude et diversité des blessés
135 : Honte de la Loi Dalbiez, qui envoie les prêtres au front
136 : Tu ne tueras point est un problème en guerre
138 : Horreur d’un pilote d’avion abattu, description du corps après sa chute
139 : Evoque Claire Ferchaud et le Sacré-Cœur de Jésus. Le 26ème RI de Nancy surnommé « régiment du Sacré-Cœur », retour à la foi
141 : Messe au front
145 : Après-guerre, invente un cerf-volant « de propagande » répandant des messages sur Thaon-les-Vosges
148 : Vin de messe venant de Bordeaux, vicaire de Saint-Dié assistant à la vendange
149 : Affaire du nom d’un voleur assassin donné par la victime mourante, problème du secret de la confession
155 : Affaire de l’empoigne, coutume locale des habitants de Mortagne
156 : Scandale des petites filles dénudées lors des visites médicales
182 : S’endort lors d’une confession !
186 : Location de chaises à l’église et les trois classes d’enterrement, inégalité
194 : Sur André Lorulot, libre-penseur et anarchiste contre qui s’est opposé Haensler (vap 261)
195 : 9 mai 1940, bombardement de Rambervillers
196 : Fidèle à, Pétain car ancien combattant de 14-18
198 : Son rôle pendant la 2ème Guerre mondiale, évoque la Résistance mais n’en fit apparemment pas partie
206 : Son hygiène de vie, sa longévité, ses jubilés
Yann Prouillet, août 2024
Péret, Benjamin (1899–1959)
Résumé de l’ouvrage :
Benjamin Péret, Mort aux vaches et au champ d’honneur, Paris, Eric Losfeld éditeur, 1967, 127 p.
Par sept chapitres de styles très différents, Benjamin Péret, chantre du surréalisme, dresse des tableaux divers mettant en espace et en mots des personnages loufoques, militaires comme politiques qui rêvent, discutent ou s’écrivent sur des sujets multiples, divers, sans débuts ni fins. A pieds joints est un dialogue entre deux personnages, La main dans la main est une suite de 249 phrases surréalistes, Ici l’on rase gratis est le verbatim d’un dialogue « entendu » « A la chambre des Députés ». Dans le 4ème chapitre Qui perd gagne, on retrouve un dialogue entre des personnages. Dans Les parasites voyagent, il s’agit de la relation d’un fait narré dans une langue mêlant idiotismes et argots débutant par la réception d’un éclat d’obus dans la tête. Mes belles histoires se suivent mais ne se ressemblent pas, sixième chapitre 6, reproduisent une suite de lettres à des personnages divers, dont des ministres. Le dernier chapitre, l’éléphant à billes, relate un épisode début dans un cinéma. Le tout a été écrit à l’hiver 1922-1923.
Commentaires sur l’ouvrage :
La biographie Wikipedienne Benjamin Péret — Wikipédia (wikipedia.org) de Benjamin Péret (Rezé, 4 juillet 1899 – Paris, 18 septembre 1959) indique que c’est sa mère qui le fait engager comme infirmier pendant la Grande Guerre mais on ne connaît pas son parcours exact dans le conflit. L’auteur est en fait résolument un surréaliste du milieu dadaïste, participant au procès de Maurice Barrès en y tenant le rôle du Soldat Inconnu. L’édition de 1967, par Eric Losfeld éditeur, de ce « Mort aux vaches et au champ d’honneur » étudiée ici est le modèle d’un ouvrage évoquant, doublement, dès la couverture un livre traitant de la Première Guerre mondiale tant par le titre que par l’image, représentant un piou-piou de 1914, le Lebel à la main, à l’allure déterminée. Pourtant, s’agissant d’un opuscule purement surréaliste, même si écrit à l’immédiat après-guerre, peu de références à celles-ci sont présentes dans l’ouvrage, n’en atteignant nullement le statut de témoignage. Si Poincaré (p. 14) et le général Pau (p. 82), « Gros doré » sont convoqués dans cette suite loufoque, si Péret rend hommage aux « services rendus au pays par la bicyclette-boomerang dans la guerre mondiale. Il est incontestable que l’adjonction d’un boomerang au guidon de la bicyclette a rendu de grands services, puisque le cycliste bien lancé n’avait plus à faire aucun effort pour revenir à son point de départ, ce qui a évité à un grand nombre de soldats d’être capturés par l’ennemi » (p. 62), si la lettre de Lohengrin à Mlle Demolie rappelle qu’ « en temps de guerre (…) l’assassinat est non seulement toléré, mais encouragé et glorifié sous le nom d’exploit héroïque » (pp. 99-100), l’ouvrage est fidèle à son genre, qui semble avoir été écrit sous substance. Ce livre, à la lecture parfaitement inutile à l’Historien, apparaît comme une suite sans queue ni tête d’un verbiage abscons, propre à lui-même, sur fond d’une Grande Guerre dont le filigrane léger a peut-être une influence sur un contenu à décrypter. A réserver aux affidés du genre.
Yann Prouillet – juin 2024
Prévot, Jean 1890 – 1960
Soissonnais 14 – 18, Germaine Servettaz, Claude Lavedrine et Hervé Vatel (éd.), Les Carnets d’un ambulancier et pharmacien. (De la bataille de Quennevières aux combats du Soissonnais 1915 – 1918), Paris, Éditions des Équateurs, 2007, 317 pages.
1. Le témoin
Jean Prévot est né à Montauban en 1890. Bachelier en 1908, la guerre le trouve à Bordeaux alors qu’il n’a pas encore terminé ses études de pharmacie. Incorporé au 108e RI de Bergerac, et passé dans une section d’infirmiers non endivisionnée en janvier 1915, il est transféré en avril 1915 à l’ambulance 4 de la 37ème DI, division composée de régiments de tirailleurs et de zouaves. Il est au front ou dans la zone des étapes d’avril 1915 à septembre 1918. Revenu à la vie civile, il exerce les fonctions de pharmacien à Toulouse, Carcassonne et Lautrec. Il décède à Orléans en 1960.
2. Le témoignage
Les Carnets d’un ambulancier et pharmacien (« De la bataille de Quennevières aux combats du Soissonnais 1915 – 1918») ont été publiés en 2007 par Germaine Servettaz, Claude Lavedrine et Hervé Vatel, en association avec l’association « Soissonnais 14 – 18 » aux éditions des Équateurs (317 pages). C’est à Orléans, dans la maison où est décédé Jean Prévot (ne pas confondre avec Jean Prévost, écrivain et journaliste mort en 1944 au Maquis), « qu’en 1970 son petit-fils Marc retrouvera intacts dans une malle entreposée dans le grenier les carnets écrits par son grand-père. » (p. 11). L’introduction de G. Servettaz montre l’importance de la transmission mémorielle, avec un voyage fait par les transcripteurs de l’ouvrage sur les lieux évoqués par l’auteur, et notamment la ferme-ambulance 4/37. À noter une ambiguïté p. 11 « il est nommé 1re classe de réserve le 9 juillet 1919 », c’est bien-sûr aide-major (pharmacien) de 1ère classe, c’est-à-dire l’équivalent du grade de lieutenant.
3. Analyse
Février 1915 – mars 1916 – infirmier à l’ambulance
Il s’agit de la partie la plus intéressante des carnets, car c’est là que J. Prévôt est le plus disert quand il évoque avec précision ses fonctions d’infirmier dans une ambulance (hôpital de campagne). Jeune étudiant, il n’a pas été reconnu pharmacien dans cette spécialité car son cursus est incomplet, mais cet état lui permet d’échapper à son régiment en janvier 1915 (passage à la 12e section d’infirmier) puis d’intégrer l’ambulance 4/37. Il mentionne ses tentatives infructueuses pour se faire reconnaître comme pharmacien [avec autorisation de citation] (p. 29) « non, des pharmaciens, on en a, à ne savoir qu’en faire ! ». Pour lui cette affectation non enrégimentées est tout de même appréciable, en témoigne cette menace affichée à la 12e section d’infirmiers (avril 1915) : « Tout absent à deux appels : versé dans l’infanterie. » Les carnets décrivent le quotidien des gardes d’infirmier, dans une ambulance proche des lignes ; elle reçoit en 1915 des blessés du secteur de Quennevières (Offémont, Oise). La force de ces mentions, qui rappellent le Georges Duhamel de 1917, est faite d’un mélange de description des blessés, d’évocation de leurs souffrances, avec un ton détaché et neutre, sans empathie particulière, une sorte de froideur clinique qui renforce la dureté de la perception. Ainsi par exemple en avril 1915 (p.53) : « La salle 5 (12 lits) est à moitié pleine de types plus ou moins amochés. (…) On a amené trois Boches blessés. En voici un des plus amochés, pieds broyés, les fesses emportés par les obus. Il n’y a pas moyen de le prendre et après un pansement on le laisse sur son brancard et on le met tel quel sur le lit. La plupart sont blessés à la tête. On ne voit point de figure. On n’entend que des corps qui gémissent et se plaignent des cris du blessé : à boire. Le premier en entrant à droite est déjà mort, les traits calmes comme s’il dormait encore. Au fond un zouave râle, il a une fracture du crâne et ne va pas tarder lui non plus à entrer dans le grand sommeil. » L’auteur est souvent acerbe à propos des talents médicaux des majors, sans qu’il soit possible de savoir si c’est vraiment justifié (p. 58) « Le type à la fracture du crâne qui était dans la tente de la cour et qui râlait depuis hier est mort sur la table d’opération. Jocaveille en sortant de la salle était tout souriant. Ce matin Deveze a amputé le zouave d’hier soir arrivé avec l’hémorragie du bras, il va parfois un peu vite en besogne. » L’auteur évoque p. 73 « un sidi gratifié d’une balle dans la tête, on ne l’a guère regardé. Tout n’est certes pas pour le mieux, et que dire ? » Rien ne permet ici de dire que les blessés sont moins bien soignés parce qu’ils sont indigènes, il s’agit plutôt d’un doute sur les compétences professionnelles de certains majors, dont certains s’improvisent chirurgiens. L’auteur mentionne souvent le fait que lorsque c’est son tour de repos, il ne peut dormir et récupérer à cause des cris persistants des blessés. Ainsi p. 73 « On apporte un tirailleur gravement atteint d’un éclat dans le dos. Le major dit que l’on pourra lui donner à boire ce qu’il voudra, ce qui est sa condamnation sans plus de phrase. Il se voit perdu; d’ailleurs en arrivant dans la salle il se met à hurler et ne cesse guère ce qui m’ôte toute envie de dormir. (…) Bordes vient lui faire une injection de morphine, cela le calme un peu mais point complètement cependant. Quand à minuit Béneyssie vient me réveiller, je n’ai pas encore pu fermer l’œil. » Ces carnets restituent bien la lourde ambiance régnant à l’ambulance lorsque le front est actif, et que des blessés, souvent gravement atteints, sont amenés avant transfert, opération sur place, ou pour attendre le décès si on estime le cas sans espoir.
L’auteur signale plus loin la lecture d’un ordre général (27 avril 1915, p. 66) qui mentionne la citation octroyée à une autre ambulance, puis la liste de soldats qui ont été fusillés, la plupart pour abandon de poste, « quelques-uns pour mutilation volontaire, des tirailleurs surtout. »
J. Prévôt évoque ensuite la bataille de Quennevières (Moulin-sous-Touvent, juin 1915) telle qu’elle est perçue par une ambulance proche du front ; il mentionne les récits et bruits rapportés de la première ligne, par exemple le 1er juin, des affiches allemandes demandent si l’attaque « est pour aujourd’hui ? » (p. 95), ou des ordres de ne pas faire de prisonniers (p. 103), mention relativisée par la mention récurrente d’arrivées de prisonniers allemands. L’activité est éreintante, avec un bombardement qui n’épargne pas les abords de l’ambulance, des blessés nombreux, et des prisonniers allemands souvent blessés eux-aussi. A la fin de la bataille (recul français 15 et 16 juin 1915) il mentionne (p. 117) « Le nombre de blessés entrés est de 357 pour les trois derniers jours dont 195 pour aujourd’hui. »
L’évocation de l’offensive de Champagne (octobre 1915) est beaucoup moins précise, l’auteur est plus à l’arrière, et c’est davantage un témoignage d’ambiance, nous « aurions » attaqué, il y « aurait » déjà deux régiments boches de prisonniers, etc…
Mars 1916 – septembre 1916 – pharmacien auxiliaire – La Somme.
J. Prévot est nommé pharmacien auxiliaire, tout en restant simple soldat, il dépend alors du groupe de brancardiers de corps de la VIIIe Armée. À l’arrière du front, il s’occupe des médicaments, du chlore pour les exercices de gaz, et travaille aussi au laboratoire bactériologique. Sa localisation à Bar-le-Duc ne lui permet de décrire la bataille de Verdun que par ouï-dire. Il n’en est pas de même lorsqu’il arrive dans la bataille de la Somme (août 1916) : dans le secteur de Bouchavesnes, il fait sous le bombardement des liaisons avec les postes de santé avancés. Les progressions sont dangereuses et harassantes, il apporte des fournitures, des médicaments mais aussi du chlore pour des inhumations de fortune à faire sous le bombardement :
3 août 1916 (p. 229) « A 19 heures 30 ordre pour aller à Tatoï. Je pars avec 32 G.B.D., un pharmacien auxiliaire et du chlore. Arrivé au poste du 363e, le médecin-chef me remercie, il ne veut pas faire tuer des vivants pour enterrer des morts. »
19 août (p. 234) « Les Boches nous envoient pas mal de balles (…) Sur 100 mètres nous inhumons 51 cadavres, presque tous des Boches qui ont été tués et ensevelis par le tir des torpilles. »
20 août 1916 « Nous sommes de retour à Vaux, sans casse heureusement. Odeur épouvantable, cadavres vieux de 15 jours. Plusieurs rendent leur repas ! »
Octobre 1917 – juillet 1918 – pharmacien de régiment
Les carnets sont interrompus de septembre 1916 à octobre 1917, et on sait par sa F.M. que l’auteur a été promu pharmacien aide-major de 2e classe (sous-lieutenant) au 8e zouave (Division Marocaine). Les mentions deviennent plus rapides, indiquant déplacements, relations de blessures de connaissances, attaques aériennes, résultats de pêche, statistiques de pertes, etc…
L’engagement du 8e zouave pour tenter d’endiguer les offensives allemandes du printemps 1918, ranime la tension dans les notations. Son unité vient au secours des Anglais fin avril, dans le secteur de Villers-Bretonneux. (26 avril, p. 277) « À 4 heures, reçois l’ordre de rejoindre le poste de santé à Bois-Labbé. Très violente canonnade vers 5 heures. Pas mal de blessés par mitrailleuse. Nous sommes complètement assourdis par batterie anglaise voisine. Pas mal d’officiers touchés, Cadiot, Minard, Binder. Courtois arrive dans l’après-midi le cou traversé par une balle. Les tirailleurs auraient une grosse casse et ne tiennent pas le coup. Vu passer 2 tanks. L’un d’eux a déchargé deux blessés à la tête par balle ayant traversé les parois. »
L’auteur évoque ensuite les durs combats de la fin mai 1918, pour stopper l’avancée allemande du Chemin des Dames. Il participe aux combats de juillet 1918, mais les carnets s’arrêtent définitivement le 22 de ce mois. On sait qu’il est évacué gazé en septembre, mais pas s’il retourne en ligne avant l’Armistice : il sera plus tard pensionné (gazé) à 30%.
La partie la plus évocatrice de cet intéressant témoignage est donc celle qui concerne en 1915 la vie et la mort à l’intérieur d’une ambulance proche des lignes du Soissonais.
Vincent Suard, mai 2024