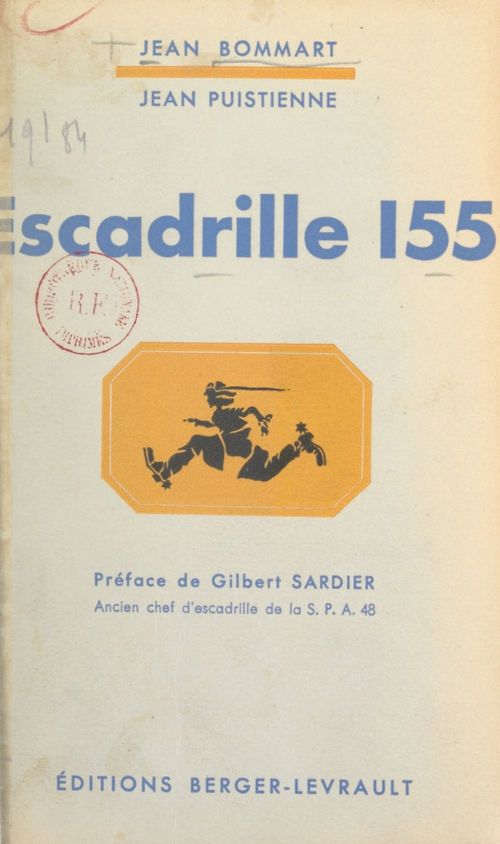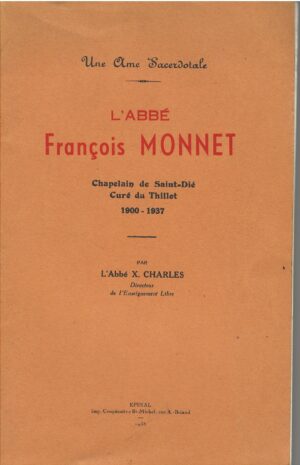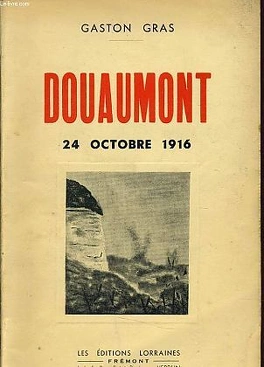Morse, Katharine Duncan (1888-1975)
Le village aux toits rouges. Bourmont et ses environs vus par des Américains (1917-1919). Les lettres non censurées d’une cantinière.
Katharine Duncan Morse, SHAL (Bourmont), 2021, 175 pages
Katharine Morse est cantinière, attachée à la compagnie A du 23ème R.I.U.S. du corps expéditionnaire américain basé à Bourmont (Haute-Marne) à la fin de 1917. Elle débute, à son arrivée dans le village, le 24 novembre, une auto-correspondance qui raconte son action pour la distraction et le bien-être, dont alimentaire, des Doughboys. Mais elle évoque aussi le lien, parfois surréaliste, avec la population et le quotidien de la présence américaine, en nombre, dans le secteur, ce jusqu’au 10 mars 1918, date du départ du régiment pour le front, en Meuse.
Eléments biographiques
Katharine Duncan Morse est née le 19 juin 1888 à Amherst, dans le Massachusetts (Etats-Unis), dans une famille aisée et cultivée de 7 enfants. Son père, Anson Daniel Morse est un historien et universitaire de renom qui eut parmi ses étudiants le 30ème Président des Etats-Unis, Calvin Coolidge. Il meurt en 1916. L’une de ses sœurs, Margaret Morse Nice deviendra une ornithologue réputée. A 16 ans, Katharine voyage en Europe et à 18 ans, elle entre aux prestigieux Smith College, la plus grande université pour femme des Etats-Unis. Elle ne termine toutefois pas son cursus dans cet établissement. Lettrée, elle publie régulièrement des poèmes dans le magazine de l’université. Elle reprend pourtant ses études à l’Université de Californie (l’UCLA) en 1912-1913. La guerre déclarée, elle se met au service de la Y.M.C.A. et part pour la France fin octobre 1917. Elle est basée à Bourmont, (depuis 2018 Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon) du 23 novembre 1917 au 8 février 1918 puis à Goncourt, la commune voisine, du 9 février au 11 mars 1918. Son parcours est ensuite meusien, avec des séjours de durées variables, à Dieue-sur-Meuse, Gondrecourt, Abainville ou Mauvages mais elle relate également des déplacements à Paris, ou en permission à Etretat, Aix-les-Bains, Saint-Malo ou Cauterets. Le 10 janvier 1919, alors qu’elle a déjà dépassé son contrat d’engagement de 8 mois, elle quitte Mauvages, pense repartir au pays puis se ravise et arrive à Paris le 7 février, pensant qu’elle peut être encore utile. Elle dit : « Si je repartais au pays maintenant, j’aurais l’impression d’être une dégonflée et je ne pourrais plus me regarder en face pendant tout le reste de ma vie ». Elle poursuit donc son travail de cantinière pour l’armée dans l’Est (Bar-le-Duc, Verdun, Conflans-Jarny) et le 15 mai 1919 ; elle quitte la France sur le paquebot Imperator. En août 1920, elle publie the Uncensored letters of a canteen girl puis elle publiera divers autres ouvrages de poésie, des pièces de théâtre ou des livres pour enfants. La Deuxième Guerre mondiale la retrouve volontaire au Seamen’s Church Institute à New-York où elle retrouve, comme dans la guerre précédente, un monde d’hommes, soldats et marins. Elle continue à publier des poèmes, parfois nourris de son expérience aux services des militaires, puis s’établit sur Staten Island dans les années 1950, se consacrant au jardinage et à l’observation des oiseaux. Entrée en maison de retraite au début des années 1970, K.D. Morse s’éteint le 12 juillet 1975. Elle repose aujourd’hui à côté de son frère, Harold, qui s’est noyé accidentellement à l’âge de 11 ans, en 1896, au Wildwood Cemetery de Amherst.
Commentaires sur l’ouvrage :
Publié aux Etats-Unis en 1920, les lettres non censurées d’une cantinière sont présentées par Jean-Marie G.-H. Pierre, qui expose, dans une préface introductive, ses recherches sur les Américains dans leur concours à la France à partir de 1917. C’est à la suite de la découverte de la version américaine de cet ouvrage qu’il décide d’en effectuer une traduction. En effet, natif de Bourmont, il lit dans ces pages une véritable « appropriation » de son village par Katharine Morse. Ayant découvert des descendants de ce témoin, il en reconstitue le parcours et publie les pages consacrées à sa présence à Bourmont et Goncourt. Le présentateur explique également le pourquoi d’un titre si énigmatique, évoquant des « lettres non censurées ». En fait, « non censurées » car « non envoyées » « il s’agit [en fait de lettres], d’avantage d’une sorte de « journal de bord » tenu presque quotidiennement du 24 novembre 1917 au 21 avril 1919 avec pour point de départ des notes jetées sur « des bouts de papier, lors de rares moments de répit, à la cantine, ou la nuit, à la lueur d’une bougie dans (son) cantonnement ou le matin devant l’âtre de Madame, les pieds sur une chaufferette » (page 11). Dès lors, cette initiative de traduction et de réintroduction dans l’histoire locale de ce petit village de l’est haut-marnais, aux portes des Vosges, permet en filigrane une excellente illustration anthropologique du lien entre les soldats américains et la population rurale bourmontaise. Elle qui révèle également la différence des mondes entre France et Etats-Unis du début du vingtième siècle, ce qui fait d’ailleurs dire aux soldats : « Ce pays a mille ans de retard ! » (pages 43 et 107). L’autre apport appréciable est que Katharine Morse nous connecte également à de nombreuses reprises à l’état d’esprit des Doughboys. Un très bon témoignage d’une jeune femme à hauteur d’homme. L’ouvrage est bien présenté, sauf l’appareil de notes, rejeté en fin d’ouvrage, et un peu compliqué à retrouver.
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Page 01 ; Cantonne dans la famille Chaput
3 : Description de l’intérieur, M. Chaput couche dans un lit à alcôve
5 : Leçon de lessive « à la française »
: Ambiance d’après pécule
7 : Phrases des anciens combattants pour « remettre les jeunots à leur place »
8 : Sur l’argent, les billets et leur durée de conservation par les américains, surnom
9 : Sur les pièces de monnaie, surnoms, tromperie d’argent mexicain sans valeur
10 : Sur les 8 langues utilisées dans une escouade
13 : Nègre
15 : Problème de langue entre français et américains
19 : Sombre intérieur des maisons
20 : « On se sentira bien seules quand les Américains partiront »
21 : Espionnite (vap 61 sur une empoisonneuse, et p. 68)
25 : Tabac gratuit envoyé par le Fonds du Tabac Sun
26 : Coutume de la buche de Noël
28 : Sur le gui
31 : Vue d’un enterrement d’un soldat US
38 : Froid, encre qui gèle
: Sur le vol de couverture, considéré au rang de crime
42 : Chop suey, plat chinois
: Ennui à Bourmont ; les hommes demandent à monter au front
43 : « Frénésie » de l’apparition de la moustache chez les soldats US qui se font prendre en photo avec pour l’envoyer à leur petite amie (vap 106)
: Fusil (Springfield US M17 ?) surnommé « Betsy, l’embroche-crapauds », Betsy était le surnom du fusil de Davy Crocket
: Patriotisme émoussé à la confrontation de la guerre et du séjour en France
: « Depuis mon arrivée, j’ai vu le soleil deux fois » « et encore on aurait dit qu’il était un peu moisi »
45 : Cour martiale
49 : Mangeurs de grenouilles
: Puni pour avoir utilisé son casque comme bouilloire, condamné à une amende de 20 dollars
50 : Hospitalisée à Paris pour rougeole
64 : « Depuis l’arrivée des Américains, toutes les femmes ont quitté l’usine pour laver les vêtements des américains »
69 : Vue de l’hôpital de Goncourt (16 malades)
71 : Bataillon MILK car il est composé des compagnies I, K, L et M
: Vitex, ersatz de verre
72 : Maisons consignées à cause de l’alcool (vap 74) et rumeur d’utilisation comme « bordel » pour les officiers
76 : Problèmes d’indiscipline et de violence, raison : « Prenez un échantillon moyen de deux mille cinq cents garçons, soustrayez les à toute bonne influence capable de les restreindre, faites les marcher toute la journée dans la boue et sous la pluie jusqu’à ce qu’ils tombent d’épuisement au bord de la route, ramenez les le soir vers des greniers ou des granges sombres, endroits froids, humides, crasseux et infestés de vermines, ajoutez à cela la tension provoquée par la perspective de monter au front pour la première fois, fermez leur toutes portes sauf celles du café et donnez leur de l’argent – et dites moi quel résultat on peut attendre de tout ceci ? »
78 : Auto-blessure de la main pour échapper au front
80 : Martin surnom français d’une mule, Maud chez les américains
: Batiste, toile noire
83 : Prix de la cantine et ce qu’on y trouve
: Visite de Pershing
85 : Etonnée de la grossièreté des hommes : « Avant, j’ignorais combien le Corps Expéditionnaire Américain pouvait être aussi régulièrement et continuellement grossier une fois livré à lui-même. Ce qui est étonnant – car ceci semble être leur manière normale de s’exprimer – c’est comment ils arrivent à se débarrasser de toute grossièreté quand on les entend parler de manière un peu affectée dans les cantines. »
86 : Ordre de raser les crânes avant de monter au front
: Conseil à K.D. Morse : « Restez à l’écart de tout ceci. C’est pas pour les fillettes ce qui se passe là-bas » et « Vous envoyer au front sans vous avoir fait subir les exercices avec des masques n’est rien d’autre qu’un meurtre de sang-froid »
107 : Sur les tas de fumier
116 : Leave Areas, zones de permission
Yann Prouillet – 21 avril 2025