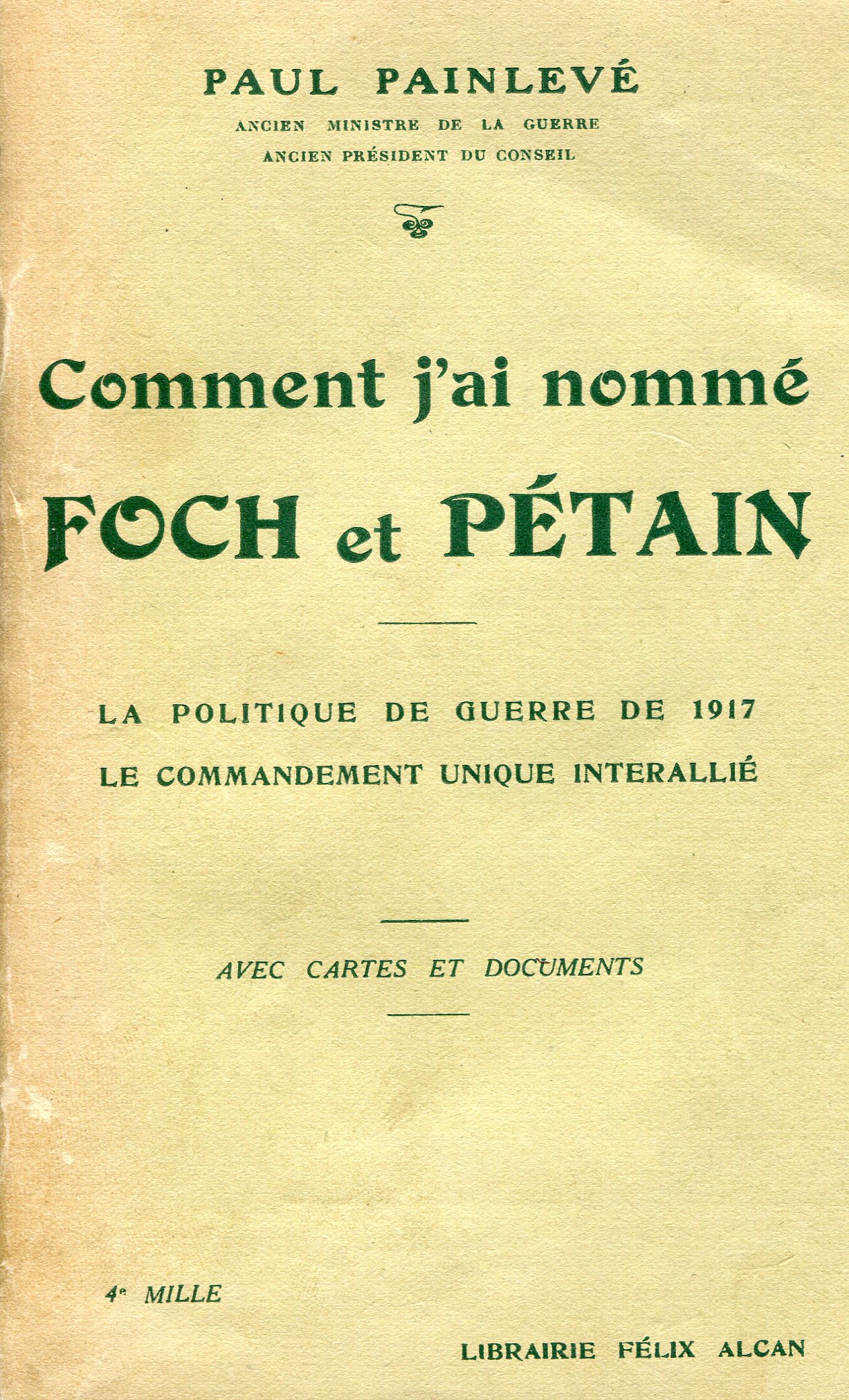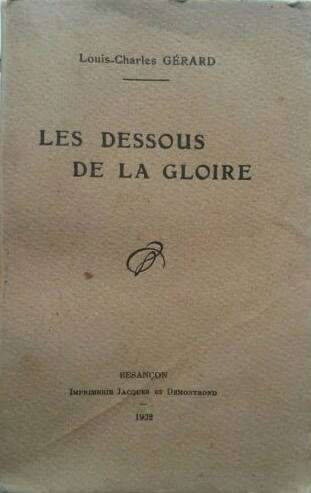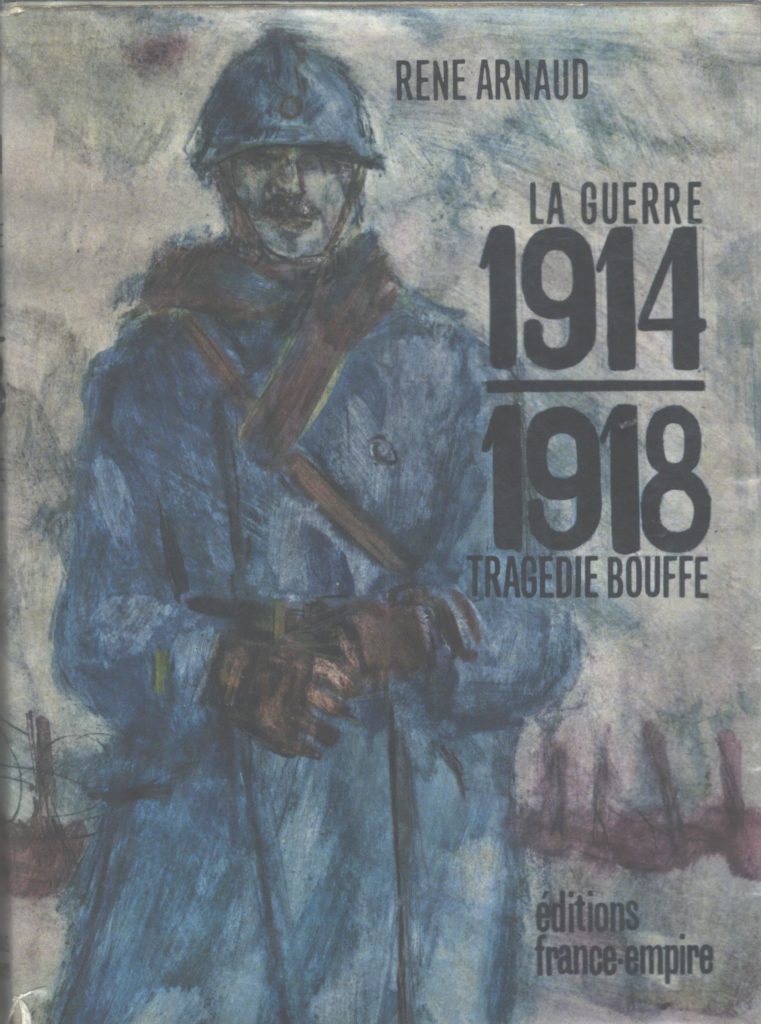1. Le témoin
Paul Ambroise Edmond Ricadat est né le 14 octobre 1893 à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis) dans une famille originaire des Ardennes, à Sedan. Après des études supérieures dans la capitale, il fait une carrière à la Bourse de Paris où il termine chef du service des opérations à terme. Il fait son service militaire à Sedan en 1913 et termine la guerre comme aspirant, achevant finalement sa longue période militaire de 6 ans lieutenant de réserve. Blessé deux fois et plusieurs fois médaillé, il sera fait chevalier de la Légion d’Honneur. Il décède le 27 février 1987 à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne.
2. Le témoignage
Ricadat, Paul, Petits récits d’un grand drame. (1914-1918). Histoire de mes vingt ans. Paris, La Bruyère, 1986, 233 pages.
Sur sa démarche d’écriture, réalisée en différentes étapes, Paul Ricadat indique lui-même : « J’avais eu l’occasion de lire dans la presse, au début de 1966, une appréciation qui estimait que, pour les Anciens qui l’avaient vécue, la guerre de 1914-18 c’était le bon temps… Je décidai, sur-le-champ, de relever le gant et j’écrivis un récit intitulé : « Le bon temps », qui fut publié par le journal la Voix du Sancerrois. Ce récit fut retenu par un jury, présidé par Jules Romains de l’Académie française dans un livre, les Camarades, de Roger Boutefeu. Il y eut dix lauréats de ce prix Verdun : six lauréats français, dont je fis partie, et quatre lauréats allemands. Voilà l’origine de ce titre, qui ne devait pas être ignorée du lecteur » (p. 207). Ces récits forment la base de ce livre, Paul Ricadat dédiant ses pages à ses enfants, petits-enfants et à son arrière-petit-fils « en sa 93e année ». Il précise encore sur la rédaction de ses « vieux souvenirs », débuté à sa retraite, en 1956 : « Pour 1916 et 1917, je pus confronter ma mémoire avec les deux petits agendas de poche que j’avais tenus alors au jour le jour. (…) Quant à 1914, époque à laquelle toute note écrite était interdite, je n’avais besoin d’aucune aide. Je me souviens de chaque jour, sinon de chaque heure, comme s’ils dataient d’hier » (pp. 230 à 232). Sur les conditions de son écriture, il nous renseigne un peu plus loin : « Il me faut dire ici que j’eus une chance inouïe. C’est grâce à ma blessure et à mes pieds gelés que je dois la vie sauve. Les longs mois d’hôpitaux, suivis de séjours prolongés au dépôt de mon régiment, me maintinrent à l’abri au cours des années 1915 et 1918. Mais aussi et surtout, cette survie, je la dois à la protection efficace du Ciel, à cette intervention continue, que je qualifie de miraculeuse, de la Divine Providence, écartant sans cesse le danger au moment où il semblait devoir me frapper. J’aurais dû mourir cent fois plutôt qu’une, mais, en, chaque circonstance, le « coup de pouce » était donné qui faisait dévier la balle ou l’éclat d’obus. Ma vie, depuis un demi-siècle, est une action de grâce continue pour tant de bienfaits ». Poursuivant dans un ultime chapitre en forme de « conclusion (au soir de ma vie) », il pense prophétiser : « Les années ont passé. La génération de « Ceux de 14 » ainsi que l’a défini Maurice Genevoix, achève de disparaître. Bientôt le linceul de l’oubli ensevelira les événements, les acteurs du drame et leurs souvenirs. Et les livres d’Histoire ne mentionneront plus qu’il y eut en 14-18 un conflit pas comme les autres » ! » (p. 232).
Paul Ricadat débute ses souvenirs en juin 1914 à la caserne Macdonald du 147ème RI à Sedan (il avait été incorporé le 27 novembre 1913) alors que « les classes des contingents 1912 et 1913 étaient enfin terminées. Elles venaient d’être couronnées par les marches d’épreuve dont la dernière était l’itinéraire Sedan-Charleville, aller et retour, avec le chargement de guerre. Au total 55 km, sous un soleil torride. L’Etat-major local était parait-il satisfait, l’entraînement intensif que nous avions subi avait porté ses fruits » (p. 20). Suit la narration de sa guerre sous la forme de 20 tableaux commentés de sa guerre, tour à tour réaliste et terrible, à laquelle il finit par échapper pour cause de pieds gelés, à la fin de 1917, alors qu’il est passé au 33ème RI d’Arras.
3. Analyse
Son récit est alors un mélange de souvenirs et de réflexions, souvent opportunes, le poilu réfléchissant sur son environnement comme sur son rôle au fur et à mesure de ses fonctions. Il dit de l’Armée : « j’ai eu la possibilité de bien la connaître parce que j’ai souffert de toutes ses contradictions » (p. 94) ce qui rend son témoignage réflexif selon les tableaux qui résument les grands chapitres de sa guerre, en forme de récit chronologique.
Le premier tableau, Leçon d’histoire, fait un rapide tour d’horizon du ressenti de sa vie militaire. En guise de préliminaire, il pose la question : « Comment avez-vous pu tenir ? », ce à quoi il répond : « Nous n’avons pas eu à nous interroger sur ces questions du moins pendant les trois premières années de guerre. La raison est que notre génération avait été élevée sous le signe du devoir ». Il attribue au pangermanisme une autre réponse à cette question. Il fustige ensuite ce qu’il qualifie comme étant les mensonges de son époque, « journalistes partisans [écrivant] l’Histoire à leur façon » et de dire « qu’ils attendent au moins que les acteurs du drame de 14-18 soient tous disparu » ! (p. 14). Il y rappelle l’état d’esprit de la jeunesse d’alors : « Non, les jeunes de 14 ne voulaient pas la guerre, tout au contraire, ils la redoutaient, sachant qu’ils en seraient les premières victimes. Personnellement, j’avais visité, dès que j’eus l’âge de raison et plusieurs fois par la suite, l’ossuaire de Bazeilles et ces pauvres restes de combattants de 1870 me laissaient une impression de terreur que rien que le mot « guerre » me faisait trembler ». Poursuivant ses questionnements, il dit : « On nous reproche aujourd’hui d’être partis en chantant (…) et, qui plus est, avec la fleur au fusil, ce qui prouve soi-disant notre volonté de guerre. Pauvres ignorants qui méconnaissent jusqu’à l’A B C de la psychologie des foules. Puisque le sort en était jeté et que nous ne pouvions rien contre lui, nous considérions qu’il valait mieux partir en chantant plutôt que les larmes aux yeux » (p. 16).
Dans Avant la bataille, il décrit son départ pour le front et la montée dans les wagons à bestiaux « aménagés de bancs à dossier et même de râteliers pour les fusils » (p. 24), les heures de marche qui agonisent les pieds. Sur ce point, il décrit : « Ordre est donné de se déchausser, de se laver les pieds avec un linge humide et de les exposer toute la journée. Ce fut un excellent cicatrisant, au point que le lundi 3 août, nous pûmes remettre nos chaussures, les plaies étaient presque refermées et la souffrance devenue supportable » (p. 26). A Marville, dans la Meuse, Ricadat dit : « Ce que nous ne savions pas, c’est que notre départ de Marville signifierait pour nous un point de rupture dans notre vie. C’en était fini de notre jeunesse, de notre insouciance, de notre sérénité. Une période commençait qui durerait plus de quatre ans et pendant laquelle nous serions confrontés perpétuellement avec la Mort. Les trois mille hommes qui pendant huit mois avaient vécu une vie commune, allaient tomber les uns après les autres, ne laissant subsister qu’une poignée de rescapés. Pauvres gars ! » (pp. 28-29). Son régiment, qui a quitté Sedan le 1er août, reste stationné dans cette commun jusqu’au 18 avant de se diriger vers le nord où il franchit la frontière belge : « Traversant les villages, nous trouvons devant les maisons, sur le bord de la route, de vastes récipients ou des baquets remplis de vin et d’eau. Nous plongeons notre quart sans nous arrêter et buvons en marchant. Les quarts suivants que nous pouvons remplir sont destinés au bidon. Des enfants nous donnent leur tablette de chocolat, d’autres nous mettent en main des paquets de cigarettes. Quelle fraternité ! » (p. 37). A « Robelmont, village belge évacué par tous ses habitants. Pour éviter des dégâts, ils ont laissé les portes ouvertes. Nous sommes autorisés à entrer à condition de tout respecter » (p. 38). C’est dans ses environs qu’il reçoit le baptême du feu, sous les ordres d’un adjudant (Simon) qui tient sa troupe, apeurée, en distribuant des cigares ! (p. 40) alors qu’heureusement « il fut admis que dans les premiers jours des hostilités, les Allemands tiraient trop haut » (p. 41) ! Très descriptif et pédagogue, l’auteur continue de décrire ses premières heures de combat : « Enveloppez les baïonnettes dans le pan de la capte pour en amortir le cliquetis et marchez sur la pointe des pieds » (p. 42). Il décrit aussi les affres de la bataille des frontières, telle cette femme accouchant sur un chariot d’exode (p. 44) ou ce soldat en sentinelle devenu fou en tuant son frère par erreur (p. 46). Il dit devant cette phase des combats d’août 14 : « Nous ne comprenons rien à la situation. Au fond, n’est-il pas préférable pour nous de ne rien comprendre » (p. 48). Ses descriptions virent parfois au cocasse près de Stenay, quand il fait un plat-ventre dans une de ces « servitudes de notre frère le corps » en rappelant que « chacun sait ce que l’on trouve souvent le long des haies ! » (p. 49), ou quand, faute de ravitaillement, chacun se rue sur des pommes, mêmes vertes, et qu’ensuite, « il faut avoir vu ces milliers d’hommes s’égailler dans les champs et poser culotte à perte de vue pour imaginer cette souffrance » de la dysenterie (p. 54). Cette retraite précédant le sursaut de La Marne occasionne également de la fraternité, certains portant le sac de ceux qui s’apprêtent à flancher (p. 56). Le 21 septembre, devant le bois de la Gruerie, il s’horrifie de la guerre en forêt : « Je considère ces hautes futaies, ces arbres de vingt-cinq mètres de haut, ils m’écrasent et leur masse, qui se referme sur nous sans nous laisser voir le ciel, m’étouffe. Petit à petit, j’en prends conscience, c’est la peur qui m’étreint. Je lutte contre elle, je voudrai pouvoir fuir, je n’en ai pas le droit » (p. 65). Après un accrochage ayant causé une vingtaine de morts dans le camp d’en face, il fait cet étonnant bilan : « Mais, faut-il l’avouer, c’est moins le nombre qui nous intéressait que les provisions que nous pouvions trouver dans leurs sacs. Ils avaient en effet, ce que nous n’avions plus depuis longtemps, des vivres de réserve, biscuits et conserves, et nous avions faim. Ces récupérations furent les bienvenues » (p. 69). Le 24 septembre, il rapporte l’exécution d’un soldat du 147 et, fait rare, il fait partie du peloton d’exécution. Toutefois, la base Guerre 1914-1918 ~ Les fusillés de la Première Guerre mondiale — Geneawiki ne relève pas d’exécution ce jour là mais le même jour un mois plus tard. A-t-il exécuté Maurice David Séverin ce jour-là ? (pp. 70 et 71). Le lendemain Paul Ricadat est blessé à la tempe : « Je prends conscience que je vais mourir » (p. 74) ; il quitte la tranchée pour un poste de secours. Là, il tombe alors sur un major fou (Guelton) qui menace d’abord de le faire fusiller pour désertion, avant de le faire effectivement évacuer devant la gravité de sa blessure dont il finit pas prendre conscience ! Sa vision de la cave d’ambulance où il passe la nuit en attendant son évacuation est « apocalyptique », même si elle est atténuée par les « gestes maternels » que se prodiguent les blesses entre eux. Toutefois, devant la désorganisation du service de santé, et devant la, finalement, faible gravité de sa blessure, il finit par s’évacuer lui-même et prendre un train sanitaire qui mettra 19 heures pour faire Sainte-Menehould/Dijon (pp. 78-79). Il passe 4 mois à l’hôpital de cette ville puis rejoint le dépôt du 147ème RI à Saint-Nazaire. Il y apprend alors avec stupéfaction qu’il a été cité à l’ordre de la Division « qui me donnait le droit au port de l’étoile d’argent sur ma croix de guerre » (p. 84). Dans le chapitre Le baiser, il indique que « ce n’est pas le récit d’un combat, mais celui d’une émotion, associée à la souffrance et provoqué par la bonté ». Il décrit l’état des soldats après la retraite de La Marne ; « nous n’étions plus des hommes, mais des loques » (p. 89). Retapé, son changement de régiment lui donne le cafard et lui rappelle ses copains déjà morts, dont Eugène Pasquet qui avait le pressentiment funeste qu’il « ne sortirai pas vivant de ce métier », l’invitant, lui, très pieux, à se pencher sur ce sentiment. Le 18 mars 1916, il quitte la cité portuaire pour revenir dans la Meuse, à Longeville. Il est donc versé à la 8ème escouade de la 2ème section de la 4ème compagnie du 33ème RI. Sur la route pour rejoindre le Chemin des Dames, au cours d’une étape, sa compagnie est rassemblée par son capitaine qui déclare : « Je vous ai rassemblé afin de prendre contact avec les nouveaux venus. Je tiens à ce qu’ils sachent à qui ils ont affaire et ce qui les attend. Nous sommes ici pour faire la guerre, c’est dire qu’il ne faut pas que vous conserviez le moindre espoir de rentrer un jour dans vos foyers ! Rompez les rangs et rentrez dans vos cantonnements » (p. 110). Le lendemain, il est au Village nègre de Bourg-et-Comin et, prenant la ligne de feu sur le plateau, il relève : « Les gradés se passent les consignes, les hommes chuchotent à voix basse. Nous apprenons qu’il y a une entente tacite existe depuis des mois avec l’ennemi. Aucune dépense de munitions, pas de pertes d’un côté comme de l’autre, c’est le secteur idéal. Oui, mais ce n’est pas la guerre, et, à ce train, elle pourrait durer cent ans. L’état-major du corps d’Armée est, parai-il, scandalisé par un tel abandon de responsabilités et projette d’y mettre fin » (p. 11). Le 2 mai, ayant appris que son père est mourant, il obtient in extremis une permission pour assister à ses derniers instants, à Fismes. Il quitte le Chemin le 17 juillet 1916 pour la Somme où, jusqu’au 7 août, « nous connûmes cette vie de camp pour laquelle nous n’avions plus beaucoup d’affinités » (p. 126). Celle-ci lui donne toutefois le temps de voir griller des Saucisses et leur observateur par un orage ou tirer un 380 de marine sur voie ferrée. « Le 1er septembre marque notre entrée dans la bataille de La Somme », sur un autre plateau, celui de Maricourt (p. 128). Il y subit de terribles épreuves : « Nous restons ainsi quatre jours sans nourriture, souffrant encore plus de la soif que de la faim. Avec notre couteau nous arrachons des fibres de bois aux matériaux que nous trouvons et nous les mâchons pendant des heures pour tromper la faim » (pp. 135 et 136). Très pieux, il est aux anges quand, sorti un temps de l’enfer, « l’abbé Vitel décide une journée complète de spiritualité. Nous en avions besoin après ces trois semaines de vie purement bestiale » (p. 137). Après la Somme, on le retrouve en Champagne, sur la butte du Mesnil ; il y connaît l’angoisse d’entendre sous ses pieds des bruits de creusement, qu’il nous fait vivre heure par heure. La mine explose en même temps qu’il est attaqué et il s’en sort miraculeusement. Il conclut ce chapitre, Agonie, en revenant sur sa blessure à la tempe en septembre 1914, « la mort subite », et sur son expérience de la guerre souterraine, « la mort lente » : « Ah ! qu’il est donc facile de mourir à vingt ans ». Le 12ème chapitre, Espions vrais et faux, revient ce qu’il qualifie de « véritable épidémie » : « l’espionnite ». Il en fait une analyse correcte en alléguant : « Ce fut le début d’une suite d’aventures et d’erreurs qui, parfois, tournèrent au comique, mais, trop souvent aussi, hélas, eurent une conclusion tragique » (p. 152). Toutefois, il rapporte cette anecdote d’un vacher dénonçant aux allemands l’arrivée du 33ème RI en faisant bouger ses bêtes dans le secteur de Vendresse-et-Troyon en avril 1916. Il dit également avoir rencontré un artilleur-espion dans la tranchée le 22 mars suivant non loin de la ferme du Temple puis un autre encore plus tard, faux cette fois-ci. Et de conclure : « … je dois avouer que j’ai joué de malchance dans mes démêlés avec des espions. J’ai laissé filer le vrai et j’ai arrêté le faux » ! (p. 159). Son 14ème chapitre est consacré aux mutineries. Sur ce point, il dit : « J’eus la chance d’appartenir à un corps d’armée, le 1er Corps, qui ne se laissa pas gagner par la contagion » (p. 171). Il est désigné pour tenter, à plusieurs reprises, de contenir les mouvements des hommes, isolés manquant de pinard ou de permissionnaires excités, tâches dont il s’acquitte brillamment évidement. Il gardera de cette époque une haute estime à Pétain qu’il qualifie de magicien.
Est-il un témoin fiable ? L’épisode qu’il rapporte, le 27 juillet 1917 semble le confirmer. Ce jour-là, il assiste effectivement à la mort « accidentelle non imputable au service » dans le canal des Glaises à Wahrem (Nord) du soldat Camille Xavier Derrouch (cf. DERROUCH Camille Xavier, 02-02-1896 – Visionneuse – Mémoire des Hommes (defense.gouv.fr)). Il en décrit ensuite l’inhumation (pp. 188-189). On pense donc pouvoir le croire quand quelques jours tard, il atteste qu’un soldat a abattu un avion à coup de fusil (p. 195). La guerre avançant renforce sa religiosité… ou sa superstition. Pris dans un bombardement en octobre 1917, il dit : « La main dans la poche de ma capote, je récite mon chapelet, arme suprême quand les autres sont impuissantes » ou sur ce qu’il qualifie de miracle du fait de la prière d’un de ses soldats, pourtant athée (pp. 201 et 202). Mais rien n’atténue l’horreur croissante de ses conditions en première ligne sur l’Yser. Il dit, « Depuis notre arrivée ici, nous urinons sur place, sans bouger, augmentant ainsi la puanteur de ce cloaque » (p. 210). En novembre, après quatre jours d’enfer au fond d’une tranchée, il est relevé mais, comme les deux tiers du bataillon en ligne, il a les pieds gelés. Hospitalisé à l’hôpital d’Abbeville, sa guerre est terminée.
20 octobre 1918, on retrouve Paul Ricadat à Champigny-sur-Yonne (Yonne), à la veille d’être inscrit à suivre à Issoudun un cours d’élève-aspirant. C’est dans cette ville qu’il vit le 11 novembre en une longue minute de silence avant qu’« alors, c’est une clameur, une ruée, un déchaînement comme je n’en ai jamais connu ». Réflexion faite, il dit : « J’ai toujours regretté de n’avoir pas assisté au « Cessez-le-feu », au front, en première ligne, minute inoubliable pour ceux qui l’ont vécue ». Et de conclure : « Qu’étions-nous, en fait, à cette heure ? Des condamnés à mort qui, depuis quatre ans, attendaient chaque jours leur exécution et à qui on venait dire : « Vous êtes graciés, partez, vous êtes libres » (p. 224). « L’armistice n’est pas la paix ». En mars 1919, son stage se termine, complété par quinze jours à l’école d’artillerie de Poitiers à l’issue desquels il devient instructeur à Tours. Il est enfin démobilisé le 1er septembre 1919, achevant sa vie militaire commencée le 27 novembre 1913.
Bibliographie complémentaire à consulter : Boutefeu, Roger, Les camarades. Soldats français et allemands au combat. 1914-1918. Paris, Fayard, 1966, 457 pages.
Yann Prouillet, février 2021