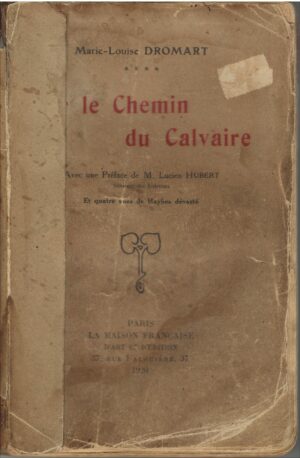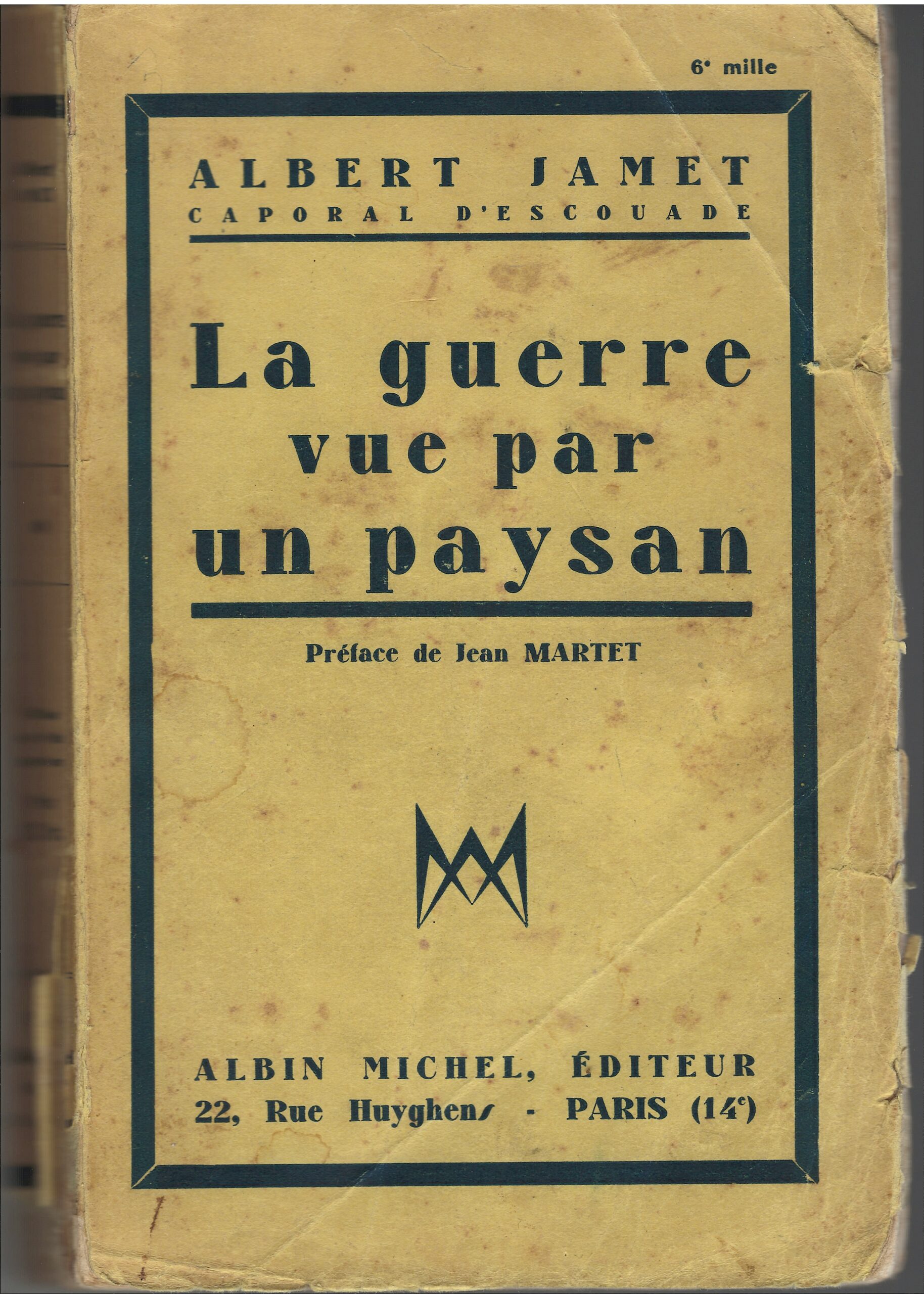Journal de Marie-Thérèse, 1914 – 1918, une famille dans Lille occupée
Paule Huart-Boucher
1. La témoin
Marie-Thérèse Dhalluin est au début de la guerre une jeune femme de 17 ans de la bourgeoisie lilloise ; elle habite avec sa mère Marguerite chez la grand-mère Valentine, qui a eu 9 enfants et qui est veuve d’Henri Deschamps, professeur de médecine à la Faculté catholique, et fondateur de la prospérité familiale. Pendant la guerre, sous l’autorité de « Bonne Maman », Marie-Thérèse aide sa mère à s’occuper de trois neveux qui ont en 1914 respectivement 10, 6 et 5 ans. Marie-Thérèse se marie après la guerre avec le médecin Maurice Boucher.
2. Le témoignage
Paule Huart – Boucher (1931 – 2023), fille de Marie-Thérèse, a mis en forme, commenté, illustré et fait éditer aux éditions Persée le Journal de Marie-Thérèse, 1914 – 1918, une famille dans Lille occupée (2013, 336 pages). Les mentions sont d’abord quasi-journalières, puis espacées tous les trois ou quatre jours. P. Huart-Boucher a intercalé dans la retranscription des reproductions d’affiches, et des lettres et documents issus des archives familiales. Le style est alerte, souvent indigné et parfois facétieux.
3. Analyse
Le rythme des écrits est scandé par les « grands » événements soulignés par les diaristes lillois (bombardement d’octobre 1914, « affaire des sacs » en 1915, enlèvement des jeunes femmes à Pâques 1916, etc…), et par les nouvelles quotidiennes, bruits et canards, ainsi que des informations sur la grande famille dispersée, on peut évoquer quelques thèmes.
Bombardement de Lille La description est intéressante car le domicile de Marie-Thérèse est assez proche des zones en feu : on prend prudemment des nouvelles en remontant de la cave [avec autorisation de citation] (p. 47, 12 octobre 1914) « Les coups de canon s’espacent, nous osons ouvrir la porte de la rue et regarder : c’est affreux, des hommes, des femmes échevelées, des enfants que l’on porte et qui pleurent, tous fuient devant l’incendie. »
Logement d’officiers allemands La diariste évoque des Allemands toujours plus nombreux en ville, l’espoir de leur proche départ toujours déçu, et la défense efficace de leur bonne Anna contre les tentatives de réquisition dans ces grandes maisons bourgeoises : « Vieille dame très malade ! » (22 oct.) ou « Dame kapout! » (4 nov.) ; en novembre 1914, elles finissent par obtenir, après 9 visites, la mention Krankheit sur la porte. Elles réussissent à éviter presque complètement cette corvée, ce qui est très atypique : (p. 197, sept. 1916) « notre bonne étoile nous protège toujours, nous les avons encore évités cette fois-ci, mais les voisins qui n’y coupent pas nous regardent d’un mauvais œil. »
Le son du canon Au début de l’occupation, les canards optimistes sont fréquents, et Marie-Thérèse croit à une libération en 1914, mais la réalité lui apparaît en novembre 1914 (p. 78) « Mme Hauriez revenue de Bruxelles, nous apporte les nouvelles. Elle a eu en mains des communiqués français réels. Nous sommes véritablement atterrées d’apprendre qu’on se bat encore autour de Reims, de Verdun ». Le quotidien est marqué par le bruit du canon, plus ou moins fort suivant l’intensité du combat (lignes à 15 km au nord et à l’ouest) et le régime des vents. Sans nouvelles, les Lillois se figurent souvent, par la variation des bruits du front, que la libération est proche. Il y a les intensités plus ou moins grandes (offensives), des tirs d’artillerie lourde anglaise sur les communes au nord de Lille et sur la Citadelle (peu éloignée de leur domicile), et aussi des tirs contre les avions anglais ; le danger est réel, car outre les éclats qui retombent sur la ville, un certain nombre de 77 mm n’éclatent pas en altitude et retombent intacts au sol… Le 30 juin 1916, un obus retombe sur l’église Saint-Sauveur à l’heure du culte (p. 190) « On n’a constaté que 3 blessures graves, mais combien d’enfants, de jeunes filles se promènent ce soir, pâles, le bras en écharpe ou la tête bandée. Malgré tout, il y a un miracle de préservation. » En janvier 1918, un obus (ou une bombe) explose dans la cour derrière la maison et en brise presque toutes les vitres, mais il n’y a pas de blessés, on « remercie Dieu de sa protection visible. »
Recevoir des nouvelles Très inquiète sur le sort de son frère Jean qu’elle croit d’abord prisonnier civil, l’autrice se plaint régulièrement de ne pas avoir de nouvelles, mais dès décembre 1914, on s’aperçoit que la famille reçoit des informations par des sources multiples :
– relations clandestines avec la tante de Valenciennes, qui elle-même réussit à correspondre avec l’oncle de Castres (on ignore comment),
– des lettres arrivent à une autre tante de Lille (12 janv. 1915) « dans un paquet de Hollande adressé à la Kommandantur ! »
– la grand-mère utilise l’adresse d’un correspondant à Rotterdam (« écrire sous double enveloppe », indique-t-elle comme consigne).
– une lettre de Gaston Grandel, frère de la Grand-mère « nous parvient par un officier allemand, fil de Mr Fendrich, son correspondant à Leipzig. » (p. 98).
– des mentions signalent des passeurs réguliers, qui se livrent à la contrebande de marchandises (« fonçage »), et qui emportent aussi du courrier à travers la frontière belge : (9 fév. 1915, p. 101) « Comme pour faire la nique aux tyrans, nous venons de recevoir d’une manière secrète et que nous ignorons, des nouvelles de la famille par l’oncle Augustin et l’oncle Maurice ; ces petites lettres sont du 25 janvier, et nous pouvons donner une réponse ! »
– la maisonnée a connaissance de la feuille clandestine de résistance « La Patience » (plusieurs titres successifs), ainsi p. 144 (septembre 1915): « Dans notre petit journal « La Patience » on nous rappelle ces trois mots : « patience, courage, confiance » et nous tâchons d’obéir à ce mot d’ordre.»
– à partir de 1916, le courrier a minima fonctionne par le biais de la Croix-Rouge: « Nous avons enfin notre petit billet de Francfort. Il n’est pas très loquace, mais c’est mieux que rien. »
– à la fin de 1917, les annonces du Matin sont très courues, ce quotidien fait l’objet d’une diffusion clandestine, ses petites annonces véhiculant des nouvelles familiales (18 octobre, p. 241) : « Enfin des nouvelles ! [du 3 oct.] « Gast. Fract. Maxill. Service Nuytz. Guéris 3 mois. M H inst. Paris. Av. enfants. Vass. Mant. Jean bord de mer. Cécile garç. Georg.b tjrs Orient. Vs espérons. » » Les autorités françaises finissent par interdire ces annonces au Matin à cause de l’espionnage (août 1918) : Le « Matin » nous manque, voilà 3 mois que nous ne savons rien; il nous semble qu’il y a un siècle. »
– on peut ajouter des jets réguliers de journaux par avion, la communication fonctionnant ensuite par le bouche-à-oreille: (août 1916, p. 196) « Quelle solidarité chez les Lillois ! Depuis ce matin, on est venu 11 fois pour nous donner des nouvelles trouvées dans le « Cri des Flandres » qu’un aéroplane a jeté aujourd’hui. »
Même si les arrivées de lettres sont irrégulières, et parfois très espacées, ces mentions de nouvelles reçues de la France non-occupée confirment bien, comme chez une autre Marie-Thérèse (Maquet), du même quartier Vauban, que la position sociale et professionnelle détermine un « réseau », des aptitudes et des moyens, pour trouver quand-même à communiquer ; en revanche, la population ouvrière, majoritaire en nombre, qu’elle soit féminine dans Lille occupée, ou masculine dans la tranchée avec les unités du 1er CA par exemple, ne dispose pas de ces canaux, et souffre durement de l’absence parfois totale de nouvelles sur une grande durée.
Les évacuations par la Suisse Ces évacuations organisées pour se débarrasser des bouches inutiles sont interprétés en deux temps ; d’abord on plaint les victimes indigentes arrachées à leur quotidien, on parle d’évacuation « terrible et inhumaine » (avril 1915, p. 118). Ces certitudes chancèlent en juin, une amie est partie (p. 127) « Elle s’est décidée en une journée. Dieu sait ce qui lui arrivera ! On raconte des aventures si effrayantes que c’est à donner la chair de poule à ceux qui veulent partir. » ; La perspective s’inverse à la fin de 1915, avec le choix de tante Marie-Henriette de partir, en décembre, avec ses trois enfants : «Le compartiment était très bien composé : Mme de Valmaire, Jeanroy, Ménard. ». La grand-mère Valentine hésite sur les décisions à prendre, on tergiverse beaucoup en 1917 et 1918, au gré des convois. En cas de départ, la maison serait pillée ; puis la grand-mère, veuve d’une notabilité et donc potentielle otage, est ensuite inscrite sur une liste de personnes interdites d’évacuation. Finalement :
– Henri (1904) est évacué en décembre 1917 (urgence par rapport à son âge)
– Albert (1908) et Jean-Marie (1909) partent avec la tante Marthe (célibataire) en août 1918 (inquiétudes à cause de la disette et des combats futurs autour de Lille) ; ils restent hébergés en Belgique dans de bonnes conditions jusqu’en décembre 1918.
– Émile (1899), cousin de Valenciennes, choisit d’éviter la déportation du travail en devenant mineur de fond sur place, puis réussi à être transféré en France libre avec un faux-certificat médical en 1918. (p. 262) «un certificat médical terrifiant, et le voilà de l’autre côté ; peut-être déjà à la caserne maintenant. »
Enlèvement des jeunes gens en avril 1916
En 1915, l’affaire des sacs est évoquée (tissage de sacs à remplir de terre pour la tranchée allemande), et Marie-Thérèse ressent durement des critiques parisiennes dont elle a eu vent à cette occasion, et qui condamnent les ouvriers qui cèdent à l’occupant. Soulignant les souffrances des occupés, elle est outrée du terme « Boches du Nord » dont elle a appris l’existence (pas de référence de source, deux occurrences p. 169 et 178). Les perquisitions de Pâques 1916 et la déportation agricole des jeunes gens, garçons et filles, sont très bien racontées, avec les réquisitions par quartier, et naturellement la visite à leur domicile à 5 heures du matin (p. 179) ; personne n’y est enlevé. Une lettre de la grand-mère adressée à la famille de Castres décrit aussi ces événements, et on constate que peu de monde a été pris dans ce quartier bourgeois (p. 184) : «De notre paroisse, nous avons deux amies enlevées : Barrois et Boninge. Quelle tristesse pour les pauvres mères qui restent. Remerciez Dieu avec nous de nous avoir épargnées ainsi que les sœurs de Marie-Henriette pour qui nous tremblions. » Dans une autre lettre à sa fille Marie-Henriette (évacuée en 1915), elle précise que dans son ouvroir (atelier qui fournit une revenu minimum aux ouvrières sans ressource) « on en a pris 37 (p. 185) » ; cela confirme les informations des carnets du recteur Lyon, montrant que si la peur – on peut parler de terreur – touche tout le monde, les enlèvements de jeunes femmes concernent essentiellement les couches populaires ; c’est moins le cas pour les jeunes hommes.
Dans un autre domaine, citons une mention sur les nouvelles professions ouvertes aux femmes : (6 décembre 1916, p. 204) « nous voyons les premières femmes receveuses sur les tramways. Ce n’est pas réellement un métier de femme et on se demande combien de temps elles résisteront ; en tout cas, cela fait prévoir un nouvel enlèvement d’hommes. »
Enfin en ce qui concerne le style, l’autrice s’amuse parfois à paraphraser des auteurs classiques, ainsi p. 105 : « Les Allemands mentent effrontément, c’est une population foncièrement fausse… « Nous l’allons montrer tout à l’heure ! » ou p. 227 « Un événement extraordinaire, inattendu, ahurissant… je vous le donne en 100, je vous le donne en 1000… » (arrivée d’une lettre inespérée de tante Mariette). La dernière ligne de ce journal précieux, qui s’arrête avec la libération de Lille par les Anglais, est : « Vive la France».
Vincent Suard, février 2025