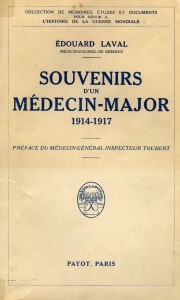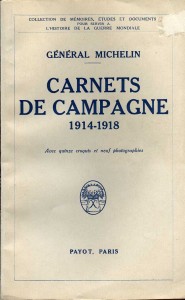Critique littéraire à la NRF, Albert Thibaudet a pu noter que dans l’après-guerre « on délégua à Montherlant et à Drieu la Rochelle, pour représenter dans le roman et ailleurs le combattant qui revenait, une sorte de fonction collégiale ». L’importance du conflit dans la production des deux auteurs, leur référence commune à une morale héroïque et élitiste, justifie ce rapprochement. La parole de Drieu se base toutefois sur un vécu plus large que celui de Montherlant dont la participation effective aux combats fut tardive et très limitée. Son rapport à l’événement s’avère plus complexe qu’il n’y parait. L’analyse de cette voix atypique suppose de situer Drieu au sein de la génération des « vingt ans en 1914 », de revenir sur son parcours militaire puis sur la postérité de cette expérience fondatrice dans son itinéraire littéraire et politique ultérieur.
Pierre Drieu la Rochelle est né le 3 janvier 1893 dans « une famille de petite bourgeoisie catholique, républicaine, nationaliste ». Son patronyme d’allure aristocratique remonte aux guerres de la Révolution et à son arrière-grand-père, le sergent Drieu « dit la Rochelle ». Les descendants du grognard ont accédé au monde de la petite notabilité : juges de paix, pharmaciens, avocats. La branche maternelle est de bourgeoisie plus récente mais plus fortunée. Incarnation des valeurs d’une classe moyenne travailleuse et excessivement prudente, le grand-père Lefebvre, architecte parisien, a accumulé une solide aisance. Il a marié sa fille Eugénie à Emmanuel Drieu la Rochelle avocat d’affaire qui se révélera rapidement un coureur de dot peu scrupuleux. Fruit de cette union, Pierre Drieu la Rochelle connaît une enfance lourde de tensions, marquée par la peur du déclassement social provoqué par les frasques du père. La famille reporte sur le jeune Pierre tous ses espoirs. Elève du lycée catholique Sainte-Marie de Monceau, envoyé à plusieurs reprises pour des séjours linguistiques en Angleterre, il intègre après le baccalauréat l’Ecole libre des sciences politiques, pépinière des élites politiques et administratives de la Troisième République. Jeune homme en recherche de soi, il fréquente des étudiants de gauche comme Raymond Lefebvre et Paul Vaillant-Couturier qui se rallieront l’un et l’autre à la révolution bolchévique, mais reste plus attiré par la prose violente de Maurras et de Sorel. Il suit avec intérêt la création en 1911 du cercle Proudhon qui se veut le point de convergence d’un socialisme « français » dégagé de l’influence marxiste et des partisans d’une restauration nationale . Il partage avec les Jeunes gens d’aujourd’hui décrits dans l’essai d’Agathon le goût de l’action et le culte de l’effort physique . Drieu reste par contre insensible au retour vers la foi de certains de ses condisciples. Eloigné depuis le lycée d’une religion catholique qu’il assimile à la faiblesse, il professe une vive admiration pour la philosophie nietzschéenne dont il retient le rejet des visions providentielles ou progressistes de l’histoire et du rationalisme hérité du XVIIIe siècle.
En 1913 il vit durement son échec à l’examen de sortie de Sciences-Po : ses espoirs d’une carrière diplomatique sont ruinés. Refusant la session de rattrapage, il devance l’appel en rejoignant le 5e RI en garnison à Paris. L’expérience n’est guère enthousiasmante. Drieu en vient à désirer une guerre qui briserait la routine dans laquelle il s’englue et lui donnerait l’occasion de se ressaisir. Se distinguant du modèle brossé par Agathon, il refuse pourtant de suivre le peloton des élèves officiers et reste caporal ce qui le fait apparaître aux yeux de ses chefs, selon ses propres mots, « comme un bourgeois frileux, tire-au-flanc et pessimiste ». Au vu des textes contradictoires rédigés sur le sujet, il est difficile de connaître avec précision son état d’esprit lors de l’entrée en guerre. Dans un article rédigé pour le vingtième anniversaire de la mobilisation, il insiste sur la touffeur de l’été 1914 et la difficulté pour les contemporains de réaliser l’impact de l’événement . Dans ses poèmes de guerre publiés en 1917, il se montre plus sensible aux élans patriotiques qui secouent la capitale. Dans Genève ou Moscou en 1928, il évoque enfin le sombre pressentiment suscité par le geste d’un paysan breton illettré qui, au matin du 3 aout, brise la crosse de son fusil. « Tous les deux seuls, nous ressentions quelle violence nous faisait cette folie collective, l’insensibilité imbécile de ce grand corps abstrait du régiment qui, gonflé d’emphase, allait se briser huit jours après, comme une métaphore démodée sur les mitrailleuses du Kaiser, elles-mêmes brisées par le 75 . » Ces différentes réactions – étonnement, ferveur patriotique, inquiétude – le montrent partagé entre les différents pôles d’aimantation agissant sur l’opinion publique.
Le jeune homme « dont on avait peint les jambes en rouge » – allusion aux célèbres pantalons garance – va dès lors se confronter à différentes facettes de l’expérience combattante. Le 5e RI est ainsi engagé dans la bataille des frontières. Quittant Paris le 6 aout 1914, le régiment s’achemine vers la frontière belge au terme d’éprouvantes étapes de marche forcée sous un soleil de plomb. Lors d’une halte à proximité de Charleroi, Drieu dit avoir éprouvé une forte pulsion suicidaire. L’irruption d’un camarade dans la grange où il s’était retiré pour retourner contre lui son arme aurait interrompu son geste. Le jeune nietzschéen attendait que la guerre le hisse vers un idéal héroïque bien éloigné du piétinement des jours précédents au milieu des milliers de conscrits anonymes. Le baptême du feu du jeune soldat a lieu dans la plaine de Charleroi deux jours après. C’est à cette occasion que le caporal Drieu, soudain débarrassé de toutes ses inhibitions, dit avoir connu l’expérience la plus forte de son existence. Chargeant le fusil à la main, il entraine dans son sillage plusieurs de ses hommes aimantés par sa détermination. L’assaut le porte vers un moment de grâce qu’il comparera à l’extase des mystiques. L’illumination est pourtant fugitive. Les coups de buttoir de l’artillerie allemande précédent une vigoureuse contre-offensive qui disloque le dispositif français. Le 5e RI est contraint à la retraite. Les pertes sont lourdes. André Jéramec, le meilleur ami de Drieu depuis la rue Saint-Guillaume, fait partie des disparus. Drieu lui-même, blessé à la tête par un shrapnel, est évacué vers un hôpital militaire de Deauville.
Lorsqu’il repart pour le front, la guerre de mouvement a cédé la place à la guerre de position. Nommé sergent le 16 octobre 1914, Drieu est envoyé en Champagne, dans le secteur d’Hermonville. Blessé au bras le 28 octobre, Drieu rejoint l’hôpital militaire de Toulouse. En 1915, il est volontaire pour la campagne des Dardanelles. Embarqué à Marseille dans le 176e RI au début du mois de mai 1915, il passe cinq semaines sur l’île de Lemnos qui sert de base arrière au corps expéditionnaire. L’inutilité d’une opération mal conçue lui apparaît très tôt. Le séjour lui laisse un souvenir cuisant. « Etre pauvre, c’est être sale. J’ai des morpions que ma crasse engraisse. J’ai pioché et j’ai des ampoules. Mes muscles me font mal. J’ai soif tout le temps. Tondu et barbu, je suis laid. Je ne reçois pas de lettres. Je mourrai totalement oublié » écrit en 1934 le narrateur de la nouvelle Le voyage aux Dardanelles . A la fin du mois de juin, l’unité de Drieu est envoyée relever les troupes du camp retranché sur la presque-île de Gallipoli. Soumis au pilonnage d’artillerie d’un ennemi qui les surplombe, les combattants croupissent dans des conditions d’hygiène déplorables. La chaleur exacerbe la puanteur de l’air due à la décomposition des victimes des différentes vagues d’assaut que l’on n’a pu évacuer. La dysenterie gagne de jour en jour. Dans la nouvelle évoquée plus haut, la participation du narrateur à la campagne des Dardanelles s’achève avec la bataille du Kérévès-Déré qui allait tenter – vainement – de bousculer le dispositif ottoman. La correspondance de Drieu avec sa fiancée Colette, sœur de son ami André Jéramec, indique qu’atteint par la dysenterie il a été évacué avant l’assaut puis rapatrié à Toulon . Cette entorse à la chronologie vient rappeler qu’un texte littéraire, même quand il voisine avec l’autobiographie, s’inscrit dans un registre qui n’est pas celui de la simple déposition de témoin.
Le retour du front d’Orient a laissé Drieu dans un état de délabrement physique et moral avancé. Sa convalescence s’étend tout au long de l’automne 1915. Lorsqu’éclate la bataille de Verdun, il vient d’être versé dans la 9e Compagnie du 146e RI commandée par l’historien catholique Augustin Cochin. Son régiment rejoint le secteur des combats le 25 février 1916, le jour de la chute du fort de Douaumont. Son bataillon est à la pointe de la contre-attaque du lendemain. Le sergent Drieu découvre la guerre moderne dans toute son horreur. « Je m’étais donné à l’idéal de la guerre et voilà ce qu’il me rendait : ce terrain vague sur lequel pleuvait une matière imbécile. Des groupes d’hommes perdus. Leurs chefs derrière, ces anciens sous-lieutenants au rêve fier, devenus de tristes aiguilleurs anxieux chargés de déverser des trains de viande dans le néant… », notera-t-il dans la nouvelle Le lieutenant des tirailleurs . En fin de journée Drieu et ses camarades refugiés dans un abri bétonné endurent le déluge d’artillerie, les nerfs à vif, les pantalons souillés par la colique. L’arrivée d’un obus qui s’écrase sur la redoute tire à Drieu un hurlement qui épouvante ses camarades. Sérieusement blessé au bras, le tympan crevé, il est évacué vers l’arrière. Déclaré inapte au combat, il est affecté en décembre 1916 auprès de la 20e section des secrétaires de l’Etat Major à l’hôtel des Invalides. Il épouse le 15 octobre 1917 Colette Jéramec. Richement doté par son épouse qui lui a consenti une donation de 500 000 francs, Drieu s’étourdit un temps dans la vie de plaisir de l’arrière qu’il décrira de façon saisissante dans la première partie du roman Gilles intitulée « La permission ». Honteux de cette position d’embusqué, il passe à sa demande à la fin de l’année 1917 devant une commission qui le déclare apte à servir. Disposant d’importants soutiens – sa belle-famille est proche d’Alexandre Millerand – son retour au front se fait toutefois dans des conditions choisies. Il est ainsi affecté à la fin de l’été 1918 comme interprète auprès d’un régiment américain – il qualifie lui-même sa position de « demi-arrière ».
Les marques de la Grande Guerre seront durables dans le corps et dans l’esprit de Drieu. Il décrira avec précision médicale dans le roman Gilles les séquelles irréversibles de la « blessure sournoise au bras qui avait enfoncé son ongle de fer dans les chairs jusqu’au nerf et qui avait là surpris et suspendu le courant de la vie . » La frénétique quête des plaisirs à laquelle il se livre dans les années vingt procède visiblement d’une volonté de compensation par rapport aux souffrances endurées. Une partie importante de sa production littéraire tentera, par approches successives et parfois contradictoires, de dire au plus juste son expérience de la guerre. Dès l’automne 1917 il a publié chez Gallimard un recueil de poèmes Interrogation. La plaquette a été bien reçue par les milieux nationalistes qui retiennent surtout la célébration du combattant d’élite trouvant dans le conflit la jouissance supérieure du dépassement de soi. La censure s’alerte pourtant de deux poèmes « A vous Allemands » et « Plainte des soldats européens » dont le ton est jugé trop fraternel à l’égard de l’adversaire. L’écrivain ne cache pas non plus le cri d’horreur poussé lors du pilonnage de Verdun. Dans les textes de la maturité il accorde une importance croissante au versant tragique de l’événement. En novembre 1929, il envoie une lettre ouverte au critique Benjamin Crémieux qui l’avait cité dans un compte rendu du roman A l’ouest rien de nouveau d’Erich-Maria Remarque afin de reprocher à l’écrivain allemand d’ignorer tout ce que la guerre avait eu de noblesse . Drieu refuse qu’on l’oppose à Remarque : leur expérience n’est pas la même et ses propres écrits témoignent de l’ambivalence d’une expérience faite d’exaltation et de souffrances mêlées. Publié en 1934, le recueil La comédie de Charleroi lui permet d’unifier sa vision du conflit. La nouvelle éponyme paraît en prépublication dans la revue Europe alors dirigée par Jean Guéhenno. Dans ce texte, le narrateur, devenu secrétaire de la mère d’un camarade mort à Charleroi, revient à ses côtés sur le site du combat. La vanité d’une mère tyrannique désireuse de tirer un bénéfice moral et social de son deuil transforme en comédie ce retour sur les lieux de la tragédie. Si l’extase de la charge et l’idéal du chef ne sont pas oubliés, c’est le désenchantement qui l’emporte dans les textes rassemblés ici : les hommes « ont été vaincus par cette guerre. Et cette guerre est mauvaise, qui a vaincu les hommes. Cette guerre moderne, cette guerre de fer et non de muscles. Cette guerre de science et non d’art. Cette guerre de bureaux. Cette guerre de journaux. Cette guerre de généraux et non de chefs. (…) Cette guerre de civilisation avancée . »
Les recherches politiques de Drieu la Rochelle procèdent également des leçons tirées de la guerre. Dans l’essai Mesure de la France, publié en décembre 1922, il dénonce ainsi les faux semblants d’une victoire. Affaiblie par plus d’un siècle de malthusianisme et saignée par la Grande Guerre, la France n’est plus qu’une puissance déclinante, au cœur d’un continent fatigué. Le dépassement des patries est dès lors le seul moyen d’éviter le retour à la guerre et d’assurer un avenir aux peuples du vieux continent. Dans Genève ou Moscou en 1928 il soutient « l’effort admirable et fécond » d’Aristide Briand. A cette date, Genève, siège de la SDN et des organisations de coopération européenne, constitue de son point de vue la seule alternative à une intégration sous la tutelle autoritaire de Moscou. La grande crise des années trente et la montée des totalitarismes l’amènent à des révisions radicales. En 1933 dans une pièce de théâtre Le Chef il décrit la montée du fascisme dans un petit Etat d’Europe centrale. Il semble encore s’interroger : la force nouvelle est-elle une juste émanation du mouvement ancien-combattant ou une exploitation de celui-ci par des leaders démagogues ? Au lendemain du 6 février 1934 ses doutes disparaissent. Il est l’un des premiers intellectuels français à proclamer son adhésion au fascisme. Spectateur enthousiaste du congrès de Nuremberg de 1935, il adhère au comité France-Allemagne piloté par l’habile Otto Abetz. En 1936 il voit en Doriot l’homme fort capable de réveiller la société française et met sa plume au service du PPF dont il épouse la radicalisation en se ralliant à un discours antiparlementaire, xénophobe et antisémite. Au lendemain de l’armistice de 1940, il prend la direction de la NRF et, encouragé par son ami Abetz, en fait une tribune de la collaboration intellectuelle. Le souvenir de la Grande Guerre est invoqué dans ses plaidoyers pour une intégration de la France dans une Europe continentale rassemblée autour de l’Allemagne. « Après le retour d’une ancienne guerre, j’ai découvert que la force ne pouvait plus s’épanouir dans aucun peuple, que ce temps n’était plus celui des peuples séparés, des nations mais celui des fédérations, des empires », note-t-il ainsi dans le numéro d’avril 1942 de la NRF. Il s’émeut, lors d’une soirée à l’Institut allemand, de découvrir qu’à l’automne 1914 l’écrivain Jünger servait dans le même secteur du front que lui. Refusant de renier ses choix, il tente une première fois de se suicider quelques jours avant la Libération de Paris. Sauvé par ses proches, il renouvelle son geste, cette fois avec succès, le 16 mars 1945. François Mauriac qui fut son adversaire au cours de l’occupation publie un article dans lequel il dénonce la fascination pour la force de Drieu mais souligne le destin paradoxal de l’ancien combattant de l’autre guerre « ce garçon français qui s’est battu quatre ans pour la France, qui aurait pu mourir aux Dardanelles ».
Jacques Cantier, MCF Histoire Contemporaine, Université Toulouse le Mirail
Bibliographie :
Pierre Andreu, Frédéric Grover, Drieu la Rochelle, Paris, Hachette, 1979.
Jean Bastier, Pierre Drieu la Rochelle, soldat de la grande guerre 1914-1918, Paris, Albatros, 1989.
Jacques Cantier, Pierre Drieu la Rochelle, Paris, Perrin, 2011.
Jean-Baptiste Bruneau, Le cas Drieu la Rochelle entre écriture et engagement : débats, représentations, interprétations de 1917 à nos jours, Paris, Eurédit, 2011.
Julien Hervier, Deux individus contre l’histoire : Pierre Drieu la Rochelle, Ernst Jünger, Klincksieck, 1978.