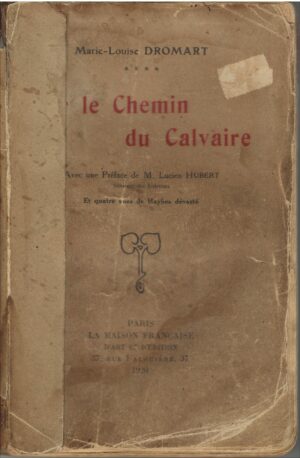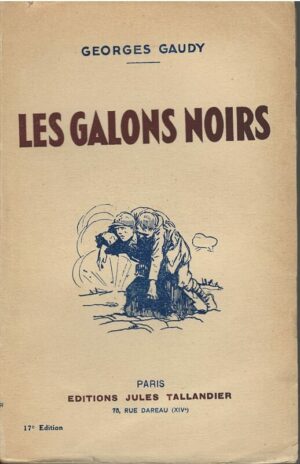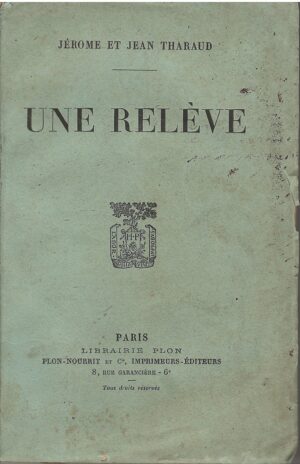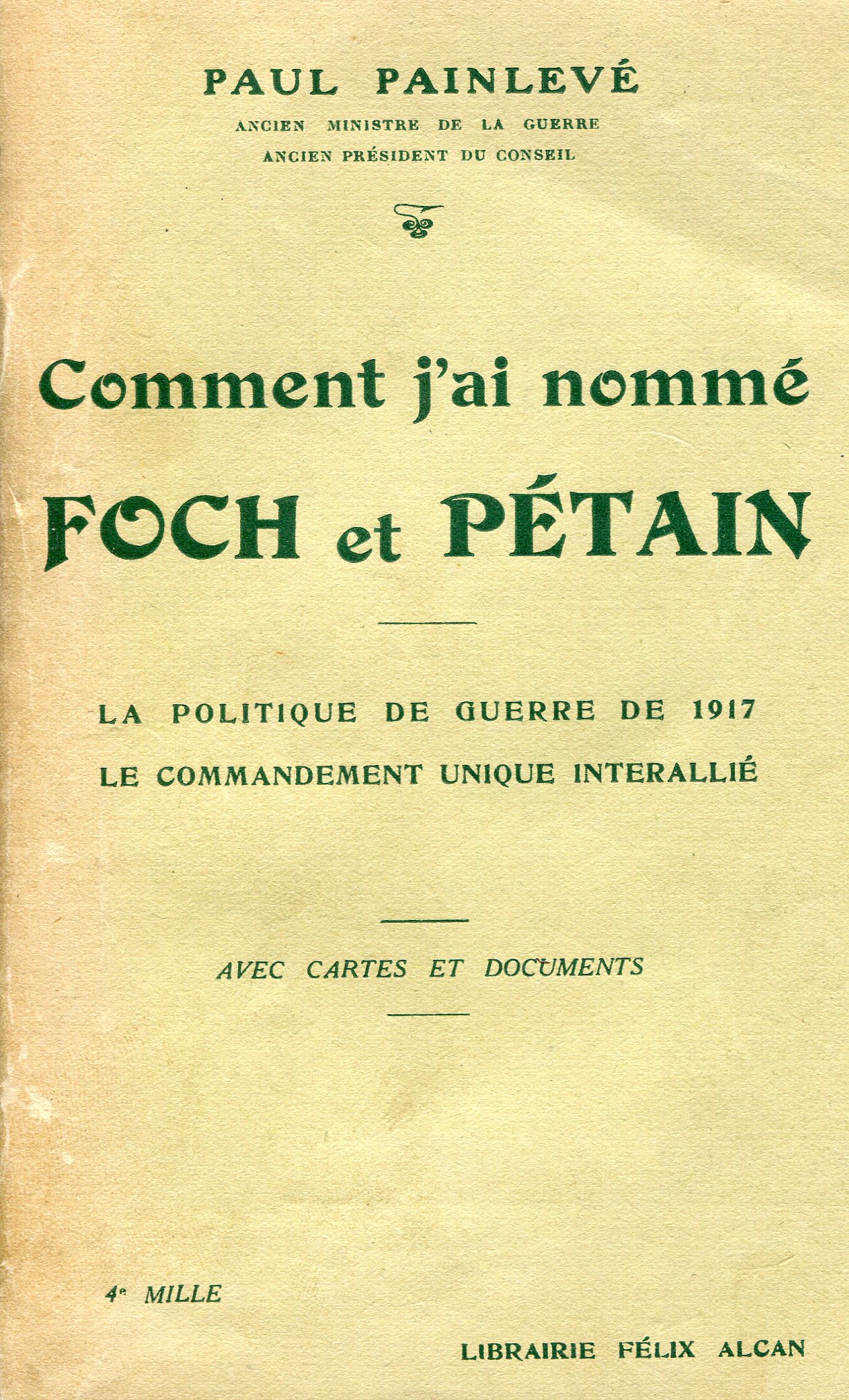Le chemin du Calvaire, Paris, La Maison Française d’Art et d’Edition, 1920, 167 p.
Résumé de l’ouvrage :
Marie-Louise Dromart demeure à Haybes, petite commune aux confins des Ardennes, à l’entrée de la pointe de Givet, en bordure de La Meuse. En 1914, elle est vice-présidente du Comité des Dames Françaises de la Croix-Rouge de Fumay, Haybes et Revin. A ce titre, elle témoigne des terribles journées d’août, à partir du 16, qui voient l’invasion de son village par les troupes allemandes. Après quelques jours d’exode des habitants des localités voisines auxquels sont mêlés des ressortissants belges, qui témoignent d’exactions, résolue, elle dit : « Vice-présidente d’une société locale de la Croix-Rouge, j’avais assumé la tâche rigoureuse et difficile de tenir tête à l’orage et, si je ne songeai pas un seul instant à déserter mon poste, je jugeai que mon premier devoir était d’écarter ma mère et mes deux enfants du péril imminent » (p. 3). Hélas, le 24, alors qu’elle s’apprête à traverser le fleuve avec sa famille, son fils et son père, « les Hussards de la Mort (du 19e) arrivaient comme une trombe » (p. 3), notamment « sur le Chemin du Calvaire, tristement symbolique, et ainsi nommé parce qu’un beau Christ de pierre le domine et le protège de toute sa détresse miséricordieuse » (p.11) qui donne son titre à son livre testimonial. Dans la tourmente, elle perd un temps sa fille et sa mère, séparée d’elles par la guerre. Devant cette détresse qui la dépasse, elle dit : « Je glissai dans ma poche deux paquets de sublimé, bien décidée à partager le poison avec les miens si les choses tournaient au pire » (p. 17), envisageant ainsi d’assassiner sa famille. Rassérénée, elle va dès lors se démultiplier pour tenter d’influer, en pleins combats, sur l’attitude des allemands qui vont multiplier les répressions et les exactions envers la population. Elle relate par le détail tant son action devant les troupes, et notamment les officiers, qu’en tant qu’infirmière, au château de Moraypré, tout en tentant d’éviter que sa propre famille ne subisse le même sort que son village, centre de combats de résistance, et où les destructions s’accumulent. Se démultipliant, également comme interlocutrice, voire médiatrice, elle assiste au simulacre d’un procès et rapporte (elle n’en n’est pas le témoin direct) celui d’une Cour martiale à l’encontre d’un des prêtres du village. Début septembre, elle constate son village en ruines, qui s’est résolument enfoncé dans l’occupation, la guerre ayant poursuivi son chemin vers le sud. Mais il faut gérer les blessés. Omnipotente, elle organise l’évacuation de ceux de l’hôpital de fortune qu’elle avait créé avec l’instituteur local vers l’hôpital de Fumay, commune limitrophe au sud, par-delà la rivière. Elle dit pour cela bénéficier de l’aide du docteur Mangin, lorrain de Château-Salins, manifestement francophile et francophone (p. 91). La suite de son récit est une succession de tableaux, le plus souvent issus de faits rapportés. Elle dit parfois : « Je n’ai pas vu l’autre scène, celle que je vais rapporter, mais elle me fut contée par des témoins avec une telle minutie de détails impressionnants que j’en ai gardé la macabre obsession » (p. 114), ce qui minore la matérialité testimoniale de ses récits. Ainsi, la description de la mort christique d’un soldat dans un ambulance n’amène pas à la nomination de ce soldat. Elle dit enfin « être rapatriée après un internement de six longs mois en pays occupé » (p. 129), donnant un ouvrage composite construit entre Haybes (le 24 août 1914) et La Guerche (Indre-et-Loire) (le 24 août 1916). L’ouvrage s’achève sur des appendices rapportant les atrocités à Haybes, issu du rapport Bédier (p. 158 à 165), et sa citation pour son attitude courageuse dans les tragiques journées d’août 1914.
Commentaires sur l’ouvrage :
Marie-Louise Grès, épouse Dromart, née à Haybes le 29 juillet 1880, est connue comme poétesse [elle obtient en 1924 le prix Archon-Despérouses puis le prix de l’académie des jeux floraux de Toulouse en 1931]. Son père, Pierre Lambert Édeze Grès, évoqué dans l’ouvrage, est fabricant de pavés en ardoise et sa mère est Adèle Maria Sulin. Marie-Louise Grès est le second enfant du couple qui aura 4 filles. Elle évoque d’ailleurs l’une de ses sœurs, Louise, morte à 20 ans (page 17). Après des études secondaires à Charleville-Mézières, elle se destine au métier d’infirmière. Elle se marie à 19 ans avec François Joseph Dominique Dromart, directeur d’usine. Elle aura une fille (née en 1900) et un garçon (né en 1903), tous deux également cités dans le livre, notamment dans leur tentative avortée de fuite devant l’invasion (p. 19). Elle se fait une place dans la littérature, obtenant quelques critiques encourageantes, notamment de Georges Duhamel, dès avant la Grande Guerre, ce en publiant un premier livre de poésie dès 1912. Elle témoigne également dans un livre recueillant la parole de femmes parisiennes, en compagnie par exemple de Mme Alphonse Daudet ou la duchesse d’Uzès, collectés par Camille Clermont, actrice et autrice. Après la guerre qu’elle a passé réfugiée dans la capitale ou le centre de la France, elle revient à Haybes en 1919, y fait partie des notables (elle narre ainsi succinctement la réception du président Poincaré à Haybes le 1er décembre 1919) (p. 156) et son action au cours des journées terribles d’août 1914 lui valent deux citations à l’Ordre de la Nation, la médaille de la Reconnaissance française et la Légion d’Honneur. Elle meurt à Paris le 23 octobre 1937. Son témoignage, dense et haletant, est issu de son expérience directe sur la période allant du 16 août à octobre 1914 soit un peu plus de la moitié de l’ouvrage. Son style, pétri de patriotisme et d’emphase, mêlant devoir et religion, est un modèle de la littérature emphatique et martyrologe. Elle y multiplie ce style à l’envi : « La voilà bien l’exaltation patriotique des martyrs et des héros qui seront morts sans gloire, mais qui donneront aux siècles futurs la mesure du délire sacré dont notre époque aura frémi » (p. 93) ou un peu plus loin : « De ces riens s’exhale le parfum de la délicatesse française, fleur vivace de la chevalerie et de la loyauté » (p. 95). Son sujet reste toutefois l’histoire du village de Haybes. Dès lors, ce style, ses envolées lyriques (lire à ce sujet le 2ème paragraphe, héroïco-mystique, de la page 116), destinées au lecteur à laquelle elle s’adresse (p. 110) et une certaine centralité omnipotente du personnage dans les faits qui se sont déroulés des 24 au 26 août éludés, l’ouvrage reste référentiel pour l’historiographie de la pointe de Givet et pour les secteurs d’Haybes, de Fumey et de la frontière avec les Ardennes belges. Le livre concourt bien entendu à la littérature martyrologe, mettant en avant les exactions allemandes, la pratique des otages, des boucliers humains, les balles explosives, jusqu’au viol, supposé toutefois (celui de Julie Dévosse p. 94). L’ouvrage s’ouvre en effet sur les 11 soldats tombés au champ d’honneur à la bataille d’Haybes, et sur quatre soldats tombés en formations sanitaires à Haybes (Ambulance de Moraypré) ou Fumay. Toutefois la vérification ponctuelle de quelques patronymes (par exemple Jean-Baptiste Urbain) ne confirme pas toujours les lieux et dates de décès sur les simples noms avancés par Marie-Louise Dromart et invite donc à la prudence et à une vérification plus poussée. Le cas de Jean Marie Ternynck, sous-lieutenant au 245e RI, décédé des suites de ses blessures le 13 septembre (p. 97) et dont elle témoigne de l’enterrement par l’ennemi est par contre conforme à la réalité.
Renseignements tirés de l’ouvrage :
P. 2 : Enfants endimanchés pour l’exode : « on sauvait ce que l’on avait de mieux »
17 : Songe à suicider et à empoisonner sa famille
23 : Cadavre brûlé
30 : A perdu puis retrouvé sa mère et sa fille
33 : Evoque un roulement d’otages
35 : Balle explosive
40 : Croix d’ardoise pour un sépulture
75 : Dans les accusations des prêtres : « Vous avez prêché la revanche »
77 : Acte d’accusation et procès des prêtres puis Cour martiale pour l’abbé Hubert
80 : Allégations allemandes (population hostile, oreille coupée, enfant tirant sur les troupes ou mutilant les soldats, etc.), formulées par un général !
81 : Proclamation
84 : Trou du Diable
94 : Viol supposé de Julie Dévosse, figue johannique
: Allemands se ravitaillant sur le stock de nourriture du fort de Charlemont tombé le 29 août
97 : Mort en enterrement avec le respect de l’ennemi du sous-lieutenant Jean Ternynck
100 : Installation dans l’occupation
103 : Entend le canon du front sur la roche de l’Uf à Fumay (100 km du front)
104 : Soldats français toujours derrière les lignes allemandes plusieurs mois après les combats dans les Ardennes (noms cités) (vap 128 à 130 M. Dutil, parisien, prisonnier puis évadé retrouvé à Paris)
106 : Prix des denrées
108 : Tambour de Raffet, version napoléonienne du Debout les morts de Péricard
112 : Tableau surréaliste de la mort christique d’un soldat
133 : Histoire d’un homme fusillé enterré avec la sacoche postale (vap 154)
134 : Pièce d’or donnée comme Talisman d’un père à son fils
141 : Balle retournée (Dum-dum)
155 : Capitaine Evrard, natif de Fumay, aviateur espion qui a atterri à Bourseigne (Belgique) pour faire sauter le pont ferroviaire Saint-Joseph de Fumey
Table des chapitres
Les Boucliers vivants (p. 1) – Mon village en ruines (p. 55) – Devant la Cour Martiale (p. 61) – Les jours qui suivirent (p. 88) – Figures de désespoir (p. 111) – La dernière classe (p. 117) – La rencontre (p. 126) – La pièce d’or du Poilu (p. 131) – Jeanne Craque (p. 136) – Au temps des Cornouillers (p. 142) – Anniversaire (p. 148) – Appendices (p. 153) dont Rapport des atrocités commises à Haybes par les Allemands, du 24 août au 27 août 1914 (p. 158) et Citation parue au Journal Officiel du 24 octobre 1919 (p. 165)
Yann Prouillet, août 2024