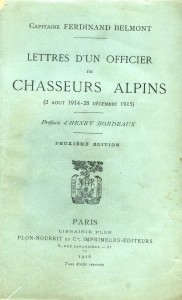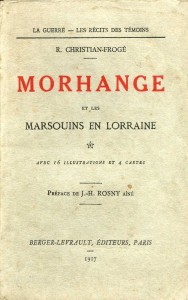1. Le témoin
Décédé le 7 juin 1917 dans une salle de soins du couvent Saint-Antoine de Locre (Belgique), Willie Redmond a été enterré dans les jardins de l’établissement, à proximité du cimetière où reposent la plupart des hommes de sa brigade. En 1919, sa veuve, venue se recueillir sur la sépulture, se déclare particulièrement satisfaite de cet emplacement. Elle s’oppose à la Commission des Sépultures de Guerre, qui au début des années 20 transfère les tombes isolées dans des cimetières de regroupement. La croix qui se dresse encore aujourd’hui au milieu d’un carré d’herbe, à quelques mètres du cimetière, honore un des nationalistes irlandais les plus éminents du début du XXe siècle.
Issu d’une famille catholique irlandaise, William Hoey Kearney Redmond suit les traces de son père et de son oncle, qui avaient tous deux lutté pour la cause irlandaise à la fin du XIXe siècle. Son frère aîné, John, deviendra quant à lui le leader du Parti Parlementaire Irlandais.
Ayant rejoint les rangs de Charles Parnell au sein de l’Irish National Land League, il est arrêté en 1882 et emprisonné trois mois à Dublin pour possession de littérature séditieuse. Sitôt libéré, il se rend aux États-Unis et en Australie pour lever des fonds en soutien de la cause nationaliste. Il est ensuite élu député pour le comté de Wexford et siégera pendant 34 ans à la Chambre des Communes de Londres.
Fervent défenseur de l’autonomie irlandaise, il n’hésite pas à prononcer des discours radicaux, qui lui valent un nouveau séjour en prison en 1902. Visitant régulièrement les communautés irlandaises outremer, il s’inspire du statut de dominion du Canada et de l’Australie pour forger un concept d’autodétermination propre à l’Irlande.
En août 1914, son frère John incite les Volontaires Irlandais à rejoindre les rangs de l’armée britannique, considérant d’une part que l’Allemagne est l’ennemie commune de la Grande-Bretagne et de l’Irlande et d’autre part que l’implication dans l’effort de guerre favorisera ultérieurement l’autonomie irlandaise. Willie est un des premiers à organiser des campagnes de recrutement. Il décide également de s’engager dans l’armée, malgré ses 55 ans. Quatre autres députés irlandais serviront dans des unités britanniques.
Devenu capitaine au sein du Royal Irish Regiment, il arrive au front au cours de l’hiver 1915-16. Il se distingue d’emblée par son esprit combatif et sa proximité avec la troupe, marchant notamment avec ses hommes au lieu de les accompagner à cheval, comme le faisaient de nombreux officiers. En juillet 1916, il doit revenir en Irlande pour raisons de santé. En mars 1917, il prononce son dernier discours parlementaire.
De retour au front, Willie Redmond participe à la bataille de la crête de Messines. Il est l’un des premiers à sortir de la tranchée. Immédiatement blessé au poignet, puis peu après à la jambe, il est évacué à l’unité de soins du couvent de Locre, et y meurt quelques heures plus tard. Son décès est probablement davantage dû à un état de choc qu’aux blessures en elles-mêmes. La nouvelle de sa mort est annoncée dans tous les journaux britanniques. Du monde entier, des messages de condoléances parviennent à sa famille et le gouvernement français lui attribue la légion d’honneur à titre posthume.
Sa tombe isolée a entraîné de nombreux commentaires. D’aucuns ont prétendu qu’il avait lui-même choisi cet emplacement pour protester contre l’exécution des rebelles de Dublin par l’armée britannique au printemps 1916. Mais rien n’est moins sûr. L’isolement de sa tombe n’a peut-être aucune signification politique, même si, symboliquement, le fait qu’un nationaliste irlandais soit enterré à part ne peut que nous interpeller. En décembre 2013, les Premiers Ministres britannique et irlandais, David Cameron et Enda Kenny, se sont rendus ensemble sur les champs de bataille de Flandre et se sont recueillis côte à côte sur la tombe de Willie Redmond. Le député nationaliste aurait certainement apprécié cet hommage, lui qui espérait qu’après la guerre les soldats du Nord et ceux du Sud ayant combattu côte à côte puissent faire pencher la balance en faveur d’une autonomie sans violence. Il n’en a rien été. La guerre d’indépendance irlandaise et la guerre civile qui a suivi immédiatement, ont déchiré le pays de 1918 à 1922. John Redmond, son frère, est décédé le 6 mars 1918. William Archer Redmond, le fils de John, a également combattu en France et en Belgique. Nationaliste comme son père et son oncle, il siégera au parlement irlandais dans les années 20.
La lettre qui suit est adressée à son ami Sir Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes. Datant du printemps 1917, elle résume l’attitude de Willie Redmond face à la question irlandaise et à l’engagement des nationalistes dans la guerre.
« De nombreux Irlandais estiment aujourd’hui que cette guerre doit nous donner l’occasion de bâtir une nouvelle Irlande. Mais les hommes sont en général réticents à faire la moitié du chemin pour se rencontrer. Ce serait un splendide mémorial pour ceux qui ont donné si courageusement leur vie si nous pouvions, au-dessus de leurs tombes, construire un pont entre le Nord et le Sud.
J’ai beaucoup réfléchi à ces choses depuis que je suis en France, et comment ne pas y songer quand le Nord et le Sud de l’Irlande occupent les mêmes tranchées ! Les mots sont impuissants à rendre justice aux actions splendides des volontaires irlandais. Ils n’ont jamais flanché, ils se comportent toujours avec discipline et savent rester sobres. On peut compter sur eux à tout moment. »
2. Le témoignage
Trench pictures from France, publié en 1917, se distingue tout d’abord par sa forme. Il ne s’agit pas du compte rendu habituel de la vie d’un officier sur le front. Composé d’articles publiés anonymement dans le Daily Chronicle, l’ouvrage s’attache à donner au public de l’époque des informations sur la guerre qui ne se résument pas à un récit d’actions militaires et de « vie quotidienne » dans la tranchée et les cantonnements. À la manière d’un journaliste soucieux d’explorer une série restreinte de thèmes, Willie Redmond traite de la place de la religion dans le quotidien des combattants irlandais, du no man’s land, de la bataille de Ginchy, de l’histoire d’un chien égaré devenu la mascotte d’une unité, des services médicaux et de l’importance de la nature en temps de guerre. Ce dernier thème est un de ceux qui sont traités avec le plus de bonheur. La présence de fleurs le long des tranchées ou sur les tombes ne se réduit pas à l’anecdote. Elle indique la force du lien avec la nature, qui dans le monde déshumanisé de la guerre donne un peu d’espoir aux combattants.
« En hiver, la tranchée est sombre, humide, inhospitalière et lugubre. Un véritable sentier de douleur et de martyre où trébuchent des pieds fatigués et où aucune lueur ne vient rompre la morosité ambiante. Mais l’été, la tranchée se transforme. Le long du parapet, de chaque côté, on peut observer de longues plates-bandes de fleurs qui ne connaissent presque pas d’interruption. Ce ne sont pas des parterres plantés par des jardiniers, ils sont bien plus beaux que tout ce qui peut naître des mains de l’homme. C’est la Nature elle-même qui leur a donné naissance.
Les coquelicots et les bleuets s’étalent avec une merveilleuse luxuriance. Des pâquerettes blanches et jaunes, de longues et gracieuses tiges de graminées, avec ici et là quelques pousses de blé ondulant, ayant germé à partir d’anciens semis datant des époques où les champs n’étaient pas labourés par les obus. Ces épis de blé se mêlent aux coquelicots rouges avec une harmonie que le plus talentueux des fleuristes ne pourrait obtenir.
Cette tranchée-jardin, comme il me plaît de l’appeler, s’étire au milieu d’une plaine nue, dénuée de tout relief ; et le vent qui la balaie emmène au loin les semences de fleurs sauvages pour les déposer sur le sol retourné qui longe les tranchées. Il est difficile d’imaginer contraste plus saisissant que celui offert par la fantastique profusion florale qui s’étale au-dessus des profondeurs obscures.
(extrait du premier chapitre, « A Garden Trench »)
Persuadé que le sort de l’Irlande est lié à la guerre contre l’Allemagne, Redmond se sent investi d’une mission. Le sacrifice auquel il a librement consenti ne peut selon lui que servir la cause de l’unité irlandaise. L’ouvrage est écrit sous cet angle. Si cela lui donne une certaine originalité, sa portée n’en demeure pas moins limitée en raison de la volonté – quasi obsessionnelle – de l’auteur de mettre en avant les vertus irlandaises. Un enterrement où officient un prêtre catholique à côté d’un pasteur protestant devient ainsi le symbole d’une cause commune : l’unité du futur État indépendant. Pendant l’attaque de Ginchy, les troupes irlandaises entonnent des chants patriotiques. La population locale apprécie le comportement et la dévotion des troupes catholiques irlandaises, qui se rassemblent en nombre le dimanche dans les églises flamandes ou picardes, obligeant les curés français à multiplier les offices.
Au-delà de cet aspect, le témoignage de Willie Redmond est d’un intérêt certain. L’introduction biographique écrite par Eleanor Mary Smith-Dampier n’échappe pas au panégyrique caractéristique des publications d’écrits de combattants tombés au front mais a le mérite de brosser le portrait d’une des grandes figures du nationalisme irlandais du début du siècle.
Francis Grembert, janvier 2016