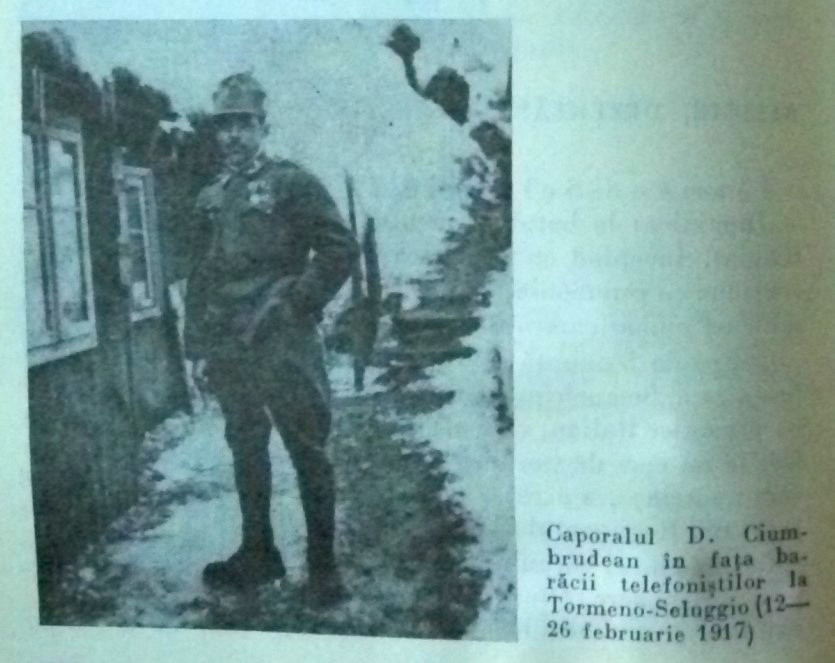Léon Plantié est né à Fauguerolles (Lot-et-Garonne) le 23 décembre 1878 dans une famille de cultivateurs. Il est allé à l’école jusqu’au niveau du certificat d’études ; il n’est pas certain qu’il l’ait obtenu. Dans ses lettres il fait beaucoup de fautes d’orthographe. Mais il sait écrire de belles pages sur le rôle du courrier (p. 122), sur la nature (p. 177), sur son arrivée par surprise lors d’une permission (p. 478). Il n’est pas dépourvu du sens de l’humour. Il sait aussi parfaitement gérer son exploitation : une toute petite propriété et une terre en fermage ; la culture du tabac et l’embouche de jeunes bovins… Service militaire à Agen de 1899 à 1902 ; il reste 2e classe (photo p. 42). Le 28 juin 1909, il épouse Madeleine, du même milieu paysan, mais sur laquelle nous ne sommes pas renseignés. Le couple a un fils, Étienne, né en novembre 1913. Un travail intense et le sens des affaires ont donné quelque aisance aux Plantié. Avec leurs économies, il ont acheté des titres d’emprunts russes. Dans ses lettres, Léon parait détaché de la religion catholique. En août 1914, il est mobilisé au 130e régiment d’infanterie territoriale. Pendant une partie de la guerre, il occupe des postes relativement peu exposés, mais il doit passer dans un régiment d’active en 1917 (le 5e RI) en première ligne d’un secteur « mauvais » où il est tué le 16 août près du Chemin des Dames à Paissy. C’est une époque où le couple était occupé à planifier une nouvelle situation pour l’après-guerre. Il est toujours émouvant de découvrir le courrier d’une femme écrivant à son mari dont elle ignore encore la mort, lettre portant la mention brutale : « Retour à l’envoyeur. Le destinataire n’a pu être atteint. »
Écrire
Madeleine s’est remariée en 1920. Elle a cependant conservé la correspondance de 1914-1917 dans une caisse en bois, arrivée entre les mains de son arrière-petite-fille, Cécile Plantié, professeure de français dans un collège de Bordeaux, qui l’a publiée : Que de baisers perdus… La correspondance intime de Léon et Madeleine Plantié (1914-1917), préface de Clémentine Vidal-Naquet, Presses universitaires de Bordeaux, 2020, 520 p. La séparation du couple a produit une abondante correspondance (1500 lettres). Au début, Léon a dû insister à plusieurs reprises pour que sa femme prenne la plume régulièrement. Le 28 novembre 1914, il se comparait à un alcoolique qui serait privé de sa dose habituelle : « si moi je n’ai pas de tes lettres, je suis malheureux ». Et le 1er mai 1915 : « Nous avons besoin du pain, c’est la nourriture des corps, mais actuellement les lettres sont une nourriture de l’âme. » Léon demande à Madeleine de conserver ses missives : « plus tard, il me semble que je serai content de repasser ces longues lettres » (14 mars 1915). Le 24 mars, à propos des lettres de Madeleine, il décrit une situation fréquente : « Quant à moi ne m’en veux pas, je les ai gardées longtemps mais quand je m’en suis vu encombré j’ai fait comme tous les autres et je les ai faites brûler. » En août 1915, le couple trouve une solution pour que soient sauvegardées les lettres dans les deux sens. Léon écrit à la suite des textes de Madeleine, ou dans les marges, ou par-dessus même comme le montrent quelques illustrations.
L’amour
L’étude de nombreux témoignages d’origine populaire a montré que la plupart des combattants ne sont pas devenus des brutes, que la guerre a permis de découvrir ou de redécouvrir l’amour conjugal et l’affection pour les enfants (voir notre livre collectif 500 témoins de la Grande Guerre et les notices sur notre site). Dans la correspondance Plantié, l’amour est le thème principal, exprimé parfois de façon romantique (p. 395, envoi d’un poème), ou avec des points de suspension de pudeur mais explicites, et même avec les mots les plus précis (p. 162, 468). Le manque rend les lettres indispensables. Elles disent le regret de Léon de ne pas voir grandir son fils, de ne pas pouvoir jouer avec lui (5 janvier 1915). Elles abordent aussi un thème précis (5 décembre 1914) : « Dis à notre fils que jamais quand il sera homme il ne soutienne le parti, n’importe quel qu’il soit, qui veuille faire la guerre. » Il faut lui apprendre à crier « À bas la guerre ! » (18 août 1915).
À bas la guerre !
Par ordre d’importance des thèmes de cette correspondance, la condamnation de la guerre vient en deuxième position. Il est vrai que Léon regrette en août 1914 de ne pas partir tout de suite pour aller tuer « quelques Prussiens » (p. 49). « Je ne peux lire les atrocités qu’ils commettent sans frémir », précise-t-il, le 2 septembre. Par la suite, on ne trouvera qu’une seule mention des « sales Boches » criminels et barbares (p. 192). Mais, dès le 8 septembre 1914, Léon affirme : « Ma Patrie, c’est toi et mon enfant. » La critique de la guerre revient sans cesse, accompagnée d’imprécations contre les responsables : les Grands, riches, spéculateurs, capitalistes, nobles réactionnaires qui voulaient « foutre la République de jambes en l’air » (p. 207). « J’en ai assez de ces gens-là, partisans de la guerre, de ces tueurs d’hommes, de ces mangeurs d’enfants de 20 ans » (18 avril 1915). Tous ces patriotes jusqu’au-boutistes préfèrent causer « au coin d’un bon feu » (12 octobre 1914) ; qu’ils viennent dans les tranchées ! La guerre est « maudite » (27 novembre 1914), « putain » (10 mai 1915), « déshonneur du siècle » (2 août 1915). Léon voit plus haut en affirmant qu’il y a un seul genre humain, il ne devrait y avoir qu’une seule patrie qui rassemblerait Français, Allemands, Russes, Anglais. Aucun de ces peuples ne veut la guerre « car ils aiment eux aussi et ils sont aimés par leurs familles, alors ils veulent vivre » (17 décembre 1914). S’il ne fallait que la signature des poilus, la Paix serait vite là (13 janvier 1915). L’indignation de Léon Plantié s’exprime avec force contre l’emprunt de la Défense nationale.
Ne pas souscrire !
En décembre 1915, les lettres de Léon reviennent à plusieurs reprises sur l’emprunt de la Défense nationale (p. 308 à 338). Cet argent est collecté pour faire durer la guerre et tuer des hommes : « Nos assassins, sans mentir, versent de l’or et de plus font une propagande ignoble pour le faire verser. […] Vous autres, derrière, vous n’hésitez pas non plus à leur fournir de l’argent et de l’or pour acheter et faire des choses qui peut-être serviront à tuer un des vôtres. Ah ! si vous entendiez toutes les malédictions qui vous pleuvent dessus et vous tombent sur la tête, sûrement vous ne le feriez pas, mais on vous berne et on vous bourre le crâne et vous vous laissez faire, les uns bien volontairement et les autres innocentement. » En versant, Madeleine est devenue la complice de ceux qui veulent « nous » faire tuer. Léon lui pardonne, mais souhaite que ses camarades ne l’apprennent pas « car ils me mangeraient tout vif ». L’attitude de Léon Plantié rappelle celle de l’instituteur Émile Mauny et les reproches qu’il adressait à sa femme (voir ce nom dans notre dictionnaire). Ici, le thème du refus de verser est exposé en même temps que se déroulent des fraternisations.
Fraternisations
Au cours du même mois de décembre 1915, Léon fournit un témoignage de plus sur les fraternisations entre soldats ennemis. Bien que Cécile Plantié place ces lettres dans une partie sur la Somme, divers indices montrent qu’il s’agit des fraternisations en Artois, après des pluies torrentielles, celles qu’a merveilleusement décrites le caporal Barthas. Les indices sont la présence du 280e RI, régiment de Barthas, devant le 130e territorial, et le lieu-dit Le Labyrinthe. Léon relie les fraternisations au fait que « les troupes n’en veulent plus » (11 décembre 1915) : « Et pour preuve, c’est qu’ils fraternisent tous ensemble, en effet il n’est pas rare de les voir tant d’un côté comme de l’autre, faire échange de pain, de conserves ou de tabac, et pour cela ils montent sur les tranchées et se promènent comme sur un champ de foire, sans qu’un coup de fusil soit tiré de part ni d’autre. » Léon ne peut participer directement à ces fraternisations, n’étant pas en première ligne, mais il les voit : « Je travaillais à 400 mètres des 1ères lignes et j’ai pu m’en rendre compte. » Madeleine répond que les Allemands des tranchées sont « des hommes comme vous autres » (15 décembre). On ne peut retenir le commentaire de Cécile Plantié affirmant que le phénomène des fraternisations « s’est répandu comme une trainée de poudre simultanément sur tout le front ouest » (p. 364). Elle aurait eu une meilleure idée si elle avait cité le fameux texte de Louis Barthas, son appel à la construction d’un monument fraternel, et la réalisation de celui-ci en 2015 près de Neuville-Saint-Vaast, inauguré par le président Hollande.
Autres aspects de la vie sur le front
Sur la vie dans les tranchées, Léon Plantié n’apporte pas de nouveau, mais il décrit les bleus baissant la tête chaque fois qu’ils entendent un obus (p. 87), il évoque les vaches de son exploitation mieux traitées que les poilus (p. 119), les rats qui ont tellement proliféré que leurs ressources sont devenues insuffisantes (p. 204), les poux, eux aussi de plus en plus nombreux (p. 417 : « les veinards, ils ont fait l’amour, eux, et nous autres nous nous en passons »). La nourriture est exécrable, les envois familiaux sont indispensables ; on manque cruellement de légumes. Un moment, cependant, en janvier 1915, étant « bien avec le cuisinier des officiers », il peut écrire : « Souvent ils mangent les bons morceaux, auxquels je ferais bien honneur et qu’il faut que je m’en passe, mais souvent aussi avec les restes je prends quelques bons régals. » Plus tard (10 mai), son escouade fait chauffer sa popote « en puisant du charbon chez les officiers ». La boue est bien sûr présente dans le témoignage ainsi que les frissons en voyant venir une nouvelle campagne d’hiver (4 juillet 1915). Ce thème avait été souligné dans 500 témoins de la Grande Guerre.
Léon condamne les offensives stériles qui font tuer tant de monde (le 27 juin 1915, puis le 28 avril 1917). Lors d’un retour de permission, il décrit, le 28 mai 1917, les soldats cassant les vitres des trains par désir de vengeance, et criant : « Vive la Russie, vive la Révolution, à bas la guerre. » Tandis que les femmes, à Paris, réclament la paix et le retour de leurs hommes.
Un thème encore : dès le 8 octobre 1915, Léon comprend qu’après la guerre « des touristes ou des curieux viendront visiter les tranchées » et que des familles essaieront de retrouver les tombes de leurs morts.
Le travail des femmes
Cette correspondance renseigne également sur le travail des femmes à l’arrière avec le cas de Madeleine. Une des rares lettres conservées du début de la guerre (26 septembre 1914) raconte « une rude journée » à labourer et à curer l’étable. Léon lui donne des conseils, mais en précisant (p. 150) : « Tu feras ce que tu pourras et tu laisseras le reste. » Parce que c’est trop dangereux, il lui interdit de mener seule un taureau à la foire (p. 181). Il s’indigne de rester lui-même sans rien faire au camp de Mourmelon alors qu’il pourrait soulager sa femme dans ses multiples travaux. En effet, Madeleine écrit le 30 novembre 1916 qu’elle mène « une vie de galérienne ». Elle se débrouille cependant assez bien, sachant prendre ses responsabilités dans la vente du tabac et le commerce des jeunes bovins, par exemple. Le 14 mai 1916, elle écrit : « Laisse-moi maîtresse je t’en prie jusqu’à la fin de la guerre, et après comme tu voudras je te cèderai la place bien volontiers. »
Regrets
Sur la forme, Cécile Plantié a voulu respecter l’authenticité des lettres. Mais la seule véritable authenticité réside dans les documents originaux ou dans une reproduction en fac-similé d’excellente qualité. Qui peut prétendre retranscrire exactement des textes à l’orthographe imparfaite ? Une mauvaise lecture peut supprimer des fautes ou en ajouter. L’orthographe des Plantié étant ce qu’elle est, certaines notes me paraissent inutiles (par exemple préciser que le mot « espectateur » doit être lu comme « spectateur », ou « assasins » comme « assassins », ou encore « aluminion » comme « aluminium »). Je regrette aussi quantité de « (sic) » tout à fait intempestifs. En toute logique, il aurait fallu en placer après toutes les fautes (mais aussi, alors, après les quelques coquilles décelées dans les commentaires de la présentatrice). Surtout, beaucoup de « (sic) » proviennent de la méconnaissance d’un procédé d’écriture qui consiste, pour l’épistolier quand il tourne la page, à reprendre en haut le dernier mot de la page précédente. Alors, dans ce livre, on a profusion de formules comme « te te (sic) », « et et (sic) », « c’est de m’en c’est de m’en (sic) », etc. Dans cette notice, j’ai choisi pour mes transcriptions de rectifier l’orthographe.
Maladresses et erreurs historiques
Des commentaires « historiques » sont maladroits. Par exemple lorsque Léon critique « le commandement », Cécile pense qu’il vise les caporaux (p. 107). Page 126, elle écrit cet étonnant passage : « Du 23 janvier au 3 février [1915], Léon et ses camarades sont aux tranchées. Jamais au front, ils sont malgré tout en première ou deuxième ligne pour effectuer diverses tâches d’intendance. » En annonçant la mort de son arrière-grand-père, Cécile Plantié écrit (p. 497) : « Un obus français mal calibré l’a atteint. » Le cas s’est produit assez souvent mais, ici, on n’a pas la source de cette information. Et que signifie « mal calibré » ? Voici encore un commentaire (p. 108) qui n’a aucun rapport avec le texte original, et même aucun sens : « Parfois même, il [Léon] tiendra un discours rigoureusement anticommuniste, accusant ces derniers d’avoir fomenté la guerre afin de parvenir au pouvoir. » Je n’arrive pas à comprendre d’où peut venir cette phrase aberrante.
Pour terminer :
La présentatrice du témoignage d’un lot-et-garonnais aurait pu s’appuyer sur 500 témoins de la Grande Guerre et le dictionnaire des témoins sur le site du CRID 14-18 pour découvrir d’autres combattants lot-et-garonnais. Son arrière-grand-père y figure à présent à son tour.
Rémy Cazals, mai 2021