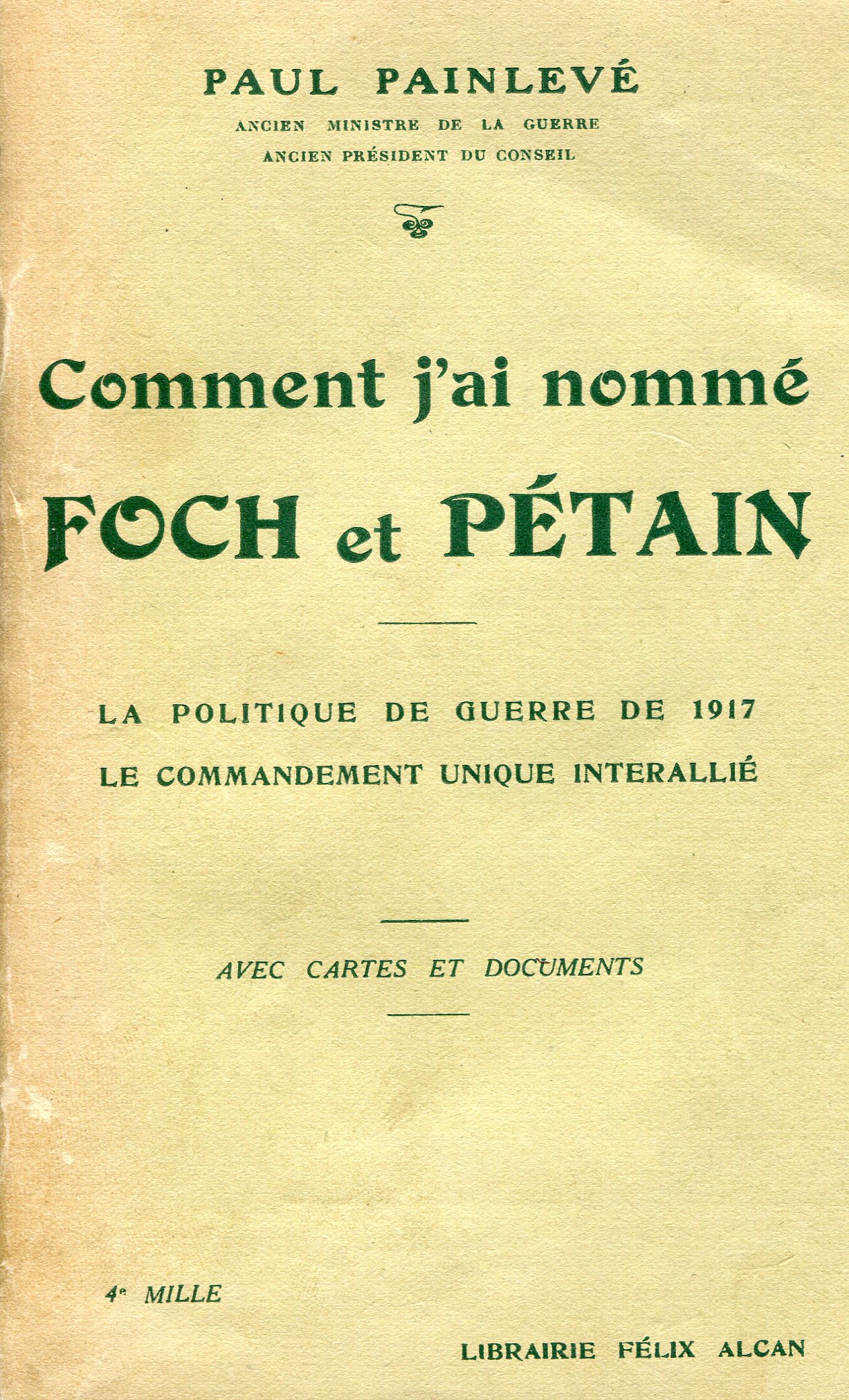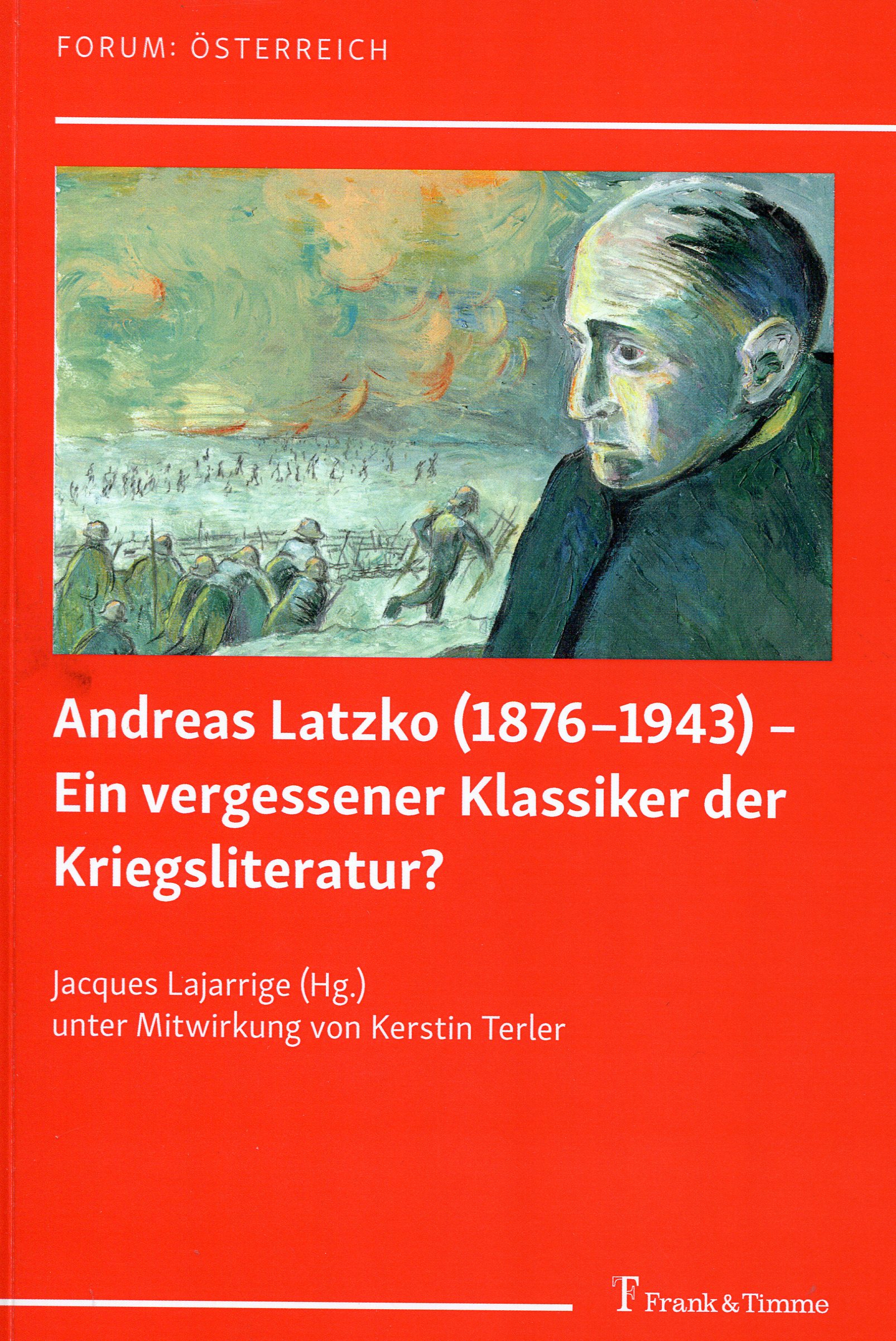Mon journal de Quatorze-Dix-Huit
1. Le témoin
Victor Chatenay (1886-1985), originaire de Doué-la-Fontaine (Maine-et Loire), appartient à une famille de négociants. Si entre-deux guerres il est responsable dans une entreprise d’épiceries (Établissements Brisset), il a à l’origine une formation d’avocat. Exempté en 1906, il s’engage le 11 août 1914. Après une trajectoire atypique, il est, au début de 1915, sapeur dans une compagnie du Génie. Blessé en Artois, il devient après sa convalescence chauffeur d’automobile puis de camion. Sous-lieutenant dans le Train en 1917, il commande une section de transport puis, de janvier 1918 à la fin de la guerre, il est le responsable français d’une unité britannique féminine de transport sanitaire. Dès 1940, V. Chatenay anime un mouvement de résistance à Angers ; sa femme est déportée à Ravensbrück, et lui passe à Londres en 1943. Maire R.P.F. d’Angers (1947 – 1959), il est aussi sénateur, député puis membre du premier Conseil constitutionnel des nouvelles institutions de 1958. Il quitte la vie politique en 1962.
2. Le témoignage
« Mon journal de Quatorze-Dix-Huit » de Victor Chatenay a paru à Angers en 1968 (Imprimerie de l’Anjou, 1968, 197 pages). Sa rédaction suit celle de « Mon journal du Temps du malheur », 1967, qui raconte son engagement résistant de 1940 à 1944. Dans sa préface, l’auteur évoque des lettres d’anciens combattants « on voit bien que vous n’avez pas fait l’autre guerre (…) C’était tout de même autre chose que votre résistance. » Cela le décide à raconter à son tour ses « aventures » dans la Première Guerre. Philippe Chatenay, petit-fils de l’auteur, a proposé sur le site « Chtimiste » un texte remanié sous un nouveau titre : « Des bagnards au Gotha, mon journal de 14 – 18″. Il signale avoir mis le texte au «goût du jour », il s’agit de suppressions de détails, de résumés, et beaucoup de phrases ont été reformulées. Il est donc préférable, pour l’étude historique, de se reporter au texte d’origine.
3. Analyse
La trajectoire de l’auteur est atypique, ce qui donne parfois à son récit de guerre un ton romanesque ; en plus de ce qu’il vit, V. Chatenay raconte aussi des « histoires », des histoires de guerre, et c’est cette combinaison de la narration de son parcours original, et de ces anecdotes, qui fait l’intérêt du « Journal de Quatorze-Dix-huit ». Et les faits ? Autant que l’on puisse les vérifier, ceux-ci sont avérés, en ce qui concerne sa trajectoire personnelle, et ses histoires variées sont le plus souvent crédibles.
Réformé en 1906, et engagé volontaire en août 1914 pour l’aviation, au premier régiment de génie de Versailles, il a presque immédiatement une altercation avec un supérieur, et s’enfuit pour échapper à la prison. Il se fait oublier en réussissant à intégrer une autre compagnie de génie qui fait des travaux de fortification dans le camp retranché de Paris. Il obtient ensuite un détachement aux Invalides à Paris, où il entretient des véhicules automobiles et conduit des autorités. Il loge à l’extérieur, dîne en ville, mais sa mauvaise affaire d’août le rattrape et il se retrouve en décembre 1914 en Artois, dans une compagnie disciplinaire (compagnie 4/8). À Maroeuil ou à Camblain, il décrit ses nouveaux amis apaches ou escrocs, mais il donne aussi des éléments intéressants sur la guerre de mine. Ainsi un mineur du Nord lui explique l’écoute des sapeurs ennemis (p. 48) : « Ecoute, la brouette roule souvent, c’est qu’on transporte autre chose que de la terre, et les coups de pioche ne sont plus au même rythme, la cadence a changé. Attention. » Il raconte l’offensive du 9 mai 1915, qu’il fait à Berthonval avec des légionnaires, devant les Ouvrages blancs, jusqu’à sa blessure, d’une balle dans la mâchoire, à La Targette le 15 mai. Il est secouru après 36 heures passées sur le glacis, mais un obus tue ses brancardiers. Enfin récupéré, il est aidé par l’intervention de son frère Marcel, lieutenant dans l’organisation des services sanitaires : (p. 73) « Marcel a découvert un sergent infirmier auquel il me recommande (…) il lui donne cent francs, ce qui est une somme énorme, pour qu’il me soigne et s’occupe de moi, et fasse en sorte que j’aille le plus loin possible. » Il décrit ensuite son hospitalisation à Lamballe, les blessés, les infirmières : (p. 76) « Quel monde mélangé que ces infirmières françaises ! Du nul, du moche et aussi du meilleur. »
Après sa convalescence, il rejoint un parc automobile, puis, versé à la S.S. 102 (section sanitaire), il fait des évacuations jusqu’à la fin de 1915 en Argonne. Il en effectue aussi beaucoup pendant la bataille de Verdun, puis il est versé au 20e escadron du Train en juin 1916. Dans le même temps, il s’occupe de son « petit commerce » (p. 88) : sapeur, il a appris à démonter les têtes d’obus, et se fait signaler par l’infanterie les obus non éclatés ; après neutralisation, il les revend à des officiers amateurs de souvenirs. Il fait ensuite une demande pour les chars, qui lui est refusée, son supérieur lui reprochant de ne pas chercher à être officier (p. 93) « Vous ne manquez pas, à coup sûr, de vous plaindre de la qualité de vos officiers. S’ils ne valent pas mieux, n’ont qu’à se taire ceux qui peuvent l’être et s’y refusent». Changeant d’avis, il passe alors par Pont-Sainte-Maxence et Meaux et devient sous-lieutenant dans les transports. (juin 1917). Il reçoit le commandement du T.M. 539 (pour transport de matériel), qui regroupe vingt camions Saurer et la responsabilité de véhicules divers non endivisionnés. Il participe souvent avec ses chauffeurs aux trajets de nuit, exposés aux bombardements et aux dangers de l’aube, lorsque les obus à livrer n’ont pas été déchargés assez vite. La description de la route à sens unique au nord de Verdun, après l’avancée des lignes françaises fin 1916, est intéressante, avec un sens unique, par Le Poivre – Louvemont – Haudremont – déchargement, puis retour par le Ravin de la Mort vers Thiaumont. De jour et au repos, la vie pour l’auteur ne manque pas d’attraits, avec les amis de passage, attirés par son « admirable popote », servie par un maître d’hôtel dans le civil. Il souligne qu’il est bien conscient d’être privilégié, par rapport aux « fantassins si malheureux », mais il dit aussi qu’il est impossible de restituer « l’atmosphère lourde et si pénible de la montée du ravin de la Mort, quand on voit, devant soi, s’abattre des rafales d’obus sur le carrefour de Thiaumont qu’il faut traverser ». Ailleurs il évoque « la nuit si noire que c’est un exploit de mener un gros véhicule, lourdement chargé, dans ces chemins boueux, encombrés… et sans lumière. » (p. 114). Se portant souvent volontaire pour des corvées parfois dangereuses, V. Chatenay conclut qu’il se considère comme privilégié, mais pas comme embusqué.
Le ton général est constamment patriotique et hostile aux Allemands. Politiquement, l’auteur n’a aucune considération pour les opposants à la poursuite du conflit à partir de 1917, et il le dit crûment dans une boutade anti-socialiste : (p. 130) « Mais ils marchent [les poilus] et marcheront jusqu’au bout, si le gouvernement ne flotte pas et sait faire fusiller sans tapage les jeunes hommes qui se réunissent avec nos ennemis à Zimmerwald, à Kienthal ou à Stockholm, sous la direction de mon vieux camarade Pierre Laval. » Ce passage du résistant Chatenay (caviardé dans la version en ligne sur « chtimiste »), évoque, évidemment par antiphrase, le Laval député S.F.I.O., hostile à Zimmerwald en 1915 mais proche ensuite de la sensibilité « Stockholm ».
En 1918, il est désigné pour encadrer « une section de femmes de la haute société anglaise », qui doit venir sur le front former un groupe de conductrices de véhicules sanitaires. Les Anglais semblent tenir à un engagement effectif de ce détachement, et l’État-major français désigne V. Chatenay comme responsable de ces conductrices. La Section Sanitaire Y 3 est formée, sous la responsabilité anglaise de Toupie Lowther, d’une trentaine de voitures qui font de l’évacuation entre les ambulances et les gares ferroviaires. Il décrit des membres de l’aristocratie et de la grande bourgeoisie anglaise, parlant presque toutes le français, et quelques riches américaines arrivées dans un second temps. Il évoque les deux adjointes de T. Lowther : « une vieille et maigre, et pas belle, l’autre blonde et bien portante », ou les conductrices, (p. 135) « si certaines pouvaient être dans la réserve de la territoriale, presque toutes sont jeunes, et, à première vue, jolies. » L’auteur est bien ennuyé au début, car avec cette fonction il fait figure de « prince des embusqués » ; il souligne à plusieurs reprises qu’il n’a jamais voulu cette fonction, qu’il ignore l’anglais, et que son premier souhait est un poste de combattant en ligne (p. 137) : « Vers quelle aventure cinéma-guerrière suis-je embarqué ! ». Ce manque d’enthousiasme lui permet d’échapper à toutes les cabales plus ou moins jalouses dirigées contre lui. Est intéressante ici, dans sa narration, la mention de l’incompréhension, de l’hostilité, sans compter évidemment la moquerie, de la majorité des supérieurs à qui il a affaire pour le service. Il évoque par exemple le mépris d’un commandant – qui s’excusera plus tard – (p. 177) : « Monsieur, je n’admets pas qu’un officier français accepte de commander un bordel. ».
L’unité, qui apporte toute satisfaction lors des combats de l’été 1918, est félicitée, et V. Chatenay l’accompagne jusqu’à Wiesbaden, en 1919. Il rend, à sa manière, un hommage à la fois sincère et ironique à la responsable anglaise T. Lowther, décorée de la croix de guerre, qui en obtenant de «servir au front comme section sanitaire de division, a réalisé une performance unique, et son seul échec est de ne pas avoir réussi à faire tuer quelques-unes de ses conductrices, ce qui aurait fait briller sa section et lui aurait valu la légion d’honneur. » (p. 143). Il signale aussi qu’il ne peut éviter la sociabilité mondaine, et parfois les idylles de certaines conductrices avec des officiers attirés comme des papillons, mais il souligne sa propre réserve à cet égard. Il reste toutefois qu’il épousera en 1920 Barbara Stirling, une des conductrices de la S. S. Y 3.
Ce témoignage a été rédigé par un notable gaulliste de 82 ans : il évoque sa guerre – il a failli mourir sur le parapet en Artois – mais il aime aussi à évoquer sa jeunesse et ses frasques. Si cet itinéraire « combattant » atypique est possible, avec son dandysme assumé (mondanités, uniformes chics…), c’est aussi parce que son origine sociale et ses moyens le lui permettent, mais n’enjolive-t-il pas un peu le passé ? Ce qui frappe ici, outre ce ton détaché qui révèle un vrai talent de conteur, c’est sa liberté de mouvement, qui elle aussi, n’a rien de représentatif du vécu de la majorité des combattants. Par définition, les conducteurs sont mobiles et l’arme du Train laisse souvent un espace d’autonomie ; lui-même évoque certains de ses chauffeurs, non rattachés à des sections constituées (p. 124) : « Les conducteurs étaient tous débrouillards, trop débrouillards, et je me reconnais du mérite d’avoir pu les tenir à peu près en main (…) mais j’étais heureux d’avoir ce commandement qui m’apportait l’énorme privilège de pouvoir circuler partout. » Sa description de l’unité de femmes dont il est responsable en 1918 est également précieuse ; en effet, au contraire des nombreuses infirmières, subordonnées dans les hôpitaux, et affectées uniquement aux soins, les conductrices anglaises ont en plus une compétence technique « masculine », et disposent d’une part d’autonomie qui, si ténue soit-elle, rencontre constamment l’incrédulité des officiers français. Certes, elles sont là surtout parce que, outre leur patriotisme, elles sont riches ou nobles, et elles ne sont en rien représentatives des femmes anglaises en guerre ; toutefois, malgré ce caractère « extraordinaire », elles représentent quand-même, sur le sol français, la marque de l’avance britannique en matière d’émancipation féminine.
Vincent Suard, septembre 2021