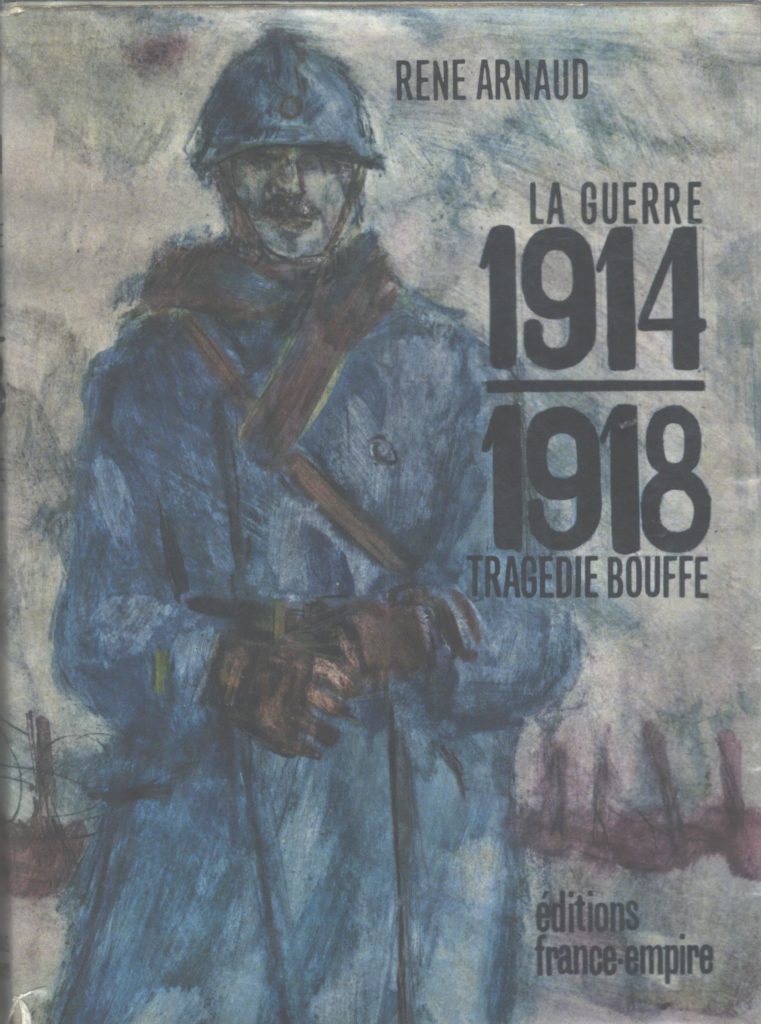1. Le témoin
René Jacques André Arnaud est né le 2 juillet 1893 à La Rochelle (Charente-Maritime). Il dit être entré au lycée de Rochefort en sixième à l’âge de dix ans. C’est son père qui choisit pour lui la langue anglaise : « Ce jour-là, sans s’en douter, mon père avait orienté toute ma destinée », ce qui précipitera la fin heureuse de sa guerre. Il aura certainement une scolarité brillante puisqu’il est normalien et entre en guerre en septembre 1914 à Vannes, obtenant le grade de sous-lieutenant en trois mois. Dans son témoignage, peu avant le Chemin des Dames, il se classe comme « homme de gauche ». Il meurt à Paris le 15 janvier 1981.
2. Le témoignage et analyse
René Arnaud annonce dès le titre l’angle sous lequel il va délivrer son témoignage. Son récit, écrit au début des années 60, est alors un mélange de souvenirs et de réflexions, souvent opportunes, avec pour fil conducteur la démonstration de l’absurdité de la guerre et de ceux qui la font, des militaires de carrière ou des civils sous l’uniforme, y compris réservistes. Ce biais rend son témoignage réfléchi, en forme de récit chronologique mais surtout concentré sur des grandes phases vécues dans trois régiments ; le 337e, 6e bataillon (Fontenay-le-Comte), (janvier 1915 – juin 1916), le 293e (La Roche-sur-Yon) (juin 1917 – novembre 1917) et quelques mois au 208e RI (Saint-Omer) (décembre 1917 à son changement d’affectation, en juillet 1918).
Avec son ami Guiganton, ils entrent en guerre « pleins d’ardeur et d’enthousiasme. Notre seule crainte avait été que la guerre se finît trop vite, avant même notre arrivée au front : quelle humiliation eût été la nôtre, de rester en dehors de la grande aventure de notre génération ! Et puis la flamme de la guerre attirera toujours les gars qui ont 20 ans » (p. 8). Il reviendra d’ailleurs mi-1916 avec plus de lucidité sur ces premiers sentiments : « Bien qu’une grosse marmite allemande vînt toutes les deux minutes s’écraser à droite dans les bois, j’eus quelque envie pour ces « embusqués » – qu’en même temps je méprisais -, et qui faisaient la guerre avec un minimum de risques, alors que l’enchaînement des causes et des effets avait fait de moi, petit intellectuel chétif d’avant-guerre, un lieutenant d’infanterie, c’est-à-dire pratiquement un homme condamné à mort, sauf grâce exceptionnelle. Et je ricanai en me rappelant qu’en 1914 je n’avais qu’une peur : que la guerre ne finît trop vite et que je n’eusse pas le temps d’y prendre part » (p. 88). Il reviendra page 204 sur cette expression en disant : « Un condamné à mort en sursis célèbre-t-il son anniversaire ? » Sa rencontre avec celui qu’il qualifie de « mon premier colonel » est lucide : « Si le colonel prenait son absinthe biquotidienne, si, coiffé d’un képi à manchon bleu, il évoquait les grandes manœuvres, c’est que la guerre n’était au fond pour lui qu’une continuation de la vie de garnison, à peine modifiée. Qu’il y eût cette fois de vraies balles dans les fusils et de vrais obus dans les canons, il n’en avait cure : car il ne mettait jamais les pieds en première ligne et ne dépassait guère vers l’avant son poste de commandement » (p. 13). Poursuivant ses tableaux, s’affranchissant parfois de la chronologie, en janvier 1916, assez familier avec son capitaine, qui le surnomme « Noisette », il relate comment il obtient sa première décoration : « Vous chercherez avec mon secrétaire dans le Bulletin des Armées un motif de citation à l’ordre du régiment ! C’est ainsi que je reçus la Croix de guerre et ma première étoile. Après avoir rêvé d’être décoré sur le front des troupes, quelle dérision ! J’eus du moins la pudeur, en rédigeant moi-même mon motif inspiré du Bulletin, d’éviter la grandiloquence ordinaire, les « N’a pas hésité… » ou les « N’a pas craint… » et de me référer simplement à mon baptême du feu où j’avais le sentiment d’avoir fait honnêtement mon métier » (p. 19). Baptême du feu qu’il avoue d’ailleurs avoir reçu tardivement, précisant : « Ce n’est qu’un mois et demi après mon arrivée au front, le 28 février, que je reçus en première ligne le baptême du feu ». Il n’est pas très ému de son premier mort (P. 34) mais dit plus loin (p. 36) sur son inhumation, cérémonialisée « Mais on n’enfouit pas ce corps comme celui d’un chien » : « Bien que la religion me fût devenue assez étrangère, je fus profondément remué par ce modeste effort de spiritualité au milieu des brutales réalités de la guerre ». En effet, cette mort le renvoie à la sienne : « Et j’étais si plein de vie qu’il m’était impossible de m’imaginer comme lui, couché sur un brancard, avec cet air distant qu’ont les morts. D’ailleurs n’était-il pas inscrit que j’en reviendrais ? ». (Il revient plus tard sur ce sentiment d’en sortir, alors qu’il subit un pilonnage à Verdun « Alors que la mort me frôlait à chaque minute, je sentais en moi la volonté, la certitude de vivre » (p. 117) (…) « Je vis donc emporter ce cadavre sans y voir pour moi aucun présage » mais il est bien plus ambigu quand il poursuit : « Ces images éveillaient alors en moi obscurément je ne savais quel plaisir : c’est beaucoup plus tard que je devais découvrir que ce plaisir était d’ordre sensuel et qu’il y a un lien mystérieux entre la mort et la volupté » (pp. 34-35). Il revient la page suivante à cette notion dans un tout autre domaine : « Nous couchions dans les caves, dont les murs étaient abondamment illustrés de pages découpées dans la Vie Parisienne, sarabande de petites femmes montrant leurs cuisses demi gainées de soie : nous n’avions pas attendu les Américains pour orner nos chambres de « pin-up »» (p. 36).
Sur la notion de héros, il en a une définition réaliste : « Le héros véritable à la guerre, ce n’est pas l’officier à qui il est facile d’oublier le danger qu’il a la volonté de faire son métier, ce n’est pas le technicien – mitrailleur, artilleur, signaleur – qui lui aussi peut ignorer les périls s’il se concentre sur le fonctionnement de sa technique ; le héros, c’est le simple soldat sans spécialité qui n’a qu’un fusil en main pour se distraire de l’idée de la mort ». (pp. 39 et 40).
Afin d’attester du surréalisme et du tragique de la guerre, René Arnaud multiplie les anecdotes telle celle de ces guetteurs tirant sur des oiseaux migrateurs pour s’amuser, entrainant un effet domino de fusillade, puis d’artillerie et causant finalement 7 morts dus à cette fausse alerte, ou ce lieutenant d’artillerie chauffé par l’alcool qui fait tirer au canon sans motif, entraînant lui aussi une riposte mortelle (p. 44).
Il n’est pas toutefois hermétique au bourrage de crâne, notamment sur le ramassage des blessés, n’y voyant qu’espionnage et traîtrise, tel en juin 16, ce : « Souvent, à ce que l’on nous avait dit, des combattants ennemis s’approchaient sous le couvert de la Croix-Rouge, dissimulant dans leur brancard une mitrailleuse » (p. 135). Mais il fait côtoyer ce sentiment avec l’horreur des corps en décomposition, qu’« il nous fallait pourtant regarder en face » et de conclure ; « Et nous n’avions qu’une pensée fugitive pour les proches de ces « disparus », qui fussent devenus fous à voir ce que la guerre avait fait de leur fils, de leur mari ou de leur amant » (p. 49). Il poursuit encore : « Et puis, en rentrant de la ronde, on secouait ces funèbres pensées, on se jetait sur la mangeaille avec un appétit de jeune loup comme dans ces repas de famille qui suivent les enterrements à la campagne. La vie reprenait le dessus, on bâfrait, on buvait, on savourait un verre de fine, on fumait un cigare et on ne pensait plus à nos cadavres jusqu’à ce que la prochaine ronde remît sous nos yeux ce « je ne sais quoi qui n’a de nom dans aucune langue » (pp. 49, 50).
Le 6e chapitre est un tableau de sa vision de l’armée anglaise, bien équipée, et à l’ « odeur de merisier et de tabac sucré ».
Près de cent pages sont consacrées au front de Verdun. Elles montrent, par l’ambiance et l’anecdote, l’homérique de cette phase. Sur l’abnégation du soldat qui « y tient », il dit : « On nous disait de tenir : y avait-il tant de mérite à ne pas bouger de sa tranchée où on était bloqué, et à y attendre passivement la fin du pilonnage, dans l’incapacité physique d’agir ? » (p. 117) Devant cette débauche d’obus, dont il dit : « tous les obus ne tuent pas – il y en a même fort peu qui tuent. Mais il en tombait tellement cette fois-ci que quelques-uns frappaient juste », il se révolte pourtant : « A la fin, c’en était trop. Le spectacle de ces paquets de chair fragile qui attendaient la mort sous un déluge de fer et de feu me révolta. En cette minute je ne pensai à la Providence que pour la nier ou la maudire. Morand, mon ordonnance, l’avait dit dans son simple langage : « Est-ce que le Bon Dieu devrait tolérer des choses pareilles ? I doit pu guère s’occuper de nous à c’t’heure ! ». Oui, le ciel était vide. Il n’y avait point de dogme du péché qui pût donner un sens à un pareil massacre ». Devant tant de mort et de souffrance ; « Cette longue série d’émotions excessives avait fini par tuer en moi l’émotion elle-même » (pp. 118-119). Car la mort tombe du ciel, impersonnelle, anonyme : « Je remarque tout à coup un grand corps qui marche là, vers la droite, je vise, j’ai l’intuition du tireur qui tient là son but, j’appuie sur la détente et, tandis que le recul me secoue l’épaule, le grand corps disparaît. Je me demanderai plus tard si c’est ma balle ou la balle d’un autre qui l’a atteint ou s’il s’est simplement jeté à terre devant la fusillade trop intense. C’est en tout cas le seul Allemand que je crus avoir « descendu » en trois ans et demi de campagne, et sans en être sûr » (pp. 122-123). La relève arrive : « tous les survivants eurent un sursaut de joie ; ils allaient en sortir ». Mais le capitaine envisage de laisser les morts à leur sort. Suit un tableau saisissant d’assainissement du champ de bataille (p. 140). A Verdun, revenu dans la sécurité relative de la ville, succédant à 10 jours d’enfer dans le secteur de Thiaumont, il constate qu’une trentaine d’hommes sur 130 sont redescendus ; il les décrit : « La plupart n’ont ni sac, ni ceinturon, certains n’ont même plus leur fusil. Ils s’en vont furtifs, en désordre, comme s’ils avaient fui la bataille. Leurs yeux sont encore fiévreux dans leur visage noirci par la barbe, le hâle et la crasse. Ces héros ne font guère figure de héros » (p. 143). Il en tire un bilan décalé devant le communiqué : « Y n’parlent pas d’nos pertes », grommelle un homme. Mais il est le seul à grogner. Les autres ont aux yeux une petite flemme d’orgueil : « Ça, c’est nous ! » L’être humain tire sa fierté de ses pires souffrances » (p. 144). Les pertes au 237e RI ont été si importantes qu’il est fondu avec le 293e « que nous n’aimions point » dit-il, bouleversant totalement l’unité, et de fait sa cohésion (p. 147). Après quelques jours de repos, le régiment reconstitué est renvoyé dans l’enfer avec la mission de reprendre Thiaumont. Il dit : « Chacun pensait : « On en revient une fois, pas deux ! » » (p. 148). Et Arnaud de constater la recrudescence des consultants du médecin aide-major, soldats comme officiers qui en font autant ! (p. 150). Dans ceux qui y retournent, il décrit les blessés légers filant vers l’arrière après s’être lestement déséquipés et dit : « On eût dit qu’ils avaient étudié le manuel du parfait évacué » ! (p. 156). Plus loin, il fait le calcul lucide et surréaliste « que pour faire un prisonnier on dépensait 300 000 francs (…) [79 829 927,88 € ndlr] pour un prisonnier, « cela mettait cher le gramme de Boche » ! (p. 170).
Il participe ensuite au 16 avril 1917, et est témoin des mutineries ; « nous n’en croyions pas nos oreilles » (p. 175) en avançant qu’elles n’ont pas concerné son régiment, expliquant que « par tempérament et par tradition le Vendéen est docile et respectueux de ses chefs » (p. 176). Il en impute la cause aux officiers cultivant l’inégalité et, arguant qu’il connait ses hommes, caviarde auprès de ses troupes la « littérature » ampoulée émanant du GQG, mais pas celle venant de Pétain. Il rapporte ensuite l’épisode de La Marseillaise chantée par Marie Delna le 19 juillet suivant qui tempéra un peu pour le général Des Vallières la loyauté de sa division (151e).
Au début de décembre 1917, René Arnaud, qui a été promu capitaine à 24 ans au mois d’aout précédent, se trouve affecté à un nouveau régiment suite à la dissolution, en novembre, du 293, mais sans citer celui, « de réserve du Nord » qui l’accueille. Il intègre une unité qui porte la fourragère aux couleurs verte et rouge de la Croix de guerre. Au passage, il dit ce qu’il pense de ces fourragères, notamment en les rapportant à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale ! Mais il avance : « Un régiment dissous, c’était un régiment suspect : si on nous avait supprimés, c’est sans doute que nous ne valions pas grand-chose, peut-être même que nous avions mis la crosse en l’air » (p. 182). S’il ne cite pas son nouveau et ultime régiment, c’est qu’il n’a pas digéré cette affectation. Mal reçu par ce qui apparaît être le 208e RI de Saint-Omer, il dit : « En outre, je tombais dans un régiment où l’atmosphère était assez déplaisante » et « était ce qu’on appelle vulgairement un panier de crabes » tel qu’il acquiert un manifold pour se garantir contre les mauvais coups ! (pp. 184-185). En mars ou avril suivant, ayant répondu à une demande d’officiers connaissant l’anglais, il est affecté au début de juillet 1918 à l’armée américaine comme « officier informateur ». Il en déduit : « Je fus comme ébloui par cette nouvelle. En une seconde, j’eus le sentiment que la guerre était finie pour moi, que je survivrais, et je fus d’un coup délivré de cette sourde angoisse qui pesait sur moi depuis trois ans et demi, de cette hantise de la mort qui m’avait obsédé comme elle obsède les vieillards en bouchant leur avenir ». Plus loin, il ajoute : « J’avais le sentiment d’être invulnérable » mais sans que cela gomme son impression d’abandonner ses hommes (pp. 204 à 206). Son témoignage s’arrête sur sa « profonde reconnaissance à ceux qui sont ainsi venus in extremis faire pencher en notre faveur le plateau de la balance ». (p. 208). S’ensuit un appendice final de 73 pages, inutile et comportant quelques erreurs, intitulé « petite histoire de la Grande Guerre »
Est-il un bon témoin ? Fin mai 1916, alors qu’il monte à Verdun, il se souvient avoir vu au bord de la route, entre Vaubécourt et Rembercourt-aux-Pots, « des tombes de deux soldats tués ici même le 8 septembre 1914 : Rémy Bourleux, soldat au 37e de ligne ; Constant Thomas, soldat au 79e de ligne » (p. 83). Recherches effectuées, ces deux soldats n’ont pas été identifiés et les deux régiments cités ne combattaient pas à cet endroit à la date précisée mais en Meurthe-et-Moselle. Mais il est plus précis quand il évoque la mort de l’Etreusien René Breucq BREUCQ René, 05-10-1884 – Visionneuse – Mémoire des Hommes (defense.gouv.fr), effectivement tué le 20 juillet 1918 au combat de Neuilly-Saint-Front (p. 207).
Renseignements complémentaires relevés dans l’ouvrage :
(Vap signifie « voir aussi page »)
Page 93 : L’absinthe et comment on la consomme
Vue de volontaires américains conduisant des ambulances Ford de la Croix Rouge « qui s’étaient jetés dans la guerre dès 1915 comme dans une gigantesque partie de base-ball »
19 : Comment il reçoit sa Croix de guerre en se l’attribuant lui-même.
25 : Colonel reprenant théâtralement son poste juché sur un lorry
28 : Vue d’un déserteur allemand polonais
29 : Général enfreignant la consigne de l’interdiction de porter le passe-montagne
33 : Bruit de l’obus (vap 63, 97, 104, 105 et 116)
34 : Poêles « empruntés » au village voisin
35 : Vue du château de Bécourt, près de La Boisselle
34 : Pas ému de son premier mort, mais ému plus loin (p. 36) de la spiritualité
37 : Reçois tardivement son baptême du feu, le 28 février
: Hallucination du guetteur
38 : Odeur poivrée de la poudre
44 : Coup de foudre d’amitié entre deux hommes « sans qu’aucun élément trouble vienne s’y mêler »
48 : Cigarette, seul recours contre l’odeur des cadavres
51 : Bruit du train
53 : « Le vin est pour eux chose plus sacrée que le pain »
55 : « Heureux le bœuf qui ne sait pas qu’on le même à l’abattoir »
59 : « Sentiers « canadiens » faits de petit rondins joints où couraient deux rails de bois qui fixaient le tout »
Rats et odeurs de rat crevé
Vue « pittoresque » d’un capitaine de marsouins « à l’allure d’alcoolique »
61 : Touche l’Adrian, « que nous essayâmes en nous esclaffant, comme si c’eut été une coiffure de carnaval »
66 : Propos défaitistes de Vendéens parlant de la défense de la Champagne pouilleuse : « Si tieu fi d’garce de Boches veulent garder ce fi d’putain d’pays, y a qu’à l’leur laisser : ça sera pas une perte ! Ollé pas la peine de s’faire tuer pour ça ! ». (vap 80 sur le 15ème Corps)
67 : Poêle improvisé fait d’un vieux bidon de lait et de tuyaux de gouttière
68 : Jambe momifiée par le gel
: Différence entre active et réserve : « je suis un réserviste, un soldat d’occasion ! » (vap 94)
71 : Interrogatoire comique de prisonnier allemand qui pense retourner dans sa tranchée après
73 : Sur le 17e RI, le régiment du midi crosse en l’air et la chanson révolutionnaire de Montéhus
76 : Ce qu’on trouve dans un bazar militaire
82 : 10 minutes de pause toutes les 50 mn de marche
: Mai 1916, vue de deux tombes du 8 septembre 14 mais non confirmées par les recherches
84 : Vue de la Voie Sacrée interdite aux colonnes d’infanterie, ordre contourné par coterie
85 : Rumeur des gendarmes pendus à Verdun
86 : Haine, mépris et envie contre les officiers d’état-major
: Camions ornés de la Semeuse
: Sur les Vendéens et les Midis
87 : « « Embusqué » s’écrivait désormais avec un A, l’A cousu au col des automobilistes »
90 : « Le vrai front commence au dernier gendarme »
: Vue de la citadelle de Verdun, son ambiance, son aspect d’« entrepont d’un paquebot plein d’émigrants » (vap 95 comment on en sort)
94 : Sur le drapeau et son utilisation : « le drapeau était un embusqué et la guerre était sans panache »
: Odeur de sueur et de vinasse flottant dans les casemates
96 : Sur la veulerie d’un homme qui a peur, son sentiment devant cet homme
105 : Sur la mort survenue aux feuillées, accident qu’une citation aurait heureusement transformé en mort glorieuse
111 : Allègue que « le « système D » n’est pas traduisible en allemand »
112 : Couleur des fusées françaises et allemandes
116 : Bruit des obus
122 : Stahlhelm « en forme de cloche à melon »
: Odeur alliacée (de l’ail) de la poudre
123 : Reçoit une balle dans son casque, lui ayant fait sauter le cimier
124 : Accident de grenade F1 à douille en carton (vap 129 et 136)
133 : Regarde passer les « bouteilles noires », des obus
134 : Capitaine déprimé, « l’alcool ne le soutenait plus »
135 : Grenade grésillante
136 : Sentiment d’être sourd et pense à la « fine blessure »
137 : Blessés dont il remarque « leur soumission passive au destin »
140 : Odeur fétide d’une corvée montante
145 : Officier de l’arrière, escadron divisionnaire, semblant sortir d’une première page de La Vie Parisienne
146 : Pense avoir perdu sa jeunesse à Verdun
155 : Vider sa vessie en cas de balle au ventre
173 : Pillage d’une cave de Champagne
174 : Notion du bien et du mal floutée par la guerre
: Sur le vin : « Chacun sait que le soldat français croit avoir des droits sur toute bouteille de vin qui est à sa portée »
182 : Fourragère rouge et verte (Croix de guerre), citée à l’ordre de l’Armée deux fois, Jaune (Médaille militaire) citée 4 fois, Rouge (Légion d’Honneur) citée 6 fois
189 : Vue d’une fête sportive
212 : Affiche de la mobilisation générale toujours présente sur un mur parisien en 1964.
Yann Prouillet – février 2021