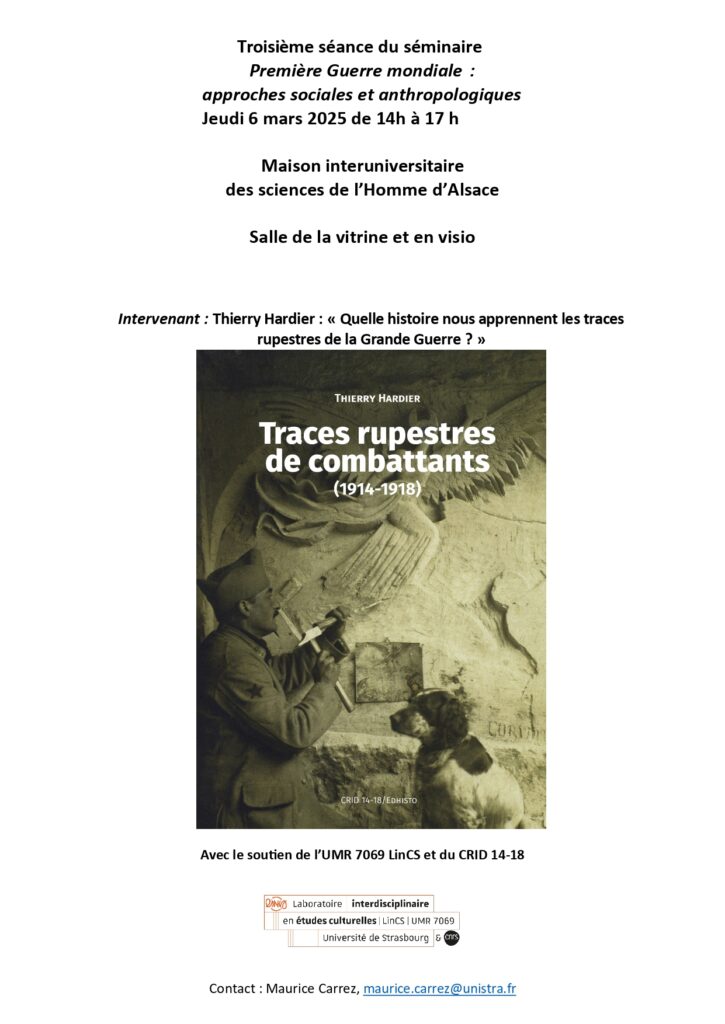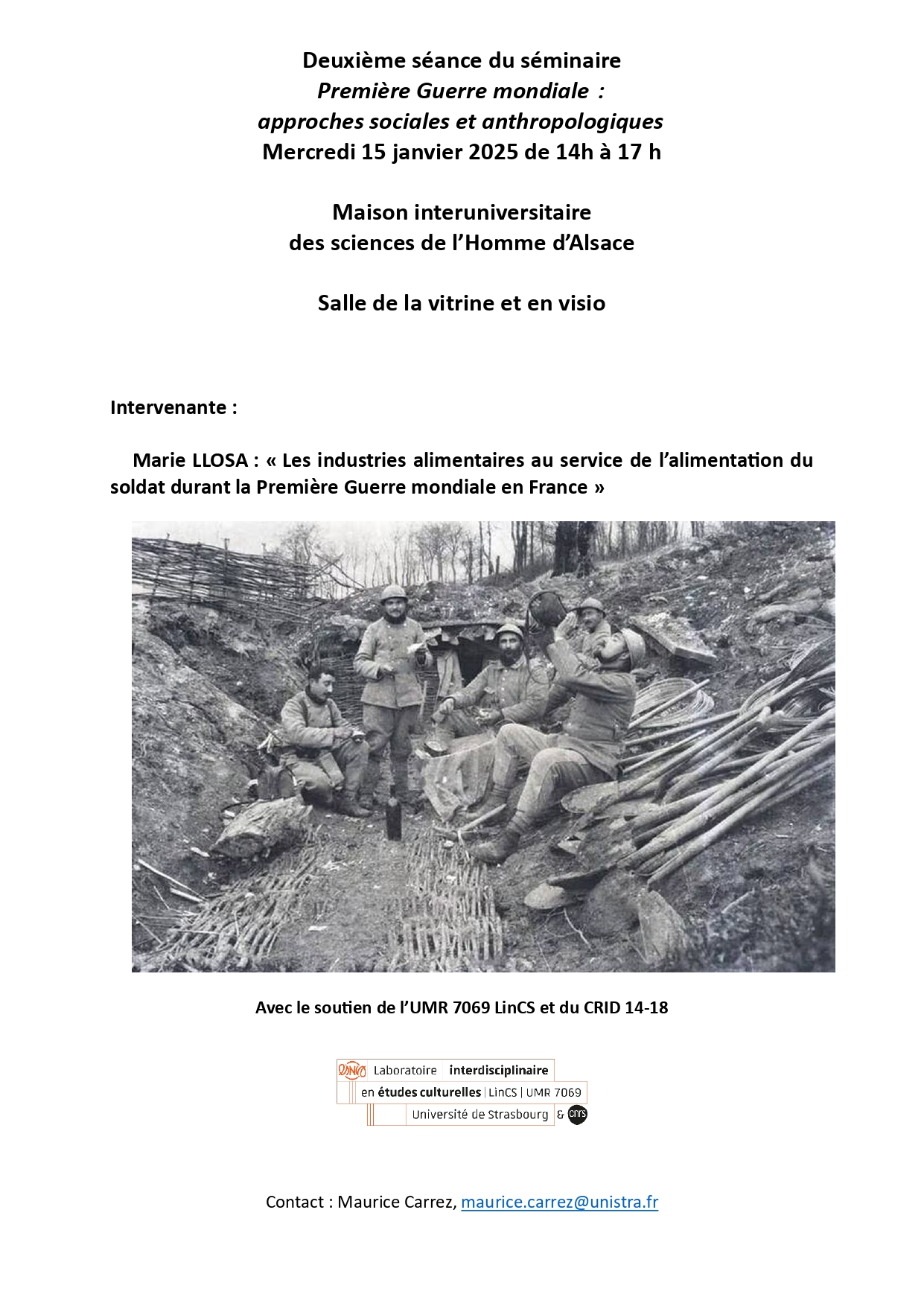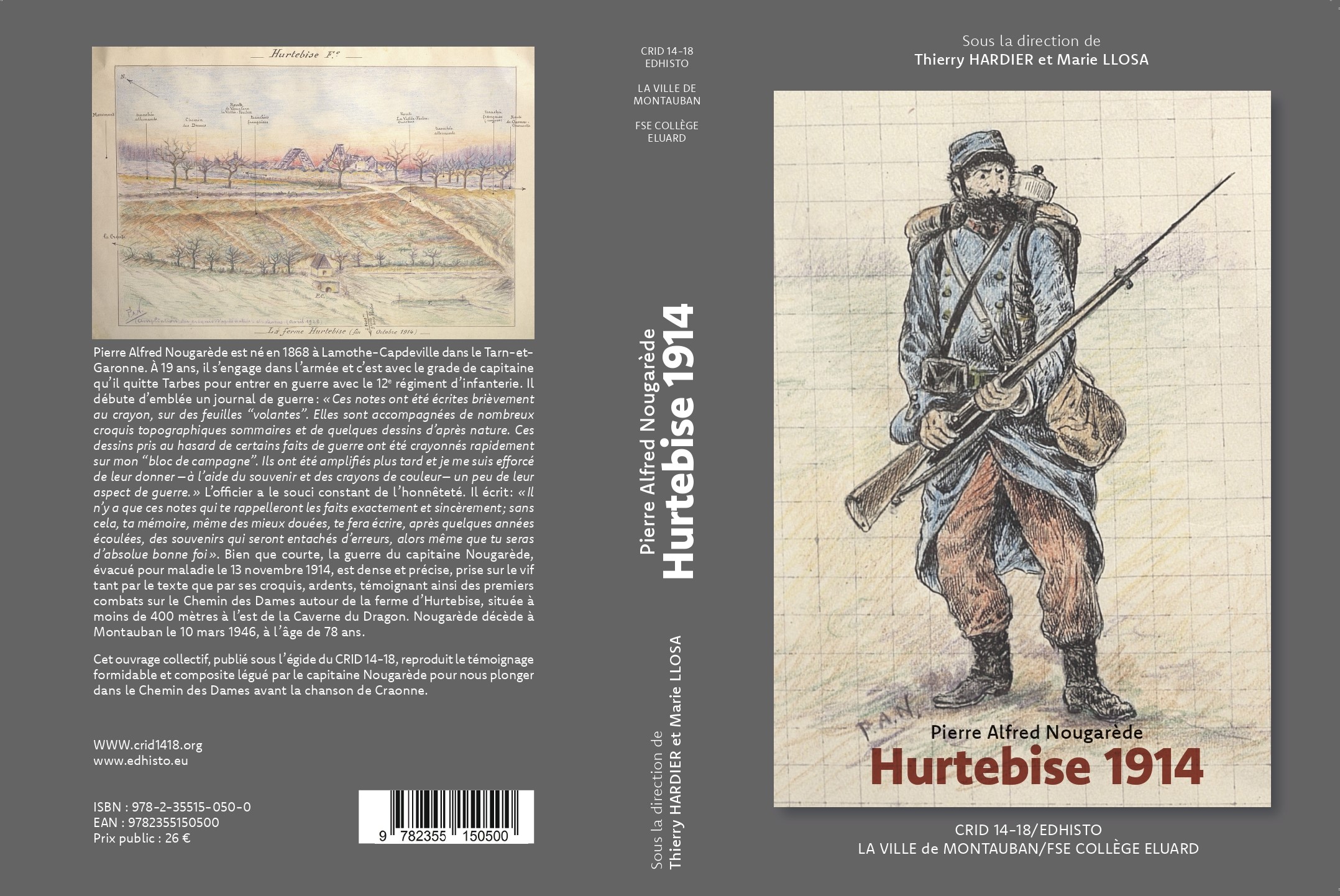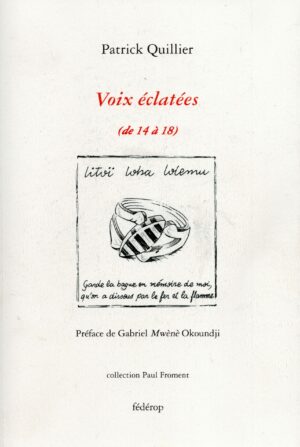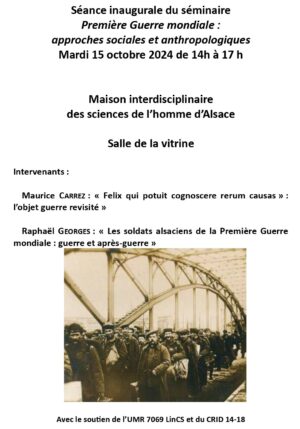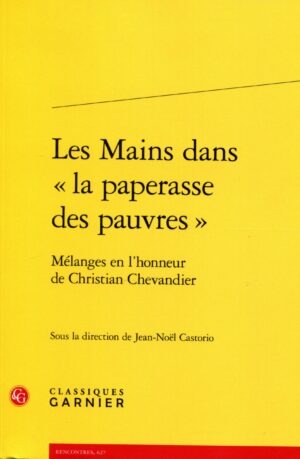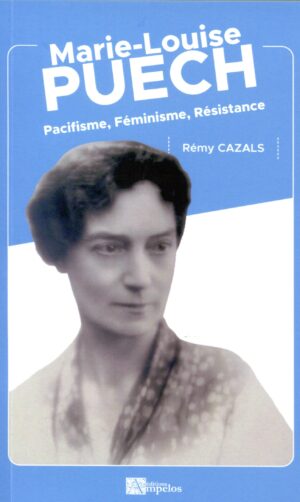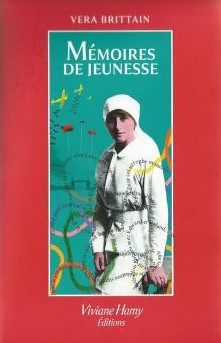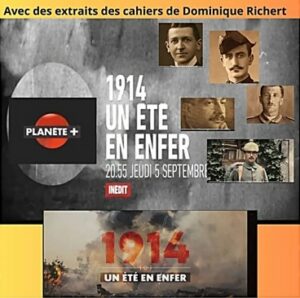Dans l’Aisne et de l’Oise, pendant la Grande Guerre, des combattants occupèrent des carrières souterraines qui leur servirent d’abris et de cantonnement. Ils réalisèrent, sur les parois calcaires de ces cavités, plusieurs milliers de graffiti, de gravures et de bas-reliefs. Notre recherche entendait alors interroger cet énorme gisement de témoignages rupestres qui nous autorise à l’élever à la fois au rang de phénomène et de source directe.
L’étude des traces rupestres a été menée en deux phases, avec d’une part leur inventaire, et d’autre part, l’exploitation du corpus ainsi constitué. Pour l’inventoriage, nous avons visité plusieurs centaines de sites se répartissant sur une aire géographique d’environ 1 000 km². Ensuite, à partir de l’inventaire des traces recensées, notre approche méthodologique, par l’intermédiaire d’une base de données, s’est fondée sur une analyse quantitative et sérielle des témoignages relevés. Lors de l’analyse de ce corpus, nous avons également confronté ces traces avec d’autres sources, notamment les témoignages écrits des combattants.
En définitive, notre étude a été guidée par ces questions : quelle est la nature de cette source, son intérêt, son originalité mais aussi ses limites ? Contribue-t-elle à porter un regard nouveau, dans les domaines de l’histoire sociale et culturelle qui interrogent les combattants de la Grande Guerre ? Nous apporte-t-elle, dans sa spécificité, de nouveaux éclairages sur les pensées, les rêves, les fantasmes, les horizons d’attente, les revendications, les liens sociaux, les pratiques et les représentations collectives des combattants ? Et dans tous ces domaines, met-elle en lumière des différences significatives entre Français, Allemands et Américains ?
Le séminaire sera également disponible en visio via le lien suivant : https://bbb.unistra.fr/b/car-yxc-xmu-8ei